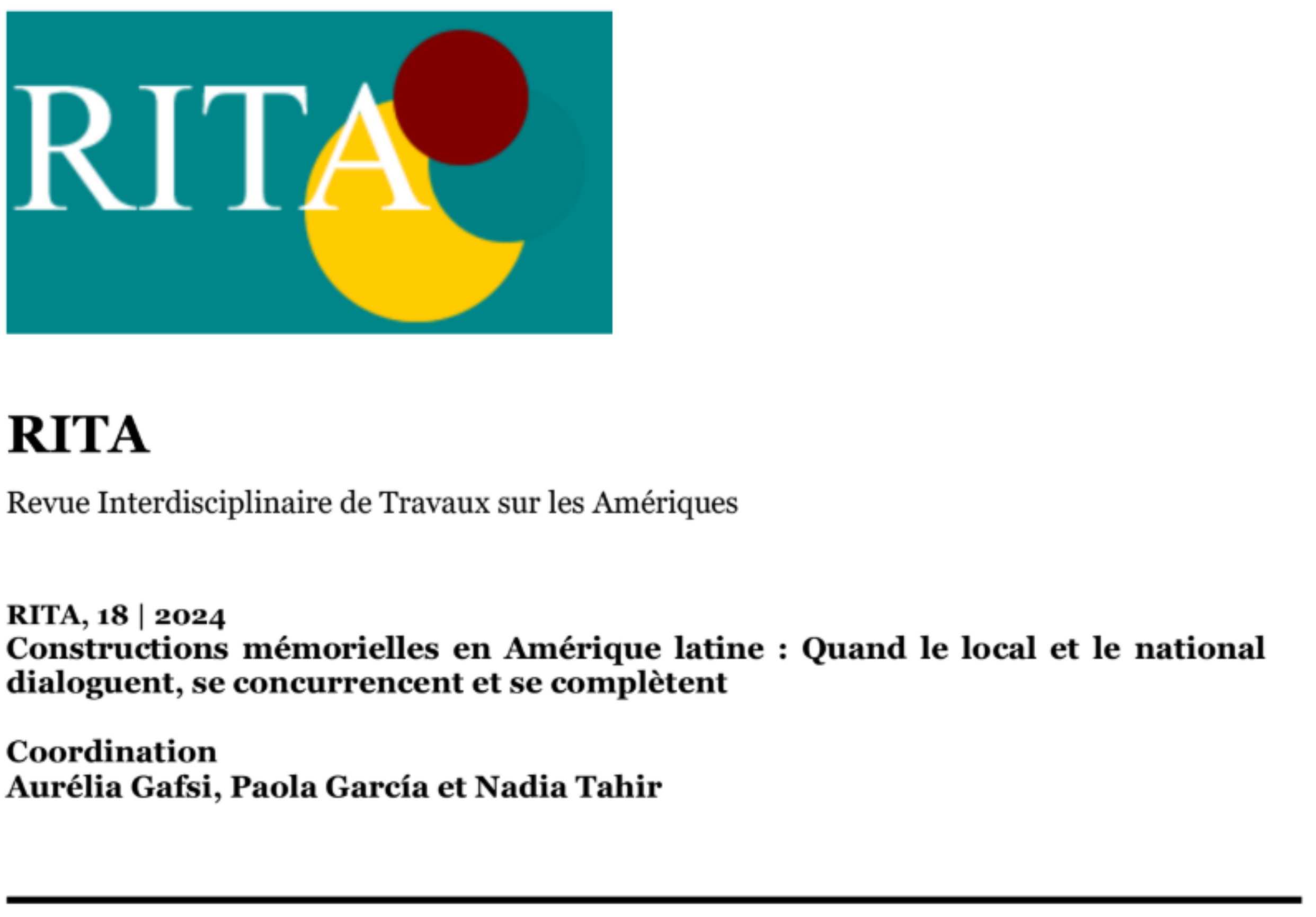
Aux origines de la Commission Provinciale pour la Mémoire dans le Chaco : l’institutionnalisation d’une mémoire locale
Résumé
Les politiques publiques liées au passé de la dernière dictature en Argentine (1976-1983) ont fait l’objet de nombreux travaux scientifiques. Depuis quelques années, on voit émerger des travaux sur des provinces autres que celle de Buenos Aires, notamment Córdoba et Santa Fe. Dans le cas de province du Chaco, le développement de ces recherches se fait en conversation avec des travaux sur les provinces voisines de Corrientes, Misiones et Formosa. En nous intéressant au projet de loi qui mène à la création de la Commission Provinciale pour la Mémoire dans le Chaco entre 2003 et 2005, nous souhaitons mettre en avant les dynamiques locales mises en place au cours de l’élaboration de cet outil institutionnel aujourd’hui en charge des questions portant sur le passé dictatorial. Nous étudierons les différents éléments et acteurs qui interviennent dans le développement de ce projet à l’échelle local, mais aussi le poids des échelles nationales et internationales sur celui-ci.
Mots clefs : Chaco, Argentine, dictature, institutionnalisation, mémoire
En los orígenes de la Comisión Provincial por la Memoria en el Chaco: la institucionalización de una memoria local
Resumen
Las políticas públicas vinculadas al pasado de la última dictadura en Argentina (1976-1983) han sido objeto de numerosos trabajos científicos. En los últimos años han surgido trabajos sobre otras provincias que la de Buenos Aires, entre las que se destacan Córdoba y Santa Fe. En el caso de la provincia de Chaco, esta investigación se desarrolla en diálogo con trabajos sobre las provincias vecinas de Corrientes, Misiones y Formosa. Al estudiar el proyecto de ley que dio lugar a la creación de la Comisión Provincial por la Memoria en el Chaco entre 2003 y 2005, queremos poner de relieve las dinámicas locales que se pusieron en marcha durante el desarrollo de esta herramienta institucional, hoy encargada de las cuestiones relativas al pasado dictatorial. Examinaremos los distintos elementos y actores que intervinieron en el desarrollo de este proyecto a escala local, así como el impacto de las escalas nacionales e internacionales sobre el mismo.
Palabras claves: Chaco, Argentina, dictadura, institucionalización, memoria
At the Origins of the Provincial Commission for Memory in Chaco: The Institutionalization of a Local Memory
Abstract
Public policies related to the legacy of the last dictatorship in Argentina (1976–1983) have been the subject of extensive scholarly research. In recent years, studies have begun to emerge that focus on provinces other than Buenos Aires, particularly Córdoba and Santa Fe. In the case of the province of Chaco, the development of such research has evolved in dialogue with studies conducted in the neighboring provinces of Corrientes, Misiones, and Formosa. By examining the bill that led to the creation of the Provincial Commission for Memory in Chaco between 2003 and 2005, we aim to highlight the local dynamics that were set in motion during the development of this institutional instrument, which today is responsible for addressing issues related to the dictatorial past. We will analyze the various elements and actors involved in the development of this project at the local level, as well as the influence exerted by national and international frameworks upon it.
Keywords: Chaco, Argentina, dictatorship, institutionalization, memory.
Às origens da Comissão Provincial pela Memória no Chaco: a institucionalização de uma memória local
Resumo
As políticas públicas relacionadas ao legado da última ditadura na Argentina (1976–1983) têm sido objeto de numerosos estudos acadêmicos. Nos últimos anos, começaram a surgir pesquisas que se concentram em províncias diferentes da de Buenos Aires, especialmente Córdoba e Santa Fe. No caso da província do Chaco, o desenvolvimento dessas pesquisas ocorre em diálogo com estudos realizados nas províncias vizinhas de Corrientes, Misiones e Formosa. Ao analisar o projeto de lei que levou à criação da Comissão Provincial pela Memória no Chaco, entre 2003 e 2005, buscamos evidenciar as dinâmicas locais estabelecidas durante a elaboração desse instrumento institucional, atualmente responsável por tratar das questões relativas ao passado ditatorial. Analisaremos os diferentes elementos e atores envolvidos no desenvolvimento desse projeto em nível local, bem como o peso das escalas nacionais e internacionais sobre ele.
Palavras-chave: Chaco, Argentina, ditadura, institucionalização, memória.
------------------------------
Nadia Tahir
Maîtresse de conférences
Université de Caen Normandie/ERLIS
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Aux origines de la Commission Provinciale pour la Mémoire dans le Chaco : l’institutionnalisation d’une mémoire locale
INTRODUCTION
Les constructions mémorielles autour de la dernière dictature argentine (1976-1983) ont été l’objet de nombreux travaux depuis une trentaine d’années. Dans la lignée des travaux de la sociologue Elizabeth Jelin, notamment de son ouvrage fondateur Los trabajos de la memoria, publié en 2002, la recherche argentine s’est intéressée à plusieurs champs en lien avec ce passé dictatorial. Dans le cadre d’une collection d’ouvrages qu’elle a dirigée pour Siglo XXI Editores au début des années 2000, « Memorias de la represión », Jelin et les auteurs et autrices qui y participent s’intéressent à plusieurs outils qui permettent d’étudier et d’analyser les processus de constructions de mémoire autour de passés traumatiques. S’il est vrai qu’une place particulière est accordée à l’Argentine, les ouvrages traitent aussi de cas dans d’autres pays latino-américains.
L’ouvrage qui nous intéresse particulièrement est : Luchas locales, comunidades e identidades. Dans cet ouvrage publié en 2003, les coordinateurs soulignent la nécessité de ne pas limiter l’étude des constructions mémorielles à l’échelle nationale, mais de s’intéresser aux caractéristiques et particularités des échelles locales. Comme on peut le voir dans le titre, les auteurs associent aussi ces luttes aux termes « communautés » et « identités » laissant entendre que ce sont des éléments qui peuvent être structurants (Del Pino, Jelin, 2003, pp. 3-4). Il est intéressant de voir que même si l’ouvrage a plus de vingt ans, par la suite, les travaux sur les réalités locales en Amérique latine et, pour le cas qui nous intéresse plus particulièrement l’Argentine, ont été ponctuels. Il faut attendre les années 2010 pour voir émerger certains champs de recherche plus significatifs en dehors de la capitale et de la province de Buenos Aires, notamment sur Santa Fe, Bahía Blanca ou Córdoba.
Dans le cas des travaux sur le Nord-Est de l’Argentine, il faut plutôt attendre la seconde moitié de cette décennie, voire les années 2020. Cela peut notamment s’expliquer par un moindre nombre de chercheurs sur place, mais le contraste avec la mise en place de politiques locales de gestion du passé dictatorial dès 1985 interpelle. Par ailleurs, on constate que les travaux publiés portent sur le Nord-Est et non sur le Chaco exclusivement. Ils portent donc aussi sur Corrientes, Misiones et Formosa. Le fait est que cette province d’un peu plus d’un million d’habitants est une des provinces nées au XXème siècle, plus précisément en 1953 (Maeder, 2012, pp. 221-238), lorsqu’elle a été « séparée » des provinces voisines, Formosa et Misiones, à l’aune d’un nouveau découpage administratif. Il est évident que le Chaco n’est pas né en 1953 et de fait ce nom fait aussi référence à des territoires des pays voisins, notamment la Bolivie et le Paraguay et a été au cœur d’une des dernières grandes guerres opposant des pays d’Amérique du Sud au XXème siècle. Le Chaco est donc une province qui s’inscrit dans l’histoire nationale argentine, mais qui a aussi des spécificités dans les liens qu’elle noue avec les pays voisins, géographiquement plus proches que la capitale argentine.
Lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux politiques publiques mises en place par la province du Chaco à propos de la violence étatique du régime de 1976-1983, l’analyse du poids des politiques nationales nous permet d’interroger la temporalité des unes et des autres. Il s’agit alors de savoir comment elles s’alimentent, si elles se contredisent et/ou se complètent. Cet article est une première approche d’un travail plus large sur un outil du pouvoir local, la Commission Provinciale pour la mémoire du Chaco[1]. Cette dernière est une des trois commissions qui existent au niveau provincial. Celles de la province de Buenos Aires et de Córdoba sont situées dans des provinces clefs du paysage politique et social argentin. Le fait qu’une telle instance existe dans une province qui est plus éloignée et semble avoir moins de poids politique interroge sur les processus de mise en place de politiques publiques liées au passé dictatorial.
Dans le cadre de cet article, nous souhaitons nous intéresser plus particulièrement à la création de cette commission en 2005. En analysant le dossier législatif[2] de la loi N°1412-A (anciennement Loi 5582) de la chambre des députés de la province du Chaco, il s’agit de voir quels sont les précédents présentés par les législateurs du Chaco pour soutenir, faire avancer et créer la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco (CPMC). L’objectif sera alors, pour cette première étape de la recherche, de voir dans quels cadres politiques et législatifs s’est ancré plus particulièrement l’outil qui a la charge, aujourd’hui, d’« enquêter, de reconstruire et de faire connaître la vérité historique des faits qui se sont produits et leurs conséquences sur la réalité actuelle » en lien avec « les années de la dictature militaire, l’autoritarisme et le terrorisme d’État », comme le stipulent les articles 1 et 2 de la loi. L’analyse de ce processus de création nous permettra de revenir sur certains mécanismes de la construction de politiques publiques de mémoire à échelle locale en Argentine. Il s’agira de voir, notamment, comment elles s’insèrent dans le jeu politique local et dans quelle mesure ces politiques se construisent à l’aune de différentes échelles.
- Politiques de réconciliation et droit à la vérité
L’Argentine est un des pays qui se démarque par la mise en place de politiques publiques liées au passé dictatorial dès la sortie du régime autoritaire. Le premier président du retour d’un régime démocratique, Raúl Alfonsín, issu du parti Unión Cívica Radical (UCR), crée deux éléments fondateurs : la Commission Nationale pour la Disparition de Personnes en 1983 (CONADEP, 1984) et le procès, en 1985, aux dirigeants de trois des Juntes qui ont gouverné le pays pendant la dictature. Les conclusions de la commission et du procès ont permis d’établir que ceux qui ont gouverné l’Argentine entre 1976 et 1983 sont bien à l’origine d’une répression systématique et massive qui a tué, fait disparaître et emprisonné des milliers d’Argentins. Depuis, en dépit d’orientations politiques différentes, les questions liées au passé dictatorial ont toujours fait l’objet de politiques publiques en Argentine.
Suite à ces premiers résultats, le gouvernement de Raúl Alfonsín, confronté à une grande instabilité politique, économique et sociale, mais aussi dans l’optique d’avancer vers le processus de reconstruction démocratique, fait voter deux lois, la loi dite de Point Final (Punto Final) et celle dite de Devoir d’Obéissance (Obediencia debida) en 1986 et 1987, qui limitent très fortement la possibilité d’entamer des procédures judiciaires à l’encontre des responsables des crimes commis pendant la dictature. Les associations de défense des droits humains et de victimes qui militaient alors largement pour que justice soit rendue et pour connaître « la vérité », se trouvent alors limitées dans leurs actions. L’arrivée au pouvoir en 1989 de Carlos Menem et la publication de décrets en 1989 et 1990 permettant aux personnes condamnées avant les lois dites de Point Final et de Devoir d’Obéissance de sortir de prison, pousse la plupart de ces acteurs à recentrer leur travail sur le travail de « Mémoire ». Il s’agit à diverses échelles de faire en sorte que le passé dictatorial ne disparaisse pas de l’espace public argentin en multipliant les actions : manifestations emblématiques comme celles du 24 mars ou la marche de la Résistance en décembre de chaque année, pose de plaques, monuments à échelle locale (notamment dans des quartiers), publications d’ouvrages, de films, témoignages dans des écoles et tous types d’espaces publics.
Dans ce contexte, il convient néanmoins de souligner que le volet judiciaire n’est pas oublié et les tentatives d’actions, même limitées, se poursuivent. Nous ne pouvons revenir sur toutes ces actions, mais nous souhaiterions nous arrêter sur l’articulation entre « Justice » et « Vérité » qui va être au centre d’actions significatives pendant le second mandat de Carlos Menem. Carlos Menem ancre ses politiques liées au passé dictatorial dans le cadre d’un discours autour de la notion de « réconciliation nationale ». Dans le contexte militant argentin, ce discours s’opposait clairement à la revendication des victimes et des proches qui ne déclaraient « ni oubli, ni pardon ». Le président, mettant d’ailleurs en avant sa légitimité en tant que victime, puisqu’il a été emprisonné pendant la dictature, insistait sur la volonté du peuple argentin d’avancer. Il va ainsi faire voter des lois de réparations économiques qui seront acceptées de manières très diverses par les familles et victimes. Pour certaines, il s’agit d’une reconnaissance du préjudice, pour d’autres, il s’agit du « prix du sang » (Tahir, 2015 : 154). Parallèlement, à partir de 1995, des membres des Forces Armées, déclarent dans les médias avoir participé à la répression. La figure la plus connue est celle d’Adolfo Scilingo qui déclarera avoir participé à des « vols de la mort » : dans son cas il s’agissait d’une trentaine de personnes jetées vivantes, depuis un avion, dans la mer (Verbitsky, 1995). Par ailleurs, en 1998, Carlos Menem propose de détruire l’École de Mécanique de la Marine (ESMA), pour y construire un parc de la mémoire (Feld, 2024). Ce lieu, qui était alors encore un centre de formation de la Marine, a été pendant la dictature le centre clandestin de détention le plus important de tout le pays (Feld & Franco, 2022). Les associations de défense des droits humains, les familles et les victimes vont s’y opposer, notamment parce que l’ESMA pouvait encore abriter des preuves des crimes commis pendant la dictature et constituer une preuve judiciaire. Ainsi, ces acteurs, malgré les lois d’amnistie, n’abandonnent pas l’idée de poursuites judiciaires à l’encontre des responsables des crimes commis pendant la dictature. Grâce, notamment, au travail d’une organisation de défense des droits humains en particulier, le Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), qui œuvre depuis la période dictatoriale pour l’élaboration d’outils juridiques pérennes afin de poursuivre les responsables des crimes commis pendant la dictature, des actions autour du « droit à la vérité » vont voir le jour. Ce sera notamment le cas des « Procès pour la Vérité » qui vont se multiplier dans plusieurs points du pays (Andriotti Romanin, 2013). Ces espaces, sans conséquences pénales, permettaient de poursuivre les démarches dans un contexte où les procédures judiciaires étaient très limitées suite aux votes des lois dites de Point Final et d’Obéissance due. Ils seront une opportunité pour placer sur le devant de la scène les proches des détenus-disparus et les victimes, mais aussi, lorsqu’ils accepteront de parler, les responsables des crimes commis (Da Silva Catela, 2001). Ils constituent des sources d’informations significatives dans la reconstruction des faits.
Enfin, à partir de 2003 et l’élection de Néstor Kirchner à la présidence de la République, les politiques publiques liées au passé dictatorial prennent de plus en plus d’ampleurs. Parmi les éléments les plus marquants, on peut citer la déclaration de nullité des lois dites de Point de Final et de Devoir d’Obéissance en 2003 par le Congrès argentin (CELS, 2004) et la déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour Suprême, le 13 juillet 2007, des grâces présidentielles octroyées par Carlos Menem. Ces éléments ouvrent la porte à de nouvelles procédures judiciaires qui vont se multiplier dans tout le pays. Ainsi, les anciens centres clandestins de détention, tels que l’ESMA, peuvent être utilisés comme preuves matérielles dans le cadre de ces procédures et les revendications de récupération de ces lieux prennent en conséquence d’autant plus d’ampleur[3]. Pendant douze ans avec Néstor Kirchner (2003-2007) et Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), le gouvernement fédéral se réclame partie prenante de la lutte des associations de droits humains et des victimes mais aussi de l’action de militants de gauche et d’extrême-gauche, pour beaucoup détenus-disparus. Le gouvernement suivant, celui de Mauricio Macri (2015-2019) donnera un coup de frein à cette dynamique en réduisant les financements des politiques liées au passé dictatorial, a contrario le mandat d’Alberto Fernández (2019-2023) verra reprendre les politiques mises en place entre 2003 et 2015. Avec l’arrivée de Javier Milei au pouvoir en 2023, les enjeux autour de la « Vérité » reviennent sur le devant de la scène avec la remise en question des actions précédemment menées et la volonté de présenter « toute la vérité » aux Argentins.
Ce bref parcours, nous permet de voir que le passé dictatorial est l’objet de politiques publiques au niveau national en Argentine depuis la sortie de la dictature. Ces politiques ont bien entendu eu un impact sur tout le territoire, mais dans un État fédéral, il convient de s’intéresser aussi aux politiques provinciales pour voir dans quelle mesure elles se sont inscrites dans une même dynamique ou pas.
- Le passé dictatorial dans la province du Chaco
La répression dictatoriale dans le Chaco s’inscrit dans le cadre de l’organisation administrative mise en place par les Forces Armées. La province appartenait à la zone II au même titre que les provinces voisines de Formosa, Corrientes et Misiones[4]. Si nous nommons ces provinces en particulier, c’est parce qu’elles ont une frontière avec un pays voisin. En conséquence, Elles font l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre de deux dispositifs. Tout d’abord, le Plan Condor qui était une collaboration entre gouvernements dictatoriaux du Chili, Bolivie, Paraguay, Brésil, Uruguay et Argentine pour traquer, détenir et assassiner des opposants politiques qui tenteraient de s’échapper. Ensuite, dans le cadre de la Contre-offensive de l’organisation armée Montoneros[5] qui entraîne le retour d’exil d’une centaine de ses militants, notamment par le passage frontalier de Paso de los Libres dans la province de Corrientes (Mumbach, 2022, pp. 121-143). Ainsi, dans ce nord-est argentin, la répression n’a pas été massive, mais plutôt ciblée, elle s’est focalisée sur certains lieux et certains acteurs[6]. Par ailleurs, il convient de faire référence aux Ligas Agrarias, nées dans les années 1970, dans le Chaco, et qui se sont par la suite développées dans les provinces voisines. Ces organisations regroupaient des agriculteurs de petites et moyennes exploitations qui souhaitaient s’opposer aux grands propriétaires terriens et à la concentration de la terre. Elles étaient perçues par les autorités militaires comme des organisations subversives contre lesquelles il fallait lutter. Elles ont été très largement réprimées pendant la dictature (Calvo, 2022 : 199-226 ; Peppino, 2024).
Par ailleurs, si l’on parle de répression dictatoriale dans la province du Chaco, il faut mentionner ce qui est appelé le Massacre de Margarita Belén. Le 13 décembre 1976, un groupe d’une dizaine de personnes est assassiné à 15 kilomètres de la capitale du Chaco, Resistencia, sur la route qui mène à la ville de Margarita Belén. Les personnes assassinées appartenaient à des organisations sociales, notamment à l’organisation armée Montoneros. Le Massacre de Margarita Belén constitue ce que nous pourrions appeler un « évènement critique » pour reprendre la catégorie de Veena Das (Das, 1997), dans le sens où il constitue un marqueur pour les récits (Giles, 2003) et les débats pour la mémoire dans le Chaco (Fule, Zeitler, 2022). Un des éléments les plus significatifs est que ce Massacre a fait partie des faits choisis par le procureur dans le cadre du Procès aux Juntes en 1985 pour prouver le caractère systématique de la répression pendant la dictature. La couverture médiatique du procès a permis de placer la répression dans le Chaco dans le récit national. Dans la province, le militantisme mémoriel autour du Massacre de Margarita Belén joue un rôle important. En effet, suite au vote de la loi numéro 3085-E du 20 novembre 2019, le 13 décembre devient le « Jour Provincial de la Mémoire pour la Vérité et la Justice », « en souvenir des victimes du Massacre de Margarita Belén ». En 1986 est inauguré une fresque dans un amphithéâtre de la Faculté d’Humanité de la Universidad Nacional del Nordeste à Resistencia intitulée « Argentina, dolor y esperanza » qui fait clairement référence au Massacre, mais plus largement à la répression dictatoriale dans la province et dans l’ensemble de l’Argentine[7]. Enfin, en 1997, sur le lieu où ont été fusillées la dizaine de personnes, un monument est inauguré. Ce dernier n’a pas été exempt de polémiques, notamment de par son éloignement de la capitale, mais il joue aujourd’hui un rôle significatif puisqu’il est le point de chute de la marche commémorative du 13 décembre.
Concernant les politiques publiques mises en place par la chambre des députés de la province du Chaco, nous souhaitons mentionner un point de départ fondamental : la création de la Commission des Droits Humains le 17 mai 1984 avec la loi 2971 de la législation de la Province du Chaco. Cette Commission avait pour objectif d’enquêter et de documenter les violations des droits humains qui s’étaient produites pendant la dernière dictature. Le 2 octobre 1985, les législateurs du Chaco votent le « Rapport final » de cette Commission qui a servi par la suite de base aux procédures judiciaires qui vont s’ouvrir à partir de l’année 2005[8]. Ainsi, les législateurs de la province entament une dynamique proche de celle du gouvernement national avec la Commissions Nationale pour la Disparition de Personnes (CONADEP) et le procès aux Juntes, alors que le gouvernement du Chaco se trouve à l’opposé de l’échiquier politique national[9]. Ainsi, dans ces premières étapes, et sans préjuger des suivantes, on constate que le passé dictatorial dans le Chaco fait l’objet d’une politique publique spécifique qui peut être perçue soit comme un accompagnement ou un complément des politiques nationales, soit comme une volonté d’affirmation des spécificités locales au regard de l’histoire nationale. En nous intéressant à une période plus récente et à la création de la Commission Provinciale pour la Mémoire en 2005, nous souhaitons tenter de mettre en lumière cette articulation lors de la période charnière dans les politiques publiques liées au passé dictatorial au niveau national avec l’arrivée de Néstor Kirchner au pouvoir en 2003.
- La Commission provinciale pour la Mémoire (CPMC) : le projet et la loi
Déposé en juillet 2003, dans un contexte de sortie très progressive de la crise économique, politique et sociale qui a frappé l’Argentine en 2001, le projet de loi 1008/03 de la Chambre des députés du Chaco souhaite « créer la Commission Provinciale pour la Mémoire pour enquêter, reconstruire et faire connaître la vérité historique sur les faits qui se sont déroulés pendant la dictature militaire et établir ses objectifs »[10]. Dans le dossier législatif qui accompagne les débats qui aboutiront à l’adoption de la loi en 2005, on peut trouver plusieurs éléments qui permettront au porteur du projet, Daniel Alberto San Cristobal[11], de faire valoir la validité d’une telle loi. Ils sont issus de plusieurs échelles (Gensburger, 2023, p. 133).
Une figure importante dans le dossier est Eduardo Aníbal Moro[12]. En effet, dans le dossier du projet de loi, on trouve une lettre datée du 12 novembre 2003 de Moro, alors Sénateur, pour soutenir le projet de création de la CPMC. Dans son courrier, le Sénateur fait avant tout valoir « le droit à la vérité », « le droit à la justice » et le « droit à la réparation ». Il mentionne aussi « le devoir de mémoire » et « le droit à l’information ». Il insiste sur la nécessité d’un tel projet, mais pour lui donner plus de force, il pense qu’il faudrait y ajouter « "un glossaire" qui devrait inclure les définitions des principes […] et une clause qui admette leur actualisation en lien avec l’évolution des définitions que produisent les organisations de droits humains de l’ONU ». Ainsi, Moro fait référence à un cadre supranational pour justifier de l’utilité d’une telle loi. Il signale même que cela rendrait le projet « très "présentable" internationalement ». Ainsi, ce qui prévaut dans ce soutien, ce n’est pas tant le cadre argentin, mais le cadre international. La lettre est accompagnée dans le dossier de textes de l’ONU pour renvoyer à un cadre législatif supranational et rappeler les conventions ratifiées par l’État argentin. Cela permet de placer la création de la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco dans un cadre qui sort des frontières de la province et de l’Argentine.
Cependant, Moro n’est pas n’importe quelle figure politique du Chaco. En effet, entre 1997 et 2001, il a été Président de la Chambre des députés du Chaco. Pendant son mandat, il a déposé un projet de loi de création d’un « Registre Unique de la Vérité » en mars 2001. Il s’agissait de créer « une base de données unifiée qui réunirait les informations obtenues, jusqu’à cette date et par la suite, autour des faits relatifs aux victimes de disparitions forcées, d’assassinats, de substitution d’identité et autres violations des droits humains comme conséquence de l’action répressive déployée pendant la période mentionnée à l’article 1 », c’est-à-dire entre le 24 mars 1976 et le 10 décembre 1983[13]. Les éléments présentés pour soutenir ce projet de loi sont des conventions internationales, comme la Convention Interaméricaine sur la Disparition Forcée de Personnes[14], mais surtout le cadre national avec les lois et décrets dits de réparation mis en place à partir des années 1990[15]. La proposition de loi insiste dès le premier article sur « le droit pour tous les membres de la communauté de connaître la vérité ». Dans la lignée des « Procès pour la Vérité », ces initiatives se veulent un rempart contre les très fortes limitations imposées aux procédures pénales. Il s’agit de poursuivre le travail de « Vérité », en travaillant à la reconstruction des faits et à l’élaboration de politiques publiques autour du passé dictatorial.
Le projet de loi déposé par Moro part donc de textes législatifs nationaux et internationaux, mais aussi d’autres actions qui mobilisent de nombreux acteurs en Argentine au même moment, même si leurs objectifs sont différents. La première est le projet de députés du Parti Justicialiste en 1998 de vote d’une « loi de la Vérité »[16]. Un des éléments de ce projet de loi qui n’aboutira pas est la création d’un « Registre Unique de la Vérité » qui regrouperait le matériel collecté par la CONADEP et par le « Registre des personnes Décédées et Disparues » (Redefa)[17]. Pour l’un des porteurs du projet, Mario Cafiero, il s’agit « d’obtenir la pacification nationale »[18]. Ce projet s’inscrit dans la lignée des discours du gouvernement national de l’époque, celui de Carlos Menem, qui prêche pour une « réconciliation » et qui, la même année, proposera la destruction de l’ESMA pour y construire un parc. Il y a donc un précédent à la Chambre des députés au niveau national et il fait partie des antécédents mentionnés dans le cadre du projet de Moro. Par ailleurs, le projet présenté en 2001 à la chambre des députés du Chaco fait référence à un autre élément, cette fois judiciaire, et bien plus proche dans le temps. Le 6 mars 2001, le juge Gabriel Cavallo, dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à l’enlèvement d’une enfant, Claudia Victoria Poblete Hlaczik, déclare l’inconstitutionnalité des lois dites de Point Final et de Devoir d’Obéissance. Le juge soutient que le crime qui a été commis à l’encontre de l’enfant ne peut être délié de celui commis à l’encontre de sa mère qui a accouché en captivité. Cette déclaration ouvrira de nombreuses portes en Argentine et contribuera à la déclaration de nullité des deux lois en 2003 ce qui permettra la réouverture de toutes les procédures judiciaires en lien avec la répression dictatoriale à partir de 2005. Dans le cadre du projet de celui qui est alors député du Chaco, Eduardo Aníbal Moro, cette décision est un point de bascule et lui permet de finaliser le projet sur les fondements suivants :
« Le présent Projet prétend être un apport de plus dans la défense des Droits Humains, dans le cadre du processus, toujours perfectible, que la démocratie argentine a entamé en 1983. Ce dernier vient de recevoir une importante décision judiciaire et ne s’épuisera pas à l’avenir tant qu’il s’agit d’enrichir la vérité, la justice et la mémoire nationale. Le 24 mars, 25 ans se seront écoulés depuis le dernier coup d’État militaire. Il me semble donc nécessaire et opportun de promouvoir une telle initiative. »[19]
Ainsi, le projet de « Registre Unique de la Vérité » se fonde sur plusieurs échelles et va constituer, un précédant local significatif pour le projet de création de la Commission Provinciale pour la Mémoire. Ce projet n’aboutira pas, mais il sera de fait en partie repris dans le projet de création de la CPMC présenté le 3 décembre 2003 avec l’ajout d’un « Registre Unique de la Vérité » dans l’article 3.
Une autre échelle qui va servir de précédant au projet du député Daniel San Cristobal est elle aussi locale, mais elle sort du cadre du Chaco, puisqu’il s’agit d’une institution rattachée à la province de Buenos Aires. En septembre 2000 est créée la Commission Provinciale pour la Mémoire (CPM) de La Plata. Cette commission constitue un précédant important puisqu’il s’agit d’une structure locale et le cadre législatif est celui de la province de Buenos Aires. Elle est donc une sorte de modèle pour le cas du Chaco puisque, même si la province de Buenos Aires joue un rôle national fondamental, elle n’est pas l’émanation d’une législation au niveau national. L’organisation, la gestion de cette entité se régit au niveau de la province. Parmi les actions mises en avant au moment sa création, il y a notamment le soutien au Procès pour la Vérité de La Plata, nouant ainsi un lien avec le projet présenté par Moro au nom du « droit à la Vérité ». Les missions de la Commission se penchent sur plusieurs questions : archives, enseignement, communication, poursuites judiciaires, la création d’un site physique et d’autres.
Toutes ces missions se retrouvent dès le premier projet de la CPMC présenté le 1er juillet 2003 dans les articles 2, 3 et 4. Dans le cadre d’un entretien, réalisé en 2018, Daniel San Cristobal explique que la CPM de La Plata a aussi été une inspiration importante parce qu’elle était constituée de membres d’organisations de droits humains et de victimes, mais aussi de législateurs de la province de Buenos Aires. Pour lui, ce dernier point permettait d’obtenir le soutien de la UCR, un parti auquel s’opposait son parti, le Frente Grande[20], politiquement. Une des figures les plus importantes alors du radicalisme était justement le député Eduardo Aníbal Moro. En s’appuyant sur son précédent projet, mais en introduisant aussi l’idée que la direction de la Commission Provinciale pour la Mémoire ne serait pas exclusivement aux mains des organisations des droits humains et de victimes, San Cristobal souhaite obtenir le soutien d’un spectre politique le plus large possible. Lorsqu’il dépose son projet de loi, en juillet 2003, Néstor Kirchner vient de gagner les élections présidentielles.
Parmi ses premières actions, il multiplie les rapprochements envers des associations de droits humains et de victimes, telles que l’Association des Mères de la Place de Mai, les Mères de la Place de Mai Ligne Fondatrice et les Grands-mères de la Place de Mai, laissant entendre que les politiques publiques liées au passé dictatorial ne suivront pas la même dynamique que lors des gouvernements antérieurs. Selon San Cristobal, le péronisme du Chaco était plutôt « de droite » et alors qu’il prépare le projet de loi, il pense surtout à convaincre les membres de la UCR. L’arrivée de Kirchner et l’évolution de ses politiques au regard du passé dictatorial, lui laisseront entendre qu’il pourra compter sur une partie du péronisme du Chaco dans ces débats et de fait San Cristobal rejoindra le Frente para la victoria de Kirchner pour les élections de mi-mandat en 2005[21]. Sans rentrer dans les détails du jeu politique du Chaco, nous constatons que le projet de loi sur la Commission Provinciale pour la Mémoire fait l’objet de tractations au même titre que d’autres débats de la sphère publique locale.
Dans ce sens, un des derniers points ajoutés au projet de loi, à l’approche du vote en 2005, est assez révélateur de ces tensions. Dans le premier projet de loi, article 9, il était fait mention d’un « lieu physique et infrastructure adéquates pour la réalisation [des] missions » de la CPMC fournis par le Pouvoir Exécutif de la province du Chaco. L’institution devait par ailleurs avoir à sa charge un site qui figurait dans l’article 2, point f. Les contours de ce site ne sont pas mentionnés : musée pour la mémoire, monument, espace, plaque, etc. On observe que dans tous les documents qui figurent dans le dossier du projet, il n’est fait mention que d’un lieu. Il s’agit de l’ancien siège de la Brigada de investigaciones qui a servi de centre clandestin de détention entre mars 1976 et début 1978. Situé en plein centre-ville, juste à côté du siège du gouvernement de la province du Chaco, dans la capitale, Resistencia, ce lieu a été l’objet de nombreuses luttes des organisations de droits humains et de victimes. Il a rapidement constitué un point de chute pour toutes les commémorations et réclamations de ces organisations au nom de Mémoire, Vérité et Justice. C’est à partir de décembre 2003 suite au travail de la Commission des Droits Humains de la Chambre des députés du Chaco que l’on voit apparaître un nouveau projet de loi avec un article 9 qui mentionne clairement comme siège de la CPMC, le local situé dans la rue Marcelo T. Alvear au numéro 32, soit l’adresse de l’ancien siège de la Brigada de investigaciones (Tahir, 2015, article). On constate cependant qu’il y a un ajout qui précise que le lieu peut être le local en question « et/ou un bâtiment que le Pouvoir Exécutif désignera à cet effet et à cette fin », laissant entendre que l’ancienne Brigada ne sera pas nécessairement le siège[22]. Il faut attendre une date bien plus proche du vote, en mai 2005, pour voir apparaître dans le dossier, un courrier signé par plusieurs membres d’organisations des droits humains et de victimes pour réclamer que le local de la rue Marcelo T. Alvear soit le siège de la CPMC. Pour soutenir cette demande, les membres de ces organisations précisent, en gras que : « Ce lieu représente dans notre province ce qu’au niveau national représente l’ESMA, où se trouve actuellement le Musée de la Mémoire, au sein de laquelle la Commission dirigeante est exclusivement intégrée par des membres des Organisations des Droits Humains »[23]. Ils font donc référence à un lieu emblématique au niveau national (Feld, 2024) pour soutenir leur revendication et ainsi souligner que seul ce lieu peut être le siège de la CPMC. L’emblème national, « récupéré » et « redonné » symboliquement par le président Kirchner en 2004 (Feld, 2024), constitue alors un précédent qui justifie la « récupération » de l’ancien centre clandestin de détention à Resistencia. À partir de cette date, on voit apparaître dans les différents projets de loi le fait que le siège de la CPMC sera l’ancien centre clandestin de détention. Cela aboutit à l’article 6 de la Loi N°5582 du 17 août 2005 dans lequel est signalé :
« Le Pouvoir Exécutif National, dans un délai de douze (12) mois, devra donner pour le fonctionnement de la Commission Provinciale pour la Mémoire, le bâtiment qui a été déclaré Patrimoine Culturel de la Province du Chaco par le Décret N°1951/04, situé dans la Rue Marcelo T. Alvear N°32, identifié comme Ilot Urbain 119 – Parcelle 8 – Circonscription I – Section 8 – Ville de Resistencia – Département San Fernando. Par ailleurs, la Commission Interministérielle des Droits Humains de la Province du Chaco, fonctionnera dans le même bâtiment. »
Il est intéressant de voir que ce n’est finalement pas tant son ancrage et son histoire dans les mobilisations des organisations de droits humains et de victimes du Chaco depuis la fin de la dictature qui permet de soutenir la réclamation de localisation de la CPMC dans ce lieu (Tahir, 2015). Au bout du compte, c’est le précédent de l’ESMA, au niveau national, qui assoit définitivement le choix du site et retire l’option qui figurait dans le projet de 2003 qui permettait au gouvernement de la province de situer la CPMC dans un bâtiment de son choix. On peut donc estimer que les membres des organisations des droits humains et de victimes ont obtenu gain de cause, mais, pour autant, un autre pan de leur courrier n’a pas été pris en compte. En effet, ces derniers indiquent que la « Commission dirigeante » de l’ESMA « est exclusivement intégrée par des membres des Organisations des Droits Humains », laissant entendre qu’il ne doit y avoir de personnes tierces. Or, dès le premier projet, dans la composition de la CPMC figurent des membres du pouvoir exécutif du Chaco et des législateurs. Ainsi, dans le premier projet en juillet 2003, article 5, il est indiqué que « La Commission sera intégrée par trois (3) législateurs et huit (8) personnes représentatives avec une trajectoire reconnue dans le cadre politique, académique, syndical, des mouvements sociaux et des droits humains ». Le texte définitif aboutit à « deux (2) représentants du pouvoir exécutif, un en représentation du Secrétariat des Droits Humains et un autre du Ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie, deux (2) législateurs en représentations du Pouvoir Législatif, un (1) représentant désigné par le Pouvoir Judiciaire et cinq (5) représentants des organisations de Droits Humains avec personnalité juridique d’ex-détenus, de proches de détenus et disparus et d’enfants de détenus de la dernière dictature militaire qui peuvent prouver cette condition/ce statut », article 4. On constate donc que les choses ont beaucoup évolué. Cela se perçoit aussi au sein de l’organe directeur et exécutif de la CPMC qui dans le premier projet, article 5, devait être constitué de trois des membres de la Commission, alors que dans un des derniers projets, article 4, le nombre augmente à 5 et la répartition est précisée de la sorte : « un (1) représentant du Pouvoir Législatif, le représentant du Pouvoir Judiciaire et trois (3) représentants des organisations des Droits Humains, citées précédemment ».
En deux ans, la constitution de la CPMC et de son comité directeur s’est étoffée, mais surtout elle s’est professionnalisée et politisée. En effet, l’exécutif provincial entre dans la composition de la CPMC, même s’il ne fait pas partie du Comité directeur. Le Comité directeur, lui, inclut nécessairement un législateur et le pouvoir judiciaire est inclus dans la CPMC. Enfin, les représentants du mouvement des droits humains et des victimes doivent être rattachés à des organisations sociales avec un statut juridique. Ils ne peuvent pas être simplement rattachés à des corps ou groupes indéfinis ou se prévaloir uniquement d’un lien direct avec les conséquences du passé dictatorial, et cela même s’ils peuvent prouver cette condition. En d’autres termes, ils ne peuvent pas « juste » être des personnes « affectées »[24] de la dictature, pour reprendre la catégorie d’Elizabeth Jelin (Jelin, 1995).
Conclusion
Dans l’entretien qu’il nous a accordé Daniel San Cristobal parle beaucoup d’un « travail solitaire » dans l’élaboration du projet de loi portant sur la création de la CPMC. Il insiste sur le fait qu’il a voulu réaliser un travail « consensuel » en prenant en compte à la fois les organisations de droits humains et aussi le plus large spectre politique au sein de la province du Chaco. Il souligne surtout qu’il est l’auteur de tous les changements entre le projet déposé en juillet 2003 et celui voté en août 2005. Ainsi, le dossier législatif et la loi sont le fruit de négociations menées avec de nombreux acteurs, comme cela a été évoqué, mais surtout à plusieurs échelles. Si l’échelle internationale est mentionnée rapidement, c’est pour mieux nous renvoyer à l’échelle locale ou nationale. On constate aussi que le temps long de la politique à l’échelle nationale pèse de tout son poids et contribue à affiner le projet que ce soit avec la décision du juge Cavallo en 2001 ou avec les actions mises en place par le gouvernement de Néstor Kirchner après 2003. Le projet local s’insère dans un jeu d’échelles temporelles et spatiales qui lui permet de gagner en légitimité. Et c’est aussi, parce qu’il fait valoir des points d’ancrage et une mise en place de dynamiques proches de celles qui prévalent à l’échelle nationale qu’il justifie sa raison d’être. Ainsi, les politiques publiques mises en place dans le Chaco dès 1985 ne suffisent pas pour comprendre et légitimer cette instance qui aujourd’hui travaille sur des faits ayant eu lieu dans le Chaco et ses provinces voisines.
Avec la création de la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco en 2005, nous avons souhaité mettre en lumière certains mécanismes qui permettent d’observer la construction de politiques publiques de mémoire à échelle locale en Argentine. Un des aspects qui nous a semblé particulièrement intéressant est l’articulation dans le jeu politique local entre les différents acteurs qui a permis d’aboutir à la loi créant la CPMC. La mise en place de cette législation autour de la mémoire a impliqué un fonctionnement politique que l’on pourrait qualifier de « classique ». Il y a eu de nombreuses discussions et concessions pour finalement aboutir au vote de la loi. En Argentine, les questions liées au passé dictatorial ne semblent pas échapper au jeu politique qui s’applique à d’autres sujets à l’instar de ce que disent Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, les politiques de mémoire sont devenues « des politiques comme les autres » (Gensburger, Lefranc, 2017 : 133). Cette première analyse du cas du Chaco, province éloignée de la capitale et peu peuplée à l’échelle argentine, nous a permis de voir que les disputes à propos du passé dictatorial œuvrent avec des échelles concurrentes et/ou complémentaires. Un des axes qu’il conviendra de développer dans la poursuite de cette étude sera de rechercher des caractéristiques nationales et/ou locales, propre à l’Argentine et à la province du Chaco, qui permettront de mettre en lumière des fonctionnements spécifiques.
Notes de fin
[1] Le travail présenté dans cet article est issu d’une recherche en cours. Il s’agit de s’intéresser aux législations mises en place dans la province du Chaco autour du passé dictatorial (1976-1983). Il s’agit de savoir comment se sont construites ces politiques au sortir de la dictature et dans quelle mesure elles contribuent au jeu politique local. Dans ce sens, le poids des politiques nationales et des dynamiques à cette autre échelle nous semble être un axe significatif.
[2] Le dossier législatif regroupe les différents projets de loi et finalement la loi qui a été votée par les députés de la province du Chaco. On y trouve aussi des documents déposés par le ou les porteurs de projet pour justifier du projet ou des modifications apportées. Il s’agit de précédents qui permettent de justifier du bien-fondé de cette future loi. Ce dossier figure dans les archives de la Chambre des députés de la province du Chaco. Nous avons pu obtenir une copie par l’intermédiaire de Daniel San Cristobal, porteur du projet en 2003. Dans le cas de la création de la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco, le dossier n’est pas numéroté, il est constitué de 188 pages. Ainsi, nous ne pourrons donner les pages des documents cités.
[3] Il convient de signaler que les réclamations autour des lieux qui ont servi de centres clandestins de détention commencent, dans certains cas, au sortir de la dictature. Dans les années 1980 et surtout 1990 avec les fortes limitations pour les procédures judiciaires, il s’agit surtout de préserver des preuves matérielles des crimes commis. Des enjeux mémoriels vont ensuite émerger et vont prendre des formes différentes en fonction du lieu et des acteurs impliqués : associations de défense des droits humains, de victimes, de proches de détenus-disparus, mais aussi des voisins du quartier dans lequel se situe l’ancien centre clandestin de détention. Nous verrons dans ce travail le cas de l’actuel siège de la Commission Provinciale pour la Mémoire.
[4] Pendant la dictature, les Forces Armées divisent le pays en cinq zones, elles-mêmes divisées en sous-zones. La province du Chaco appartient à la zone II dans laquelle on trouve les provinces citées, mais aussi les provinces de Santa Fe et Entre Ríos.
[5] Organisation armée péroniste fondée en 1970, elle devient en 1974, la seule organisation armée de gauche péroniste. Elle sera décimée par la répression dictatoriale et notamment lors du retour clandestin d’un certain nombre de ses militants en 1979. Cette initiative a été appelée la « Contre-offensive ».
[6] Les travaux sur la répression dictatoriale et les constructions mémorielles autour de ce passé dans le Nord-est argentin sont encore récents. Il s’agit surtout de travaux collectifs qui font dialoguer des textes à propos des quatre provinces : Chaco, Corrientes, Misiones et Formosa.
[7] Cette action a été à l’initiative d’étudiants de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), plus importante université publique du Chaco et de Corrientes. Ils ont proposé la réalisation d’une fresque en mémoire des victimes du Massacre de Margarita Belén dans l’Aula Magna de la Faculté d’architecture à Resistencia. La fresque a été commandée à l’artiste locale Amanda Mayor de Piérola, mère de Fernando Piérola, un des étudiants assassinés le 13 décembre 1976. La fresque a été inaugurée le 15 août 1986. Elle représente, selon l’artistes, les deux Argentines, celle de la douleur, avec des scènes de torture, mais aussi celle de l’espoir, avec des dessins de familles se regroupant et d’enfants heureux à l’école. On constate donc la création d’un patrimoine matériel lié au passé dictatorial peu après 1983.
[8] À l’instar de ce qu’il va se passer dans le reste du pays, plusieurs procédures judiciaires à l’encontre des responsables des crimes commis pendant la dictature vont être ouvertes dans la province du Chaco. À Resistencia, les premières vont concerner le Massacre de Margarita Belén.
[9] En 1983, Raúl Alfonsín, membre de l’Union Civique Radical (UCR) gagne les élections présidentielles en Argentine et devient le premier président du retour de la démocratie. Dans la province du Chaco, Le gouverneur élu en 1983 a été Florencio Tenev, du Partido Justicialista (PJ). Bien qu’ils soient à l’opposé de l’échiquier politique, les deux hommes ont dû collaborer. En effet, la UCR et le PJ avaient exactement le même nombre de législateurs à la Chambre des députés du Chaco. Ainsi, Tenev devait constamment négocier avec la UCR. Ces négociations pouvaient aussi se dérouler à l’échelle nationale, notamment dans le cadre du budget alloué à la province ou des votes des Sénateurs du Chaco au niveau national. Un des axes de la recherche en cours s’intéresse particulièrement au poids des dynamiques locales de partis dans le vote des lois liées au passé dictatorial.
[10] Projet de loi 1088/03 du 3 juillet 2003 déposé par le député Daniel San Cristobal.
[11] Daniel San Cristobal est un militant politique du Frente Grande, un parti né en 1993 d’une césure du Parti Justicialiste. Il a été député de la province du Chaco à deux reprises : 2001-2005 et 2005-2009. Lors de l’entretien que nous avons réalisé en avril 2018, il signale qu’il n’est pas un proche de victime ou une victime de la dictature. Il précise qu’il a surtout pris conscience du bilan humain de la dictature à la sortie du régime lorsqu’il arrive à Resistencia pour faire ses études à l’Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) à la Faculté des Sciences Économiques. Il dit s’être impliqué dans les mobilisations pour soutenir le maintien de la fresque qui figure à la UNNE et qu’il a été militant étudiant dans des organisations syndicales et politiques de « gauche ». Enfin, il nous dit qu’il a participé régulièrement dans les années 1980 et 1990 aux marches du 13 décembre pour la commémoration du Massacre de Margarita Belén. Ainsi, s’il ne se définit pas comme un militant des droits humains, il insiste sur le respect qu’il a pour les organisations, notamment les Mères et les Grands-mères de la Place de Mai.
[12] Eduardo Aníbal Moro (1940-) est un homme politique du Chaco de la UCR. Il a été député de la province du Chaco entre 1991 et 1995, puis ministre de la Justice et du Travail du gouvernement du Chaco entre 1995 et 1997. Entre 1997 et 2001, il est président de la Chambre des députés du Chaco. En 2001, il devient Sénateur pour le Chaco. Ce mandat se finit de manière prématurée en 2003 avec les élections anticipées. Entre 2003 et 2007, il est vice-gouverneur de la province du Chaco. Il n’a depuis plus assumé de charge politique. Dans le cadre du projet qui a été déposé, il a donc eu différentes mandats.
[13] Projet de loi 173/01 sur la « création d’un Registre Unique de la Vérité » de la Chambre des députés du Chaco déposé le 9 mars 2001. Notre traduction.
[14] Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt quatrième session ordinaire de l'Assemblée Générale : https://elearning.icrc.org/detention/fr/story_content/external_files/Convention%20interam%C3%A9ricaine%20sur%20les%20disparitions%20forc%C3%A9es%20(1996).pdf , consultée le 10 mai 2025
[15] Les lois concernent aussi bien des compensations économiques pour les personnes victimes de disparitions forcées de personnes et leurs proches, que la reconnaissance même de la disparition forcée de personnes comme crime passible de poursuites judiciaires ou la création d’un registre des détenus-disparus. Loi 24410 du 30 novembre 1994, 24411 du 7 décembre 1994, 24499 du 14 juin 1995, 24823 du 7 mai 1997, Décret 403/95 du 29 août 1995 et Résolution 1745/99 du 19 août 1999.
[16] Vaudagnotto Sergio, « La "búsqueda de la verdad" está guardada en un cajón », Página 12, 23 juin 1998, https://www.pagina12.com.ar/1998/98-06/98-06-23/pag05.htm , consulté le 10 mai 2025.
[17] Le projet ne va pas aboutir alors, mais après plusieurs années et démarches, en 2014, sera créé le Registre Unifié des Victimes du Terrorisme d’État (RUTVE) : https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/ANM/rutve/historia , Consulté le 15 mai 2025.
[18] Op.Cit. Vaudagnotto.
[19] « Fundamentos » du projet de loi 173/01 de la Chambre des députés du Chaco, déposé le 9 mars 2001. Notre traduction.
[20] Nous ne pouvons rentrer dans le détail des dynamiques politiques du Chaco d’alors, car cela dépasse l’objet de cet article. Néanmoins, nous souhaitons souligner que le jeu politique nous semble être un élément important pour analyser les législations mises en place dans la province du Chaco à propos du passé de la dernière dictature (1976-1983). Dans le Chaco, depuis la fin de la dictature, il y a eu une alternance entre UCR et PJ, cependant dans les années 1990, l’émergence du Frente Grande amène les deux partis majoritaires à tenter de se rapprocher de cette coalition politique plutôt progressiste. À partir des années 2000, le Frente Grande commence à avoir des députés et il collaborera notamment avec la coalition portée par Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner au niveau national et par Jorge Capitanich au niveau de la province du Chaco.
[21] Dans l’entretien que nous avons réalisé avec Daniel San Cristobal, il insiste sur le fait que tout le projet a été « un travail très solitaire ». Il souligne qu’il a constamment cherché des soutiens de tous les partis politiques présents à la Chambre des députés du Chaco, notamment compte tenu des politiques menées au niveau national par l’administration de Néstor Kirchner. Ainsi, il dit avoir accepté tous les soutiens.
[22] Nouveau projet de loi retravaillé par la Commission des droits humains de la Chambre des députés du Chaco, réunie le 19 novembre 2003. Dossier législatif du projet de loi de création de la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco.
[23] Lettre au Président de la Commission de législation générale, de justice et sécurité, le député Eduardo Fabio Colombo, reçue le 3 mai 2005. Dossier législatif du projet de loi de création de la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco. La lettre n’est pas signée du nom des organisations. Les membres signent avec leurs noms et leurs numéros de carte d’identité. Cependant, le courrier commence par « les différentes organisations de droits humains de la province », laissant entendre que ces personnes signent au nom de l’organisation et non en leur nom propre.
[24] Elizabeth Jelin dans un article publié en 1995 sur le « mouvement des droits humains » argentin identifie deux groupes d’associations. L’un d’« affectés » qui regroupe les organisations de proches de détenus-disparus et un autre de « non affectés » qui était constitué d’organisations qui ne se définissaient pas par leur lien avec les détenus-disparus. Cette catégorie a longtemps servi dans les travaux en Sciences Humaines et Sociales autour du passé dictatorial, elle a aussi été tolérée, voire parfois reprise, par les organisations elles-mêmes.
Bibliographie
Alonso L. (2011). Luchas en plazas vacías de sueños. Movimiento de derechos humanos, orden local y acción antisistémica en Santa Fe. Prohistoria.
Andriotti Romanin E (2013). Memorias en conflicto. El movimiento de Derechos Humanos y la construcción del Juicio por la Verdad en Mar del Plata. EUDEM.
Calvo C., “Las memorias sobre la experiencia de las Ligas Agrarias de Chaco en tiempos de lucha armada. Propuestas para una discusión desde la perspectiva testimonial”. Dans Chao D. & Solís Carnicen, MdM. (coord.) (2022), Violencias del pasado reciente en el Nordeste argentino. Teseo, pp. 199-226.
CELS (2004). “Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son inconstitucionales. Síntesis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve la inconstitucionalidad de las leyes del perdón”,
https://www.cels.org.ar/common/documentos/sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf, [consulté le 5 mai 2025].
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco (2011). “Informe Final”. Dans Comisión Provincial por la Memoria, 24 de Marzo del 76: El Golpe. De la dictadura, de la impunidad a la justicia democrática”, pp. 59-188.
Comisión Nacional por la Desaparición de Personas – CONADEP (1984). Nunca Más. Eudeba.
Confino, H. (2021) La Contraofensiva: el final de Montoneros. FCE.
Cueto Rúa, S. (2019). El origen de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (Argentina, 1999-2000). Colombia internacional (97), pp. 87-115. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13652/pr.13652.pdf
Das Veena (1995), Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India, Delhi. Oxford University Press.
Da Silva Catela L. (2001), No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. Ediciones Al Margen.
_____(2003), “Apagón en el Ingenio, escrache en el Museo Tensiones y disputas entre memorias locales y memorias oficiales en torno a un episodio de represión de 1976”. Dans Del Pino P. & Jelin E. (comps.) (2003), Luchas locales, comunidades e identidades. Siglo XXI Editores, pp. 63-105.
Del Pino P. & Jelin E. (comps.) (2003). Luchas locales, comunidades e identidades. Siglo XXI Editores.
Feld C. & Franco M. (dir.) (2022). ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina. FCE.
Feld C. (2024), De centre de torture à patrimoine de l’humanité. L’École de Mécanique de la Marine (ESMA) comme emblème de la mémoire, Nuevo Mundo Mundos Nuevos. [Consulté le 03 mai 2025]. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/98669 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12yug
Fule C. & Zeitler E. (2022). Memorias de los años setenta en el Nordeste Argentino. Militancia e imaginario político en torno al caso de la masacre de Margarita Belén”. Dans Chao D. & Solís Carnicen MdM. (coord.). Violencias del pasado reciente en el Nordeste argentino. Teseo, pp. 227-258.
Gensburger S. (2023) Qui pose les questions mémorielles ? CNRS Edition.
Gensburger S. & Lefranc S. (2017). A quoi servent les politiques de mémoire. Presses de Sciences Po.
Giles J. (2003). Allí va la vida. La masacre de Margarita Belén. Colihue.
Jelin E. (1995). La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina. Dans Acuña C. et al., Juicio. Castigos y memorias. Nueva Visión, pp. 101-146.
_____(2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.
Leoni M.S. & Nuñez Camelino M. (coords.) (2022). Pasados periféricos. Historia y memoria en el Nordeste argentino. Eudene.
Maeder Ernesto J.A (2012). Historia del Chaco. ConTexto.
Mombello L.C. (2003). La Capital de los Derechos Humanos. Dans Del Pino P. & Jelin E. (comps.). Luchas locales, comunidades e identidades. Siglo XXI Editores, pp. 209-232.
Mumbach M.A. (2022). Represión en Paso de los Libres. El rol del Destacamento de Inteligencia N°123. Dans Chao D. & Solís Carnicen MdM (coord.) (2022). Violencias del pasado reciente en el Nordeste argentino. Teseo, pp. 121-143.
Nino C. (2015). Juicio al mal absoluto. Siglo XXI Editores.
Peppino J. (2024). “De una pedagogía de la palabra a una pedagogía del silencio”. Movimiento Rural y Ligas Agrarias. Sujeto político rural y represión del terrorismo de Estado en el nordeste argentino (1960-1983). Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural, 14 (29). http://portal.amelica.org/ameli/journal/181/1814869017/. [Consulté le 25 avril 2025].
Schaller E. & Solís Carnicer MdM. (2022). Estado y política en clave subnacional. Teseopress.
Tahir N. (2015) Argentine : mémoires de la dictature. Presses Universitaires de Rennes.
_____(2015). De la "Brigada de investigaciones" à la Commission Provinciale pour la Mémoire du Chaco : la mémoire locale au cœur de la ville. Dans Orihuela E.F. & Vilnet G. Cultures et urbanités. L’Harmattan, pp. 173-190.
Verbitsky, H. (1995). El Vuelo. Planeta.
Pour citer cet article :
Nadia Tahir, N. (2025). Aux origines de la Commission Provinciale pour la Mémoire dans le Chaco : l’institutionnalisation d’une mémoire locale. RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/aux-origines-de-la-commission-provinciale-pour-la-memoire-dans-le-chaco-l-institutionnalisation-d-une-memoire-locale-nadia-tahir.html
Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()