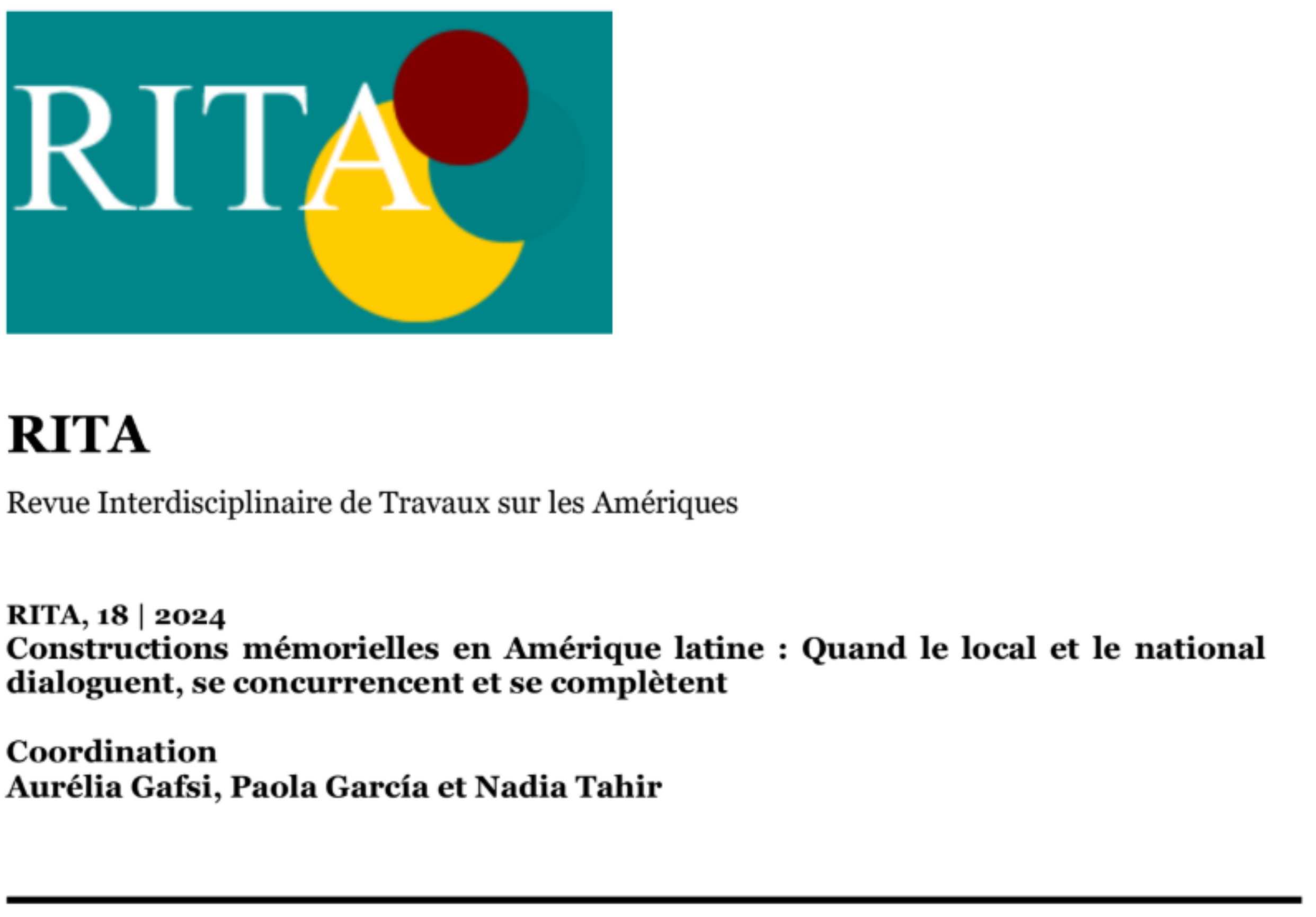
Du soupçon à la réparation : la demande d’amnistie du peuple Aikewara et le passé dictatorial au Brésil
Résumé
Cet article analyse la requête d’amnistie des Aikewara, peuple autochtone du Brésil, et la reconnaissance officielle de leur condition de victimes de la dictature militaire en 2014. Contraints par les militaires à servir de guides pour traquer les militants communistes dans la forêt lors des opérations d’extermination de la Guérilla de l’Araguaia dans les années 1970, les Aikewara expriment, à travers leur demande de réparation, la volonté de raconter leur propre histoire. Cette démarche a engendré l’établissement de liens avec divers acteurs sociaux, illustrant la dynamique complexe des politiques de mémoire dans la justice transitionnelle et les enjeux de représentation du passé dictatorial.
Mots clés : dictature militaire ; amnistie ; réparation ; justice transitionnelle ; Brésil
From Suspicion to Reparation: The Aikewara in Pursuit of Amnesty
Abstract
This article analyzes the Aikewara’s request for amnesty, an Indigenous people of Brazil, and the official recognition of their status as victims of the military dictatorship in 2014. Forced by the military to serve as guides in tracking down communist militants in the forest during the extermination operations of the Araguaia Guerrilla in the 1970s, the Aikewara express, through their request for reparation, a desire to tell their own story. This initiative has led to the establishment of connections with various social actors, illustrating the complex dynamics of memory policies within transitional justice and the challenges of representing the dictatorial past.
Key words : military dictatorship; amnesty; reparation; transitional justice; Brazil
De la sospecha a la reparación: la solicitud de amnistía del pueblo Aikewara y el pasado dictatorial en Brasil
Resumen
Este artículo analiza la solicitud de amnistía de los Aikewara, pueblo indígena de Brasil, y el reconocimiento oficial de su condición de víctimas de la dictadura militar en 2014. Obligados por los militares a servir como guías para rastrear a los militantes comunistas en la selva durante las operaciones de exterminio de la Guerrilla del Araguaia en la década de 1970, los Aikewara expresan, a través de su demanda de reparación, la voluntad de contar su propia historia. Este proceso generó la creación de vínculos con diversos actores sociales, lo que ilustra la compleja dinámica de las políticas de la memoria en el marco de la justicia transicional y los desafíos de representación del pasado dictatorial.
Palabras clave: dictadura militar; amnistía; reparación; justicia transicional; Brasil.
Da suspeita à reparação: o pedido de anistia do povo Aikewara e o passado ditatorial no Brasil
Resumo
Este artigo analisa o pedido de anistia dos Aikewara, povo indígena do Brasil, e o reconhecimento oficial de sua condição de vítimas da ditadura militar em 2014. Forçados pelos militares a atuar como guias para rastrear militantes comunistas na floresta durante as operações de extermínio da Guerrilha do Araguaia na década de 1970, os Aikewara expressam, por meio de sua demanda de reparação, o desejo de contar a própria história. Esse processo gerou o estabelecimento de vínculos com diversos atores sociais, ilustrando a dinâmica complexa das políticas de memória na justiça de transição e os desafios de representação do passado ditatorial.
Palavras-chave: ditadura militar; anistia; reparação; justiça de transição; Brasil.
--------------------------------
Carolina Rezende
Doctorante
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Du soupçon à la réparation : la demande d’amnistie du peuple Aikewara et le passé dictatorial au Brésil
INTRODUCTION
En 2010, des membres du peuple autochtone Aikewara, appelés Suruí do Pará par l’administration[1], ont déposé une demande de réparation auprès de la Commission d’amnistie (CA/MJ) au Brésil. Créée entre 2001 et 2002 sous le ministère de la Justice, cette commission vise à garantir aux persécutés politiques de la dictature militaire brésilienne (1964-1985) le droit à la réparation. Bien que la loi d’amnistie de 1979 approuvée encore sous la dictature ait assuré l’impunité des militaires et maintenu le silence institutionnel sur les crimes du régime, l’amnistie a évolué lors de la redémocratisation. Intégrée à la Constitution de 1988, elle a reconnu le droit à la réparation pour les victimes de persécutions politiques. La CA/MJ, dont le rôle initial était l’évaluation des demandes, a progressivement intégré une dimension symbolique à la réparation. En 2007, sous la présidence de Paulo Abrão, la commission a aligné ses politiques sur les normes internationales des droits humains et a encouragé la justice transitionnelle mettant en avant le droit à la mémoire et à la vérité, en plus des compensations financières.
Le terme « justice transitionnelle » a émergé entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, dans le sillage de l’agonie des régimes autoritaires, notamment en Amérique latine. Cette période a soulevé le dilemme du besoin de rendre justice aux victimes, d’un côté, et d’assurer la stabilité politique tout en facilitant la transition vers la démocratie, de l’autre — deux objectifs qui pouvaient s’avérer contradictoires. Ce dilemme a été largement débattu par des militants des droits humains, des responsables politiques et des intellectuels au cours des dernières décennies du XXe siècle, quand ont été proposées des mesures de justice au-delà des solutions pénales, telles que les réparations et les mécanismes de recherche de la vérité (Arthur, 2009). Dès lors, ce terme a évolué pour désigner un ensemble de mécanismes, comparables à une « boîte à outils », permettant de traiter les injustices et les violations des droits humains commises dans des conflits à travers le monde. Depuis les années 2000, la justice transitionnelle a été institutionnalisée par des organisations de droit international et est également devenue un champ interdisciplinaire de recherche consacré aux pratiques de justice post-conflit (Teitel, 2014).
C’est dans le contexte de la gestion de Paulo Abrão à la CA/MJ que les Aikewara ont déposé leur requête. Dans les années 1970, impliqués dans les opérations militaires contre la Guérilla de l’Araguaia — un mouvement du Parti Communiste du Brésil (PCdoB) cherchant à renverser la dictature —, les Aikewara ont été pris dans les combats. Les guérilleros s’étaient installés dans la région du Bico do Papagaio, près du village Sororó des Aikewara. Entre 1972 et 1975, le gouvernement militaire lança des opérations secrètes pour éliminer la guérilla, occupant Sororó et utilisant les hommes du village comme guides dans la forêt amazonienne. Dès la fin des années 1970, les Aikewara furent suspectés de collaboration. Longtemps restés silencieux, ils furent interrogés dans les années 1990 d’abord comme témoins des disparitions de guérilleros, puis dans les années 2000 par des journalistes mettant en doute leur rôle dans leur assassinat. En 2010, avec le soutien de proches des disparus, ils déposèrent leur demande d’amnistie, soulignant la souffrance causée par l’occupation militaire et leur rôle de guides.
Outre une demande de réparation, le processus d’amnistie des Aikewara s’inscrit dans un enjeu plus large qui concerne le traitement du passé dictatorial à travers des politiques de mémoire centrées sur les victimes. Le cas brésilien s’inscrit dans un ensemble d’expériences transitionnelles latino-américaines qui ont défié l’impunité en proposant diverses formes de responsabilisation, au-delà de la condamnation pénale. À cet égard, les pays latino-américains sont considérés comme pionniers dans la mise en œuvre de mécanismes telles que la recherche de la vérité (truth telling), ainsi que de réparations symboliques et économiques centrées sur les victimes (Skaar, García-Godos, et Collins, 2016). La centralité accordée aux victimes dans ces mécanismes invite à analyser la justice transitionnelle non seulement du point de vue de l’application institutionnelle de ses instruments orienté vers l’action de l’État et des acteurs juridiques, comme c’était souvent le cas dans les premiers débats académiques sur le sujet. Nous nous intéressons aussi aux dynamiques sociales impliquant des acteurs non étatiques, à l’instar de travaux qui ont encouragé l’analyse du rôle de la société civile et des collectifs ayant influencé le programme de justice transitionnelle (McEvoy et McGregor, 2010; García-Godos, 2013). Notre intérêt est donc d’interroger cette dynamique entre acteurs étatiques et non étatiques dans l’élaboration d’une version de l’histoire des persécutions perpétrées par la dictature militaire brésilienne.
Cette dynamique sociale se manifeste clairement dans les demandes d’amnistie déposées par les Aikewara. Divers groupes sociaux y proposent des récits sur l’histoire de ce peuple sous la dictature, redéfinissant tour à tour leur statut de victimes ou de présumés responsables. Notre analyse portera sur les relations et les tensions possibles entre mémoires locales et mémoire nationale liées aux Aikewara et à la dictature. Les dossiers de demande de réparation adressés à la CA/MJ, où se confrontent les récits de différents groupes sociaux, constituent un objet d’étude central. La mémoire des Aikewara sous la dictature tend-elle vers une version unifiée, ou suscite-t-elle des controverses sur leur récit ?
Nous analyserons d’abord la stigmatisation des Aikewara comme collaborateurs depuis les années 1970. Puis, nous étudierons la formation de leur cause auprès de la CA/MJ et les acteurs impliqués entre 2010 et 2014. Enfin, nous examinerons leur récit de victimes de la dictature dans les commissions de justice transitionnelle en 2014. Nos sources principales incluront des publications de presse sur la Guérilla de l’Araguaia, disponibles sur l’Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, ainsi que les dossiers de demande d’amnistie des Aikewara, conservés dans les archives de la Commission d’amnistie, actuellement au ministère des Droits humains et de la citoyenneté à Brasília.
- La stigmatisation des Aikewara comme collaborateurs
Le choix d’étudier les Aikewara ne relève pas du hasard. Cet article présente les résultats partiels d’une recherche doctorale en cours, centrée sur la condition de victime de la dictature et le statut d’amnistié politique. Nous avons choisi d’examiner certains groupes sociaux à partir des classifications établies par la CA/MJ dans le cadre du catalogage des dossiers déposés auprès de la commission depuis 2001. Dans la base de données que les archives de la CA/MJ nous ont transmis en 2020, un groupe procédural intitulé Indiens ou ethnies (Índios ou etnias) ne contenait qu’un seul sous-groupe : les Suruís. Nous avons donc supposé que ce peuple autochtone eût rencontré et surmonté des difficultés particulières pour adapter ses demandes à la législation régissant le statut d’amnistié politique. Pour obtenir ce statut et une réparation, les candidats doivent soumettre une demande à la CA/MJ en la conformant aux critères établis par la loi qui a créé la commission. L’un des critères les plus contraignants, qui souligne les limites concernant les sujets considérés comme victimes de la dictature, est la nécessité de prouver la motivation exclusivement politique de la persécution alléguée.
Cela signifie que les travailleurs licenciés pour leur participation à des syndicats ou à des mouvements de grève, ainsi que les étudiants et politiciens sanctionnés sur la base de lois d’exception, doivent établir un lien causal entre les faits exposés dans leur requête et leur caractère politique. Or, ce qui est considéré comme politique n’est pas toujours évident. Les procès d’amnistie engagent un processus de catégorisation juridico-bureaucratique des persécutés conformément à ce que Lucas Pedretti Lima (2022) a qualifié d’une grammaire de la violence politique. Celle-ci confère une nature spécifique à la violence exercée par l’État dictatorial, la rendant illégitime et donc digne de réparation. Au sein des procès de la CA/MJ, les débats sur la nature politique des persécutions révèlent différentes façons de comprendre la répression de la dictature, ainsi que les individus considérés comme « ayant droit » à une réparation.
La violence subie par les peuples autochtones durant la dictature a été marginalisée dans les politiques de réparation et mémoire. L’anthropologue Orlando Calheiros (2015) note que la conception de la justice transitionnelle adoptée par l’État brésilien est limitée, car elle ne reconnait pas que ces violations sont indissociables de leur condition ethnique. Notre hypothèse était donc que les Aikewara étaient le seul groupe autochtone à bénéficier d’une amnistie car leur expérience de persécution était directement liée aux opérations militaires contre la guérilla de l’Araguaia, permettant ainsi d’établir un lien causal entre la violence vécue et la motivation politique.
L’étude du groupe Aikewara a révélé que la reconnaissance de leur statut de victime est pourtant plus complexe. En effet, une suspicion entoure leur rôle, les présentant parfois comme des collaborateurs des militaires plutôt que comme victimes. Bien que cette suspicion ne soit pas explicitement mentionnée dans leur dossier d’amnistie, elle est discutée dans le dernier chapitre du rapport de la Commission de la Vérité de l’État du Pará (CEV-PA). Ce rapport publié en 2022 souligne que des jeunes Aikewara ont encouragé leurs pairs à raconter leur histoire, avec le soutien de Paulo Fonteles Filho, coordinateur de la CEV-PA. Ce dernier avait eu contact avec les Aikewara depuis 2009 dans le cadre des enquêtes autour des disparus politiques. Il a souligné à l’époque de ces enquêtes qu’il fallait faire attention à la « question de la guérilla avec les suruí », car « ils ont été profondément marqués, profondément blessés par cette histoire. Il est difficile de parler de mutilation de corps, de chasse aux guérilleros[2]. » Dans la synthèse du cas Aikewara, le rapport indique que, dans la version officielle, ils sont souvent décrits de manière péjorative comme des alliés du régime militaire dans la traque des guérilleros, ce qui ne correspondrait pas à leur véritable histoire (CEV-PA, 2022, p. 333).
Comment les Aikewara ont été stigmatisés comme collaborateurs ? Qui les identifiait comme des alliés de la dictature ? Les paysans de la région ? Les proches des disparus ? Cette stigmatisation a-t-elle circulé dans la presse ? Nous avons trouvé quelques pistes dans la presse numérisée à la Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. L’une des premières publications à aborder la Guérilla de l’Araguaia fut l’hebdomadaire Movimento, dans son édition de juillet 1978, qui l’a présenté dans sa couverture comme une histoire « finalement révélée ». Le reportage cite comme interlocuteurs un guérillero, des autorités et des évêques de l’Église catholique, ainsi que les autochtones.
L’article du reportage concernant les Aikewara est en réalité un assemblage de témoignages collectés par l’anthropologue Iara Ferraz, qui est en contact avec ce peuple depuis 1975. À cette époque, elle est arrivée dans le village Sororó en tant que représentante de la Fundação Nacional do Índio (Funai)[3], chargée de coordonner le Plan Intégré de Développement Communautaire, un projet visant à instaurer une autogestion de la récolte de noix dans le territoire autochtone. Dans le village, elle a entendu les Aikewara exprimer leurs préoccupations concernant la perte de leur territoire lors du processus de démarcation en évoquant le « temps de la guerre ». En novembre 1976, avec le journaliste Palmério Dória et le documentariste Vincent Carelli, Ferraz a mené un premier entretien avec les Aikewara à ce sujet. Le reportage du Movimento recycle les témoignages recueillis lors de cet entretien (Ponce García, 2015, pp. 86–91).
Les Aikewara sont alors décrits par l’hebdomadaire comme « des rares habitants de la région qui parlent ouvertement de la guérilla », qu’ils ont suivie de près : « ils ont servi de guides pour l’armée, conduisant les soldats dans la forêt et indiquant des pistes des guérilleros[4]. » Sans préciser l’auteur du témoignage, le reportage relate qu’un Aikewara a déclaré que des soldats étaient arrivés dans son village en demandant s’ils savaient où se trouvaient les « terroristes ». En répondant par l’affirmative, les indigènes auraient pénétré dans la forêt avec l’autorisation de la Funai. Le témoin évoque la recherche des campements des guérilleros, précisant qu’un des indigènes aurait porté un mort jusqu’à l’hélicoptère et aurait décapité un corps. Un militaire aurait apporté de Brasília des fusils destinés aux indigènes pour les aider dans la chasse aux guérilleros. Cette section laisse entendre que les Aikewara ont consenti à aider les militaires dans la recherche des guérilleros et dans la manipulation de leurs corps.
Un reportage de la même page, basé sur des interviews d’évêques, renforce l’idée que les Aikewara et certains paysans locaux auraient consenti à coopérer avec les militaires. Néanmoins, ce consentement ne signifie pas un partage de leurs convictions sur la traque des « terroristes » ; ils auraient plutôt agi sous contrainte ou aveuglément. Des membres de la prélature de Marabá rapportent que l’armée surveillait les activités de l’Église, soupçonnant certains de diriger la guérilla, ce qui a conduit à leur arrestation et torture. L’évêque de Marabá de l’époque, dom Alano Maria Pena, mentionne toutefois que l’aspect le plus grave selon lui,
C’est qu’ils [les militaires] ont utilisé les indiens Suruí comme guides dans la forêt pour capturer ces guérilleros. Et ils ont aussi utilisé ces paysans de la forêt qui ont été torturés, certains sont morts. Et ceux qui n’ont pas été tués ont subi un lavage de cerveau et sont devenus des guides et des collaborateurs de l’armée. [...] Ils ont ouvert une route, donné des terres au peuple, mais ils ont aussi donné un conditionnement mental. C’est un peuple qui est devenu dépersonnalisé[5].
Dans les publications ultérieures, le consentement des Aikewara semble atténué. Dans un article du 18 septembre 1978, Movimento mentionne que, après la première publication sur la guérilla de l’Araguaia, d’autres médias comme O Estado de S. Paulo ont également couvert le sujet. Ce qui a particulièrement attiré l’attention de la presse, ce sont les méthodes de l’armée pour exterminer la guérilla. O Estado de S. Paulo souligna que la méthode la plus efficace était l’implication des habitants de la région. Contrairement aux tueurs à gages engagés par des propriétaires terriens, les Aikewara et les paysans auraient été intimidés pour les contraindre à coopérer : « si les tueurs à gages collaboraient spontanément avec les troupes militaires, plusieurs des paysans de la région — et même les indiens Suruí — ont dû être intimidés ou même torturés, selon les dénonciations faites par l’Église »[6].
Les premières publications rapportent l’utilisation des Aikewara comme guides, sans préciser leur niveau de consentement. Elles évoquent la violence exercée par l’armée sur les habitants, notant parfois que les autochtones n’avaient pas une « conscience du travail — disons, une compréhension idéologique de celui-ci », comme le lit-on dans un article d’O Pasquim[7]. L’usage des autochtones comme guides est montré comme une stratégie militaire incluant intimidation, arrestations et torture. Ces informations comptent parmi les premières à avoir été rendues publiques, notamment grâce à la presse alternative, telle que Movimento et O Pasquim, à une époque où l’on savait peu de choses sur les opérations militaires, menées clandestinement et systématiquement maintenues sous le sceau du secret par les Forces armées.
Nous n’avons pas trouvé de sources démontrant une accusation directe de la part des familles des disparus politiques affirmant que les Aikewara auraient collaboré avec les militaires. Andrea Ponce García (2015, pp. 88–104) note que les publications sur la guérilla de l’Araguaia rapportent des récits dans lesquels les indigènes auraient mutilé les guérilleros morts. Elle estime que ce discours a été intégré par certains proches de disparus, bien que les sources citées ne les accusent pas directement. Les témoignages évoquent qu’il y a eu certaines familles croyant que les indigènes auraient agi de leur plein gré, sans reconnaître le niveau de coercition auquel les Aikewara étaient soumis.
En effet, les familles des disparus politiques de la guérilla de l’Araguaia étaient présentes dans la région depuis la fin du régime militaire. Ces familles ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l’amnistie dans les années 1970, cherchant à travers ce combat non seulement à obtenir l’amnistie politique, mais aussi à éclaircir les crimes commis par les militaires et à révéler publiquement la violence dictatoriale. Elles ont intégré le Comité brésilien pour l’amnistie (CBA) fondé en 1978 et, dans les années 1980, ont organisé la première expédition dans la région de l’Araguaia pour recueillir des indices sur la localisation des corps des guérilleros s’appuyant sur les témoignages des habitants locaux (Teles, 2013). Ces familles ont donc eu accès aux témoignages non seulement des paysans, mais aussi des Aikewara. Bien que certains proches aient pu exprimer des doutes sur le rôle des autochtones dans la violence, d’autres ont compris que les Aikewara étaient également des victimes des exactions militaires.
Le procès d’amnistie des Aikewara
Au début des années 2000, la Guérilla de l’Araguaia réémerge dans l’espace public avec les actions judiciaires menées par les familles des disparus politiques. En 1982, les proches de 22 guérilleros disparus ont porté l’affaire devant la justice brésilienne, demandant des informations sur les circonstances des disparitions et la récupération des corps. Face à la lenteur du système judiciaire et au manque de réponses, ils ont saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) en 1995, qui a déclaré l’affaire recevable devant sa Cour (CoIDH) en 2001 (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2001).
L’action intentée au niveau fédéral en 1982 a abouti en 2003 à une décision ordonnant la levée du secret militaire sur les opérations dans l’Araguaia et fixant un délai de 120 jours pour indiquer l’emplacement des corps (Vasconcelos, 2007). Parallèlement, la procédure engagée devant la CoIDH, qui recommandait dès 2008 que le Brésil se conforme à la décision de la justice fédérale, a exercé une pression croissante sur le ministère de la Défense. Celui-ci a alors mis en place en 2009 un groupe de travail chargé de localiser les disparus. Le Groupe de travail Tocantins (GTT) a mené douze expéditions dans la région. En 2010, la CoIDH a condamné le Brésil, l’exhortant à localiser les corps et à élucider les circonstances des décès. En réponse, le GTT a été restructuré en 2011 et élargi à travers un partenariat interministériel, sous le nom de Groupe de travail Araguaia (GTA) (Gallo, 2012, pp. 344–45).
Dans les enquêtes menées par les GTs, les Aikewara ont été perçus comme parties prenantes dans l’attribution des responsabilités concernant les disparus en raison de leur supposée connaissance des lieux d’enterrement des guérilleros et de l’importance de leur territoire pour la recherche de ces corps (Ponce García, 2015, p. 55). Lors de leur première interaction avec les institutions chargées des crimes de la dictature, les Aikewara étaient considérés comme témoins oculaires des événements liés aux guérilleros, et non comme victimes. En 2009, le Ministère public fédéral (MPF) à Marabá a pris les dépositions de quatre hommes adultes de Sororó. Un an plus tard, treize membres des Aikewara ont déposé une demande d’amnistie auprès de la CA/MJ via l’Association des familles des disparus de l’Araguaia (Ferraz, 2019, p. 82).
La première pétition soumise à la CA/MJ a été signée par Mercês Castro, la sœur d’un guérillero disparu. Depuis les années 1980, elle se rend régulièrement dans la région, en contact avec les habitants locaux, à la recherche d’informations sur son frère, Antônio Teodoro de Castro (Jucá, 2019). Dans la pétition des Aikewara, le document met en avant la souffrance de leur peuple depuis l’invasion de leur village par les militaires en 1972. Il précise que les hommes contraints de travailler comme guides pour les troupes ont dû abandonner leurs familles, potagers, chasses et mode de vie. Les témoignages font état de mauvais traitements pendant les expéditions en forêt : « maltraités et humiliés par des cris et des coups, ne mangeant qu’une fois par jour, se nourrissant de viande sèche crue avec de la farine faute de pouvoir faire un feu. » Le document souligne aussi que les femmes et les enfants étaient terrorisés par la présence militaire, empêchés de sortir de leurs maisons. Il qualifie enfin les actions militaires de criminelles, affirmant qu’elles ont « exploité des incapables comme des esclaves, presque détruit leur culture et la perpétuation du groupe ethnique »[8].
Les demandes des Aikewara auprès de la CA/MJ n’ont pas progressé. Cependant, l’intérêt public pour la Guérilla de l’Araguaia a augmenté après les décisions de la justice fédérale et internationale, permettant aux Aikewara de réapparaître dans les médias, mais souvent en lien avec les violences subies par les guérilleros. En 2011, un article du journaliste Lucas Figueiredo, intitulé « Le secret des Indiens Aikewara » et publié dans un magazine de circulation nationale, affirmait que les Aikewara auraient coupé les têtes des guérilleros pendant les opérations militaires.
Figueiredo présente son reportage comme une révélation concernant la participation des Aikewara à la violence contre les guérilleros en qualifiant cet épisode de « l’un des plus sombres de l’histoire du Brésil », à savoir « la transformation d’indiens en mercenaires de guerre de l’armée »[9]. Il décrit sa visite à Sororó comme un terrain tendu dans lequel les jeunes Aikewara empêcheraient les anciens de parler des actes de violence commis. Il aurait finalement réussi à discuter avec les plus âgés qui ont évoqué la faim et les mauvais traitements subis lors des marches avec les militaires. Cependant, Figueiredo rapporte qu’ils se sont esquivés des questions concernant d’éventuels affrontements avec les guérilleros en répondant en portugais rudimentaire que « l’indien avait très peur »[10].
Pour le journaliste, les Aikewara, qualifiés de mercenaires, cherchaient à fuir leur passé. Figueiredo cherche à « percer les limites des indiens » en écoutant la version des militaires. Sa principale source est un courriel envoyé en 2007 par le colonel de réserve Aluisio Madruga de Moura e Souza à un ami, également colonel de réserve, qui avait commandé une des opérations de recherche des guérilleros dans l’Araguaia. Le destinataire du courriel a fourni une copie signée du message au magazine, manifestant ainsi l’intention des militaires de rendre publique leur version. Dans ce courriel, le colonel affirme que le seul cas de décapitation qu’il connaît a été perpétré par les Suruí, précisant que la décapitation des guérilleros « avait gêné la plupart [des militaires], mais un indien reste un indien[11]. » Sans questionner l’intention des militaires de l’adresser ces courriels[12], le journaliste attribue la responsabilité des mutilations des corps des guérilleros non pas à l’armée, mais aux Aikewara, suggérant à la fin de son reportage qu’ils devraient être punis.
Figueiredo cite également Hugo Studart, un journaliste ayant soutenu en 2013 une thèse en histoire sur la mémoire des militants de la Guérilla de l’Araguaia[13]. Dans sa thèse, Studart relaie des informations qui semblent en consonance avec les sources militaires présentées par Figueiredo, attribuant un consentement explicite des Aikewara à collaborer avec les militaires. Il affirme avoir mené des recherches de terrain dans le village Sororó entre 2009 et 2010, mais les données qu’il présente ne correspondent pas à la version que les Aikewara ont transmise aux institutions fédérales à la même époque. Alors que la demande déposée auprès de la CA/MJ et datée de 2010 affirme que douze chefs de famille autochtones ont été contraints de guider les militaires, Studart soutient qu’à Sororó « il n’y avait pas beaucoup d’indiens, seulement huit », dont quatre auraient été choisis comme guides. Il insinue également que les Aikewara auraient consenti avec les militaires en échange d’une aide pour leur communauté, évoquant un pacte avec le major Nilton Cerqueira pour retrouver les « hommes mauvais » en contrepartie d’une intervention en leur faveur (Corrêa, 2013 : 356). Aucune mention n’est faite de la médiation de la Funai. Il conclut que les Aikewara auraient tiré profit de cette alliance en soulignant leurs conditions de vie améliorées : « Tous logés dans des maisons en brique, avec un centre de santé à disposition, tous les enfants fréquentant une école bilingue. “Et toutes les femmes enceintes”, se réjouissait le chef Almir » (Corrêa, 2013 : 357).
Néanmoins, dans un procès-verbal de déclaration établi par le ministère public, daté de 2011 et joint au dossier de demande d’amnistie des Aikewara, les témoignages des autochtones font valoir qu’ils étaient contraints par les militaires de les guider sous la menace de violences. Étant donné que la thèse de Studart ne présente pas ses sources, mais mentionne en notes de bas de page uniquement les prénoms des Aikewara interviewés sur le terrain, il n’est pas possible de recouper les témoignages sur lesquels il affirme s’appuyer avec ceux figurant dans les dossiers d’amnistie. Quoi qu’il en soit, la version de l’engagement des Aikewara aux côtés des militaires présentée par Studart va à l’encontre de celle des Aikewara devant les institutions fédérales, qui insistent sur la contrainte à collaborer et sur la violence de la présence militaire dans leur village.
Les Aikewara ont pris connaissance du reportage de Lucas Figueiredo, ce qui a suscité une vive indignation dans leur village. D’après Ponce García (2015 : 95), les jeunes ont convaincu les anciens de raconter leur version afin de défendre leur innocence. Après la réorganisation du groupe de travail en 2011, Sueli Bellato, alors vice-présidente de la CA/MJ, a rejoint le GTA. Bellato est une religieuse de la congrégation des Chanoinesses régulières de saint Augustin qui a commencé sa trajectoire politique au sein de la Pastorale de la Jeunesse, dans la périphérie de São Paulo, durant les dernières décennies de la dictature militaire. Elle est également avocate et son parcours est marqué par un engagement en faveur des causes sociales et des droits humains. Elle a intégré le conseil de la CA/MJ en 2003 et est devenue vice-présidente sous la gestion de Paulo Abrão. Lors d’une expédition à l’Araguaia en 2012, elle a appris que les Aikewara avaient déposé une demande d’amnistie restée en suspens. Le GTA a alors décidé de recruter des professionnels pour rédiger un rapport sur la guérilla de l’Araguaia et les Aikewara.
L’anthropologue Iara Ferra a coordonné les travaux avec Orlando Calheiros, spécialiste de la sociocosmologie des Aikewara. Trois études de terrain sont menées dans la réserve Sororó en 2013 pour recueillir leurs témoignages. Le rapport final intitulé O « tempo da guerra » : os Aikewara e a Guerrilha do Araguaia [« Le temps de la guerre » : les Aikewara et la Guérilla de l’Araguaia] a été envoyé en octobre 2013 au Secrétariat aux droits humains de la Présidence de la République, puis transmis à la CA/MJ pour appuyer les requêtes des Aikewara (Ponce García 2015, pp. 107–109). Le rapport accorde aux témoignages une valeur probante.
- Les Aikewara comme victimes
Les témoignages des Aikewara comme victimes gagnent en visibilité à partir de 2012 dans le cadre des commissions de justice transitionnelle au Brésil. Deux dynamiques favorisent cette prise de parole : la volonté des jeunes de raconter leur propre histoire et leur appel à témoigner sur les disparitions forcées. La Commission nationale de la vérité (CNV), créée en 2012, a institué un groupe de travail chargé d’enquêter sur les violations des droits humains commises contre les paysans et les peuples autochtones, sous la coordination de Maria Rita Kehl. Ce groupe a organisé trois audiences publiques dans la région entre 2012 et 2014. Parallèlement, le rapport intitulé « Le temps de la guerre » a été joint à une nouvelle demande d’amnistie déposée par les Aikewara en 2013, puis remis à Kehl en 2014.
Bien que les demandes d’amnistie aient été déposées à titre individuel, le texte des pétitions qui précède le rapport joint est identique pour l’ensemble des dossiers concernant les Aikewara. Il insiste sur l’organisation sociale des peuples autochtones, fondée sur un mode de vie communautaire, afin de rendre ces témoignages intelligibles. L’histoire des Aikewara est ainsi présentée à travers le rôle central de la collectivité, plutôt qu’à travers celui de l’individu. En rappelant que la vérité, la mémoire et la justice sont les piliers de la justice transitionnelle, le texte souligne que la transmission de leur histoire se fait par l’oralité, les anciens partageant les récits avec les nouvelles générations. Les déclarations des Aikewara sont alors présentées comme celles de victimes de la dictature.
La requête fonde sa légitimité juridique sur plusieurs articles du Code de procédure civile ainsi que sur les normes de la CA/MJ. Ce faisant, elle accorde aux témoignages des Aikewara une présomption de véracité, leur conférant ainsi une valeur probante. Le texte affirme que les préjudices subis ont eu une motivation politique, ce fait étant étayé par le contexte historique reconnu par l’État brésilien dans d’autres occasions[14]. Afin de justifier la demande de réparation conformément aux critères de la CA/MJ, la requête souligne également l’impact économique des violations, mettant en évidence que le régime dictatorial a illégalement entravé leurs activités de subsistance, à l’instar de celles des paysans :
En effet, en raison de l’intervention de l’État brésilien, qui a assiégé la région, les paysans et les indigènes ont été contraints d’abandonner leurs maisons et leurs terres ou de cesser les activités nécessaires à leur subsistance et à celle de leurs familles. En outre, ils ont perdu leur unique moyen de subsistance, car leurs plantations et élevages ont été détruits par l’armée dans le but d’empêcher le soutien aux forces de guérilla[15].
Les Aikewara ont été impliqués dans les opérations militaires lors d’une phase de répression où tous les habitants étaient suspectés de collaborer avec la guérilla. La requête présente des documents militaires de l’époque de la dictature faisant état de la répression d’un réseau de soutien, au sein duquel paysans et autochtones étaient perçus comme des acteurs susceptibles d’aider les guérilleros, notamment en leur procurant nourriture, médicaments ou informations. Les violences subies sont davantage qualifiées de violations des droits humains, « constituant, en soi, une preuve évidente de l’obligation [de l’État] de réparation aux victimes.[16] » Les Aikewara vivent sur un territoire qui été classé zone de sécurité militaire, ce qui a conduit à l’occupation de leur village :
S’ensuivirent des années de silence sur les violences alors commises, période durant laquelle les Aikewara ont vu leur territoire occupé par les Forces armées, ayant été soumis à toutes sortes d’humiliations et de privations (faim, violence et peur). Pendant deux années consécutives, tous les hommes adultes ont été contraints de collaborer, contre leur gré et sans explications, à la répression du mouvement guérillero de l’Araguaia — des épisodes traumatisants pour toute la société Aikewara, où l’on a même observé la mort d’enfants nés prématurément pendant cette période[17].
Avec une requête plus complète et mieux argumentée que la première, le document présente les fondements de la demande de réparation, reconnaissant chez les indigènes une perte spécifique d’activité professionnelle et culturelle. La requête est signée soit par écrit, soit par empreintes digitales par les Aikewara et inclut la transcription des témoignages recueillis par Iara Ferraz et Orlando Calheiros. Cette pétition est soutenue par le rapport « Le temps de la guerre », qui contient des textes des anthropologues retraçant l’histoire du contact de ce peuple avec les non-autochtones depuis les années 1950. Dans le chapitre sur la dictature, les témoignages des Aikewara occupent une place centrale, avec des résumés de Ferraz qui soulignent l’importance de ces récits pour dénoncer les injustices à l’origine des demandes de réparation.
Les Aikewara décrivent les violences subies durant la période d’occupation militaire : ils rapportent menaces de mort, perturbations de leurs modes de vie et interruption de leurs rituels. Leur capacité à cultiver, pêcher et chasser a été entravée, entraînant famine parmi les femmes et enfants restés au village ainsi que les hommes emmenés dans la forêt. Des militaires auraient incendié leurs cultures et maisons, instaurant un climat de peur constante. Les hommes à maintes reprises contraints de guider les soldats auraient enduré mauvais traitements, humiliations et blessures. Les récits des Aikewara cherchent également à répondre aux accusations de collaboration avec les militaires et le sort des corps des guérilleros assassinés. Quatre types de récits issus de ces témoignages semblent réagir à cette stigmatisation.
En premier lieu, celui qui concerne la justification de raconter cette histoire pour que les non autochtones connaissent leur version. Teriweri, une femme restée au village sous état de siège et ayant perdu ses jumeaux nés prématurément, décrit la peur constante qu’elle a vécue. Bien qu’elle affirme ne pas aimer se rappeler de ce qui s’est passé, elle dit : « Je vous raconte cela parce qu’il est important que les personnes, que ce soit au Brésil ou ailleurs dans le monde, sachent bien ce qui s’est passé, c’est-à-dire la “guerre” durant la période de la guérilla. C’est pourquoi je raconte ici un peu »[18].
En deuxième lieu, la peur causée par le bruit des hélicoptères militaires et les menaces faites par les soldats est mise en avant dans les témoignages concernant l’arrivée des militaires au village, ce qui suggère que ce contact avec l’armée était forcé, involontaire et violent, et non le fruit d’une négociation consentie. Selon Tawé, les soldats ont envahi le village en pointant leurs armes sur les femmes. Les hommes auraient eu peur et les enfants se seraient mis à pleurer lors de l’arrivée de l’armée.
En troisième lieu, les Aikewara insistent sur le fait qu’ils ne savaient pas ce que les militaires faisaient dans la région et qu’ils se sont sentis trompés par les représentants de la Funai. Umassu, l’un des hommes recrutés, raconte que les militaires auraient un accord avec Mariano, un fonctionnaire de la Funai, pour recruter les indigènes. Mariano aurait dit qu’il avait besoin de quelqu’un pour guider les militaires dans la forêt et Umassu affirme : « Nous ne savions rien, mais nous y sommes allés quand même, dupés »[19]. Api, un autre homme qui a été mené dans la forêt, ajoute que « Nous, on a trop souffert […]. À ce moment-là, quand il y a eu cette “guerre”, on ne savait rien ; on est quand même entré [dans la forêt] sans rien savoir »[20]. Plusieurs Aikewara affirment également qu’ils ne savaient pas qui étaient les « terroristes » auxquels les militaires faisaient référence. Ces derniers leur demanderaient à la fois s’ils savaient où ils se trouvaient et tentaient de les contraindre à coopérer en disant que les guérilleros allaient prendre leurs terres, comme le rapporte Umassu :
Il m’a dit : « Tu sais pourquoi on vous emmène [dans la forêt] ? Parce que ce sont de “terroristes” ! Ils vont vous prendre toutes vos terres ! […] On ne savait pas ce que c’était qu’un “terroriste”, un “communiste”, on ne comprenait pas ce que cela voulait dire[21].
Enfin, les hommes qui sont entrés dans la forêt avec les militaires racontent leur effroi face à la violence lorsqu’ils évoquent les moments où ils auraient croisé des guérilleros capturés ou vu leurs corps. Ils se défendent également des accusations d’avoir décapité les guérilleros, comme le décrit Api lorsqu’il raconte comment Moreninho a été forcé de transporter le corps d’un mort contre son gré :
On a vu quatre gars morts là-bas ! […] Ils en avaient déjà tué un. La police a obligé Moreninho à attraper un mort. […] Puis ils ont dit à Moreninho :
— Attrape ça, indien ! On rentre avec moi [la police].
— Ah non, je ne le ramène pas ! a répondu Moreninho.
— Non ! Ramène-le ! a insisté le soldat, qui l’a forcé.
Alors Moreninho l’a pris, l’a mis dans l’hélicoptère pour l’amener ici, à São Raimundo. Je ne sais pas où ils l’ont enterré. Je crois bien que c’est ici même qu’ils l’ont enterré !
Api ajoute qu’il ne sait pas ce qu’il est advenu du corps : « Je ne sais pas s’ils l’ont décapité, je ne sais pas ce qu’ils lui ont fait. Je sais juste que Moreninho et moi, on a vu quatre hommes morts là-bas ! »[22].
En 2014, les demandes d’amnistie des Aikewara ont été appréciées en septembre lors d’une audience publique tenue à Brasília, en présence de représentants du peuple Aikewara. Sueli Bellato a été désignée comme la rapporteuse de leur demande et elle a voté en faveur de l’amnistie des Aikewara. Dans son rapport, joint à la fin du dossier d’amnistie des Aikewara, elle retrace l’historique de la guérilla de l’Araguaia et des actions militaires. Elle indique que, dans le cadre des actions de répression, les Aikewara ont été capturés par les forces répressives. L’installation d’un poste de la Funai sur leur territoire, censé de protéger les autochtones, n’aurait pas empêché l’armée d’agir dans le village de Sororó. En conséquence, les militaires ont « recruté de manière coercitive […], de 1972 à 1974, pratiquement tous les hommes adultes pour servir de guides dans la forêt pour “chasser” les guérilleros[23] », causant un traumatisme profond au sein de la société Aikewara. Cette intervention militaire aurait entraîné désorganisation familiale, famine et une intense peur de la mort, laissant des séquelles psychologiques durables.
Bellato rejette les versions selon lesquelles les hommes ont consenti à guider les militaires, précisant que « les Aikewara affirment, catégoriquement, qu’ils ne connaissaient pas les raisons des actions violentes des militaires ». Elle décrit également les hommes comme des prisonniers de guerre, subissant un régime servile et des humiliations. Les femmes, les enfants et les hommes restés au village auraient été surveillés et empêchés de fournir de la nourriture. De plus, l’occupation militaire a eu lieu juste avant le rituel karuwara[24], entraînant la destruction de leurs maisons, biens et provisions pour la réalisation du rituel. Pour ces raisons, Bellato conclut que cette occupation a « détruit non seulement les bases matérielles mais aussi les bases symboliques de l’existence de la communauté autochtone[25]. »
Selon Bellato, ces faits sont indiscutables dans l’histoire de la guérilla de l’Araguaia. Corroborés par des documents officiels, ces témoignages auraient une valeur probatoire compte tenu de l’occultation des informations en possession de l’armée. Elle qualifie l’action des militaires comme des violations des droits humains pratiquées par l’État d’exception dans la région en se basant sur des préceptes fondamentaux de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ces violations sont tenues pour un mépris manifeste des droits fondamentaux, ce qui devrait fonder l’obligation de l’État à accorder réparation aux victimes. Tous les conseillers de la CA/MJ ont voté en faveur de l’amnistie des Aikewara. Le président de la Commission, Paulo Abrão, a ainsi présenté des excuses au nom de l’État brésilien, reconnaissant pour la première fois un peuple autochtone parmi les victimes de la dictature militaire.
Conclusion
La demande d’amnistie des Aikewara suggère que les séquelles de la dictature ne relèveraient pas uniquement des années d’opérations militaires contre la guérilla de l’Araguaia dans le village, mais aussi de la stigmatisation engendrée par l’inculpation attribuée à ce peuple. Se défendre contre cette stigmatisation en racontant à la première personne ce qu’ils ont vécu durant la dictature apparaît dès lors comme un objectif primordial pour comprendre leur démarche.
Si cette demande a été motivée par le contact avec des paysans de la région amnistiés depuis 2007, elle ne progresse véritablement que dans le contexte de l’essor de la justice transitionnelle au Brésil, impulsée en grande partie par la CA/MJ depuis la présidence de Paulo Abrão. Tant la CA/MJ que d’autres mécanismes de justice transitionnelle visant à établir la vérité et à faire la lumière sur les violations passées ont favorisé la mise en visibilité des récits aikewara sur leur expérience sous la dictature. Dans cette perspective, les Aikewara sont reconnus comme des victimes du régime dictatorial par des institutions dont la mission est précisément de rendre justice aux victimes, alors même que la responsabilisation pénale des auteurs de ces violences demeure impossible. Cette reconnaissance constitue une forme de réparation symbolique dans la mesure où des représentants de l’État brésilien valident leurs témoignages en tant que faits et corroborent ainsi la version selon laquelle leurs trajectoires sont marquées par l’injustice, et non par le consentement ni par la collaboration avec les militaires.
À ce titre, les mécanismes de la justice transitionnelle font partie d’un processus de victimisation, entendu comme le processus par lequel les individus se définissent et sont définis comme victimes. Ce processus, disputé dans l’espace public et susceptible de générer des controverses, implique différents acteurs ainsi qu’une prise sur les faits passés pour la production d’une histoire (Barthe 2017). Au Brésil, les politiques de réparation de la CA/MJ ne constituent donc pas une finalité en soi, mais un moyen par lequel le passé dictatorial, ainsi que les versions des acteurs impliqués, est publiquement disputé.
Alors que le discours de la justice transitionnelle repose souvent sur une frontière nette entre victimes et bourreaux, le cas des Aikewara illustre la complexité de définir les catégories de victimes sous les régimes autoritaires, notamment lorsque des populations sont impliquées dans la répression militaire. Ces situations peuvent être analysées à la lumière de ce que Primo Levi (1986) qualifie de « zone grise », où l’expérience des individus forcés de coopérer avec leurs persécuteurs ne peut être comprise en termes moraux dichotomiques. De même, la responsabilité de leurs actes ne saurait être analysée en termes de choix volontaire dans la mesure où leurs actions ont souvent été imposées par des conditions extrêmes de violence. Ce fut également le cas dans d’autres conflits armés en Amérique latine, comme au Guatemala, où la participation de paysans, dont de nombreux autochtones, aux Patrouilles d’autodéfense civile pour réprimer les guérillas a été effectuée sous la contrainte de l’État guatémaltèque dans les dernières décennies du XXe siècle (Kobrak, 2002; Taylor, 2011).
Le processus d’amnistie des Aikewara témoigne aussi d’un parcours mobilisant divers acteurs dans une quête de reconnaissance du statut de victime. Ce processus est facilité par les politiques de mémoire et de réparation mises en œuvre au niveau national, bien que leur suivi en institution dépende du soutien de ceux occupant ces fonctions. Enfin, loin d’un silence total, différentes versions ont circulé concernant l’implication des Aikewara dans la guérilla de l’Araguaia, tant lors des opérations militaires qu’après celles-ci, parmi les habitants, les familles, les journalistes et les militaires. À travers les mécanismes de justice transitionnelle, la reconnaissance des Aikewara comme victimes de la dictature place ainsi leurs témoignages au cœur d’une relecture de l’histoire sous l’angle des droits humains.
Notes de fin
[1] Suruí est une dénomination des Aikewara attribuée par des groupes religieux et l’État brésilien depuis les années 1950. Nous allons adopter Aikewara, afin de respecter l’autodénomination de ce peuple.
[2] “É necessário muito cuidado ao tratar dessa questão da guerrilha com os suruí [...]. Eles foram muito marcados, muito machucados com essa história. É complicado falar de mutilação de corpos, de caçadas a guerrilheiros” (CEV-PA, 2022 : 327–28).
[3] La Fundação Nacional do Índio (Funai) est um organe de l’État brésilien, créé après l’extinction du Serviço de Proteção do Índio (SPI), suíte à des dénonciations de violations à l’encontre des peuples autochtones présentées en 1968 dans le Rapport Figueiredo. À l’époque, les autochtones étaient considérés comme une population sous la tutelle de l’État à travers la Funai. Cf. (Valente 2019).
[4] « Os índios Suruí são dos poucos habitantes da região que falam abertamente sobre a guerrilha. Eles a acompanharam de perto: serviram de batedores para o Exército, guiando os soldados na mata e indicando pistas dos guerrilheiros » (Movimento, 1978 : 10).
[5] « é que eles [militares] se serviram dos índios Suruí para guias na mata para pegar estes guerrilheiros. E se serviram desses próprios lavradores aí de dentro da mata, que foram torturados, alguns morreram. E os outros que não morreram sofreram uma lavagem cerebral e transformaram-se em guias e colaboradores do Exército. [….] Eles abriram uma estrada, deram a terra para o povo e tal, mas também deram o condicionamento mental. É um pessoal que ficou despersonalizado » (Movimento, 1978b : 10).
[6] « se expontaneamente (sic) os pistoleiros colaboravam com as tropas militares, vários dos posseiros da região – e mesmo índios suruí – tiveram que ser intimidados ou mesmo torturados, segundo denúncias feitas pela Igreja. » (Movimento, 1978a : 11)
[7] « Sem a menor consciência do trabalho – diga-se dimensão ideológica – que estavam prestando » (O Pasquim, 1978 : 26).
[8] « Eram constantemente maltratados e humilhados com gritos e empurrões, comiam apenas uma vez por dia e à noite por não poderem fazer fogo se alimentavam de jabá cru com farinha. [...] As ações militares foram criminosas quando exploraram incapazes como escravos e quase destruíram sua cultura e a perpetuação da etnia. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 01-02).
[9] « teve lugar um dos episódios mais obscuros da história do Brasi: a transformação de índios em mercenários de guerra do Exército para combater a Guerrilha do Araguaia » (Figueiredo, 2012).
[10] « Desviando o olhar, não pararam de repetir: “Índio tinha muito medo”. » Lucas Figueiredo retranscrit le témoignage des Aikewara en soulignant qu’ils se sont exprimés dans un portugais qualifié de précaire. Il importe cependant de préciser que cette appréciation ne prend pas en considération l’imposition historique de la langue portugaise aux populations autochtones depuis la colonisation du Brésil au XVIe siècle, phénomène qui a conduit à l’instauration d’un bilinguisme contraint parmi de nombreux groupes, voire à la disparition de certaines langues autochtones. Des recherches récentes mettent en évidence l’appropriation singulière de la langue portugaise par les peuples autochtones en fonction de leurs réalités sociolinguistiques, culturelles et historiques, ce qui témoigne d’une pluralité et d’une dynamique propres à ces processus linguistiques. Cf. (Gorete Neto, 2022).
[11] « causou constrangimento na maioria [dos militares]. Mas índio é índio » (Figueiredo, 2012)
[12] Lucas Figueiredo justifie l’importance de ces courriels par le fait qu’il s’agirait de la première fois où un officiel affirme que les autochtones ont mutilé les corps. Il ne remet en question que l’authenticité de ces messages en précisant qu’il n’y a aucune raison d’en douter : l’adresse mail de l’expéditeur est la même que celle utilisée par le colonel pour vendre en ligne les livres qu’il écrit sur la lutte armée et le destinataire est la personne qui lui a transmis la copie du courriel, datée et signée de sa main. Cf. (Figueiredo, 2012 : 3)
[13] Bien que la recherche de Hugo Studart soit innovante grâce à de nouvelles sources, ces dernières restent anonymes pour préserver la confidentialité de ses informateurs. La crédibilité de sa thèse est remise en question lorsqu’il est révélé que Studart est le fils d’un militaire ayant occupé un poste stratégique dans le service de renseignement de l’aéronautique durant la répression de la guérilla (Monteleone, 2018), suggérant que ses principales sources étaient probablement des militaires impliqués dans les opérations.
[14] Le texte mentionne le rapport de 2007 de la Commission spéciale de morts et disparus politiques (CEMDP), installée en 1995 dans le Secrétariat aux droits humains de la Présidence de la République, et confirmant la mort de plus de 70 guérilleros ; en 2009, la CA/MJ a amnistié plus de 50 habitants de la région, attestant ainsi de la reconnaissance étatique de l’existence du conflit dans l’Araguaia.
[15] « Com efeito, em decorrência da intervenção do Estado Brasileiro, que sitiou a região, os camponeses e indígenas foram obrigados a abandonar suas casas e suas terras ou cessar as atividades necessárias a sua subsistência e a de seus familiares. Além disso, perderam seu único meio de subsistência, pois suas roças (plantações) e criações foram destruídas pelo Exército como forma de impedir o sustendo das forças guerrilheiras » (SEI 2010.01.66655 : fls. 51).
[16] « servido, de per se, como prova cabal do seu dever de reparação às vítimas. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 46-V).
[17] « Seguiram-se anos de silêncio sobre a violência então praticada, quando os Aikewara tiveram o seu território ocupado pelas Forças Armadas, tendo sido submetidos a toda sorte de humilhação e privações (fome, violência e medo). Por dois anos seguidos, todos os homens adultos foram obrigados a colaborar, contra a sua vontade e sem qualquer esclarecimento, com a repressão ao movimento guerrilheiro do Araguaia – episódios traumáticos para toda a sociedade Aikewara, onde se verificou ainda a morte de crianças nascidas prematuramente nesse período » (nous soulignons) (SEI 2010.01.66655 : fls. 47).
[18] « eu tou contando aqui pra vocês porque... tem que... as pessoas assim... pode ser assim o povo do Brasil, do mundo todo pra saber direito que aconteceu mesmo esse... esse horrível acontecimento, é "guerra" né? no tempo da guerrilha, né? É por isso que eu tou contando aqui um pouco. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 99).
[19] « Aí nós num sabia de nada, aí nós foi assim mesmo, enganado” (SEI 2010.01.66655 : fls. 104).
[20] « É... nós sofremos demais [...] nesse tempo que aconteceu essa “guerra” aí, nós num sabia de nada, nós entremo assim mesmo sem saber de nada! [...] inocente mesmo nós entremo, num sabia de nada! » (SEI 2010.01.66655 : fls. 113).
[21] « ele falou pra mim: - Tu sabe por quê nós tamos levando vocês? Porque é "terrorista", rapaz! ele vai tomar todinha a terra de vocês! [...] Num sabia nem o que é nada... Aquele tempo a gente num sabia de nada... [...] Nós num sabia o que era "terrorista", "comunista", nós num entende o que era "terrorista" » (SEI 2010.01.66655 : fls. 105).
[22] « aí nós vimo quatro cara morto lá! (mais “Moreninho, que nós vinha) Pois já mataram um… a polícia obrigou “Moreninho” a pegar assim morto aí… […] Ai pro “Moreninho assim: - Pega aí, índio! vamos voltar mais eu (a polícia) - Ah, num vou botar não! “Moreninho” falou pra ele! - Não! bota!! ele [soldado] obrigou ele. Aí “Moreninho botou pra ele, dentro do elicóptero! Era pra trazer pra cá pro São Raimundo, num sei aonde que enterraram! Acho que foi bem aqui mesmo que enterraram! (…) “Num sei se cortaram a cabeça, num sei o quê eles fizeram com ele… Eu sei que nós vimo quatro home lá morto, mais o “Moreninho”! » (SEI 2010.01.66655 : fls. 135-136).
[23] « Que as forças repressivas recrutaram de modo compulsório [...], de 1972 a 1974, praticamente todos os homens adultos da aldeia para servirem de guias, na mata, a ‘caça’ aos guerrilheiros, episório traumático para toda a sociedade Aikewara. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 179-V).
[24] Pour les Aikewara, les karuwara sont des esprits dangereux, jamais humains, qui vivent sur leur territoire ancestral et sont considérés comme des ennemis capables de provoquer maladies, mort ou violence. Le rituel karuwara, qui comprend danses, chants et préparation collective de nourriture, vise à protéger la communauté contre ces esprits et à prévenir les tragédies qu’ils pourraient engendrer. Cf. (Calheiros 2014).
[25] « Os Aikewara afirmam, categoricamente, que desconheciam os motivos dos militares para as ações violentas. [...] Os homens adultos recrutados foram tratados como prisioneiros de guerra, submetidos a regime servil de privações e passaram por todo tipo de humilhações. [...] Portanto, a ocupação destruiu não somente as bases matérias (sic) como as simbólicas de existência da comunidade indígena » (SEI 2010.01.66655, fls. 179-V-180).
Bibliographie
Paige, A. (2009). « How “Transitions” Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice ». Human Rights Quarterly 31 (2): pp. 321‑367.
Barthe Y. (2017). Les retombées du passé - Le paradoxe de la victime. Éditions du Seuil.
Calheiros O. (2014). « Aikewara: Esboços de uma sociocosmologia tupi-guarani. » Thèse (Doctorat en anthropologie), Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGAS - Museu Nacional.
——— (2015). « "No tempo da guerra": Algumas notas sobre as violações dos direitos dos povos indígenas e os limites da justiça de transição no Brasil ». Re-vista Verdade, Memória e Justiça, 9, pp. 9-12.
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2001). “Relatório Anual Julia Gomes Lund e outros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs Brasil”. Relatório Anual 2000 N° 33/01. Washington D.C.: Comissão Interamericana de Direitos Humanos. [URL : https://www.cidh.org/annualrep/2000port/11552.htm. Consulté le 8 octobre 2024].
Corrêa C.H.S. (2013). “Em Algum Lugar das Selvas Amazônicas: As Memórias dos Guerrilheiros do Araguaia (1966-1974). Thèse (Doctorat en histoire), Brasília: Universidade de Brasília.
Ferraz I. (2019). Os Surui-Aikewara e a guerrilha do Araguaia: um caso de reparação pendente. Campos - Revista de Antropologia, Vol. 20, n°2 : 80-88.
Figueiredo L. (2012). [ARQUIVO DE REPÓRTER] O segredo dos índios Aikewara. Blog do Lucas Figueiredo. [URL: https://lfigueiredo.wordpress.com/2012/01/31/arquivo-de-reporter-o-segredo-dos-indios-aikewara/. Consulté le 9 avril 2024]
Gallo C.A. (2012). Do luto à luta: um estudo sobre a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. Anos 90, 19 (35), pp. 329-361
García-Godos J. (2013). « Victims’ Rights and Distributive Justice: In Search of Actors ». Human Rights Review, 14 (3), pp. 241‑255.
Gorete Neto M. (2022). « Reflexões Sobre o Português Falado por Povos Indígenas: resistência e ressignificação ». Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, 31 (67), pp. 214‑31.
Jucá B. (2019). “A incansável busca pela história do irmão desaparecido do Araguaia”. El País Brasil. [URL: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/09/politica/1557426938_355509.html. Consulté le 25 octobre 2024].
Kobrak P. (2002). Huehuetenango: historia de una guerra. Huehuetenango: CEDFOG.
Levi P. (1986). Les naufragés et les rescapés: quarante ans après Auschwitz. Gallimard.
Pedretti Lima L. (2022). As fronteiras da violência política: movimentos sociais, militares e as representações sobre a ditadura militar (1970-1988). Thèse (Doctorat en sociologie). Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
McEvoy K. & McGregor L. (2010). Transitional Justice from below: Grassroots Activism and the Struggle for Change. Oxford: Hart.
Monteleone J. (2018). “Sobre as fontes de Hugo Studart em Borboletas e Lobisomens”. Opera Mundi. [URL : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/sobre-as-fontes-de-hugo-studart-em-borboletas-e-lobisomens/. Consulté le 10 avril 2024]
Movimento (1978a). “A guerrilha chega à imprensa”. Rio de Janeiro, n° 159. [URL: https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=318744&pasta=ano%20197&pesq=&pagfis=3477. Consulté le 20 octobre 2024].
——— (1978b). “História da Guerrilha do Araguaia”. Rio de Janeiro, n° 168. [URL: https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=318744&pasta=ano%20197&pesq=&pagfis=3259. Consulté le 20 octobre 2024
O Pasquim (1978). “Os índios continuam sendo mortos”. Rio de Janeiro, n° 485. [URL: https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=124745&pasta=ano%20197&pesq=&pagfis=17282. Consulté le 20 octobre 2024]
CEV-PA (2022). “O sofrimento Aikewara - relatório”. Dans Comissão Estadual da Verdade e Memória do Pará: volume 2. Comissão Estadual da Verdade e Memória do Pará. Volume 2. Editora Pública Dalcídio Jurandir : pp. 365–429
Ponce García A. (2015). Trayectoria de la(s) memoria(s) Aikewara: del evento de la Guerrilla de Araguaia a la Comisión de Amnistía en el actual contexto de revisión de la dictatura brasileña. Dissertation (master), Campinas: Universidade Estadual de Campinas
Skaar E., García-Godos J. & Collins C. (2016). Transitional justice in Latin America: The uneven road from impunity towards accountability. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
SEI 2010.01.66655 (2010-2015). Comissão de Anistia, Ministério da Justice. Brasília : Archives Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC).
Taylor M.(2011). «Viviendo “en aquellos tiempos” en Ixcán, Guatemala: la violencia y la vida en las PAC ». Mesoamérica, 32 (53), pp. 157‑88.
Teitel Ruti (2014). Globalizing Transitional Justice: Contemporary Essays. Oxford University Press.
Teles J. de A. (2013). “A atuação dos familiares de mortos e desaparecidos políticos na transição democrática brasileira”. Dans Flunser Pimentel I. & Rezola M.I. Democracia, ditadura: memória e justiça política. Tinta da China, pp. 43-66
Valente R. (2019). “Agonia e extinção do Serviço de Proteção ao Índio na ditadura militar”. Campos - Revista de Antropologia, 20 (2) : pp. 37–58.
Vasconcelos F. (2007). “STJ restabelece decisão de juíza sobre a guerrilha do Araguaia”. Folha de S. Paulo, 20 de julho de 2007, seç. Brasil. [URL: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2009200719.htm. Consulté le 29 octobre 2024].
Pour citer cet article :
Rezende, C. (2025). Du soupçon à la réparation : la demande d’amnistie du peuple Aikewara et le passé dictatorial au Brésil. RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/du-soupcon-a-la-reparation-la-demande-d-amnistie-du-peuple-aikewara-et-le-passe-dictatorial-au-bresil-carolina-rezende.html
Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()