« Chilangos » et « campesinos ». La migration internationale des Indiens depuis les villes mexicaines
Au Mexique, depuis les années 1990, l’essor de la migration vers les États-Unis et la recomposition des flux migratoires ont transformé une ville comme Mexico, passant de pôle d’attraction à pôle de départ des migrations. L’analyse de ces mobilités depuis la ville mobilise une série de concepts conçus sur un mode dichotomique : migration rurale et migration urbaine ; migration interne et migration internationale...
...Or ces catégories d’analyse rendent difficile l’observation de mouvements complexes. En partant des trajectoires migratoires de migrants indiens qui ont vécu une double migration, des campagnes vers les villes d’abord, puis des villes vers les États-Unis, et dont l’expérience ne peut donc se réduire ni au profil d’ « urbains » ni à celui de « ruraux », cette présentation vise à questionner ces catégories et, indirectement, la distinction entre villes et campagnes.
Mots clés : Indiens ; Migration internationale ; Migration interne ; Mexique ; Projet migratoire.
....................................................
Anna Perraudin
Docteure en sociologie
EHESS
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
« Chilangos » et « campesinos ». La migration internationale des Indiens depuis les villes mexicaines
Introduction
Migration et urbanisation sont deux phénomènes étroitement liés (Withol, 2009). Depuis la fin des années 1980, au Mexique comme dans d’autres pays du sud, ce lien s’est complexifié : les villes qui étaient jusqu’alors les destinations privilégiées de l’exode rural, sont apparues comme des pôles de départ, vers d’autres villes au sein du pays ou vers des destinations internationales (Bertrand, 2010). La migration, interne et internationale n’est plus uniquement le fait de « ruraux », mais aussi de « citadins »(1). Au Mexique, près de la moitié des migrants partis pour les États-Unis au cours des deux dernières décennies résidaient avant leur départ dans des villes (Durand et al., 2001)(2). La question de la spécificité de ces migrations depuis le contexte urbain s’est alors posée avec une acuité inédite, questionnant les fondements d’un champ d’études migratoires dont les outils théoriques et méthodologiques avaient largement été établis à partir du contexte rural (Fussell et Massey, 2004). L’opposition entre « urbain » et « rural », fondatrice dans la sociologie urbaine et amplement discutée, en particulier en Amérique Latine, s’est ainsi vue réactualisée (Valladares et Prates, 2003).
La migration internationale depuis les villes renouvelle en effet le point de vue sur l’expérience urbaine des acteurs de l’exode rural. Dans la seconde moitié du XXe siècle, une ample littérature s’est penchée sur la situation de ceux que Sayad qualifiait, dans un autre contexte géographique, de paysans « dépaysannisés » (Sayad, 1999). Avec les marges urbaines, l’exode rural a fait l’objet d’une attention particulière dans ces travaux sur la fabrique de la citadinité (Redfield, 1949 ; Lewis, 1975; Agier, 1999 ; Dureau et al., 2004 ; Baby-Collin, 2005, etc.). Or le détour par la migration internationale offre un angle inédit sur la question de la liminalité entre urbain et rural, si l’on observe les stratégies migratoires de « double migrants » pour lesquels la migration internationale fait suite à une première migration relevant de l’exode rural. La plupart des travaux qui ont cherché à évaluer les atouts et les obstacles que constituait le contexte urbain pour la migration internationale se sont penchés sur des territoires et des populations dont la qualification comme « citadin » ne posait pas question (Fussell et Massey, 2004 ; Lozano, 2002). Ils gagnent à être complétés par une approche tenant compte des stratégies hybrides que peuvent développer certains migrants qui bénéficient d’une double attache, urbaine et rurale. Comment ces candidats à la migration internationale mobilisent-ils, dans la conception et la réalisation de leur projet migratoire, les ressources que leur procurent chacun de ces deux contextes ? Leur migration est-elle une migration de ruraux ? D’urbains ?
Il importe également d’inclure dans l’analyse les représentations de l’urbain et du rural qui donnent sens aux pratiques des migrants. En effet les contextes ruraux et urbains opèrent non seulement en tant qu’espaces concrets, supports de ressources matérielles mises au service du projet migratoire, mais également en tant que supports d’identifications qui font office de ressources symboliques. « Paysan » ou « citadin » sont des images réifiées, impropres à restituer les modes de vie multiples que recouvrent ces représentations et la conscience de soi que développent les individus auxquelles elles sont apposées (Kearney, 1995). Elles sont par ailleurs normatives et sources de stigmatisation ou, au contraire, de valorisation (Berry-Chekhaoui et Deboulet 2000). Une approche constructiviste permet ainsi d’entrevoir comment les identités d’urbains et de ruraux, construites comme exclusives, peuvent être combinées et faire l’objet d’usages stratégiques de la part des migrants, en fonction des contextes d’interaction(3). Dans la mesure où les conceptions de l’espace et les perceptions de soi ne sont pas sans effets sur les pratiques des acteurs, elles méritent d’être intégrées à l’analyse (Faret, 2006).
Les trajectoires de certaines populations, parmi lesquelles les populations indiennes, sont alors éclairantes. Engagés dans d’importants flux migratoires tout au long du XXe siècle, d’abord vers les villes mexicaines puis vers les États-Unis, les migrants indiens se trouvent au pivot de ces deux mouvements (Fox et Rivera, 2004). Leur expérience permet ainsi de penser les connexions entre rural et urbain, migration interne et internationale. Ceux qui se sont durablement installés dans des villes mexicaines avant de chercher de meilleures conditions de vie aux États-Unis offrent une perspective particulièrement intéressante. Figures de l’étranger, les Indiens dans les villes mexicaines sont souvent qualifiés de « paysans » ou campesinos, une identification qui revêt une portée négative, tandis qu’eux-mêmes revendiquent, à Mexico notamment, d’être considérés comme des citadins comme les autres, des chilangos. La migration internationale agit comme un révélateur de cette construction identitaire complexe.
L’enquête ethnographique permet de restituer à travers une approche qualitative la complexité des trajectoires migratoires, le contenu des projets ébauchés par les migrants, ainsi que le regard que les migrants portent sur leur propre expérience. Cette analyse repose donc sur une ethnographie multisituée à partir d’entretiens et d’observations menées à Mexico et aux États-Unis entre 2003 et 2009, dans un groupe indien qui comporte environ 200 familles. Identifiés comme « otomis » en référence à la langue qu’ils parlent, ou comme « Santiaguenses » de par le nom du village dont ils proviennent et avec lequel ils ont maintenu un lien fort, les migrants indiens originaires du village de Santiago Mexquititlán (Etat de Querétaro)(4) se sont établis à Mexico à la fin des années 1980. Depuis le début des années 2000, les États-Unis, et en particulier le Midwest, commencent toutefois à attirer cette population ; pour l’heure, ce sont surtout les hommes qui partent (Perraudin, 2011).
Après avoir examiné la grille de lecture traditionnelle des migrations « depuis la ville » et « depuis la campagne », des situations concrètes qui interrogent cette distinction seront analysées à partir de l’expérience migratoire des Otomis.

Figure 1. Schéma des flux migratoires des Indiens otomis
I. Urbains, ruraux, Indiens : esquisses de profils migratoires
L’essor de la migration internationale depuis les villes mexicaines est devenu notable dans les années 1990. Il s’explique par l’urbanisation de la population mexicaine au long du XXe siècle, par la saturation du marché du travail des grandes villes à la suite des crises économiques successives des années 1980, et par l’attractivité de l’économie nord-américaine (Lozano, 2002). En dépit de son ampleur, le phénomène demeure relativement méconnu(5), notamment parce qu’il est particulièrement difficile à observer et à théoriser(6) (Hernández-León, 2008). Les travaux sur la migration depuis les villes qui se développent au Mexique depuis une vingtaine d’années reposent pour l’essentiel sur une comparaison avec les migrations issues du monde rural, et tendent à dégager des profils-type des migrants qui réactivent la dichotomie « ruraux »/ « urbains ». A la fois de par leurs trajectoires et de par les représentations qui leur sont associées, des cas comme ceux des populations indiennes urbaines illustrent toutefois les limites de cette construction catégorielle.
A. Migrant « rural » versus migrant « urbain »
Les villes génèrent-elles des formes migratoires spécifiques ? En premier lieu, la probabilité de concevoir un projet migratoire pour les États-Unis est moindre depuis une grande ville que depuis un autre lieu de départ (Fussell et Massey, 2004 : 162). Le marché du travail diversifié des grandes villes offre davantage d’opportunités d’emplois et de mobilité sociale qu’en milieu rural. Il y est également plus facile d’emprunter de l’argent et d’accumuler des capitaux pour investir dans des projets économiques. Enfin, en milieu urbain, les devises sont souvent investies dans la création de petites entreprises ou de négoces, ce qui favorise la création d’emplois locaux, plutôt que leur destruction (Ibid). La nécessité de migrer se fait donc moins impérative en ville(7).
En s’appuyant sur des données statistiques et sur une analyse en termes de flux migratoires, une série de recherches a alors cherché à dessiner une sorte de profil-type du migrant urbain. Celui-ci s’oppose, souvent point par point, à son homologue rural (Lozano, 2001).
Le modèle de la migration rurale, d’abord, a été conçu à partir de la région traditionnelle d’émigration qui concentrait les flux migratoires du Mexique vers les États-Unis jusqu’aux années 1980(8). D’après ce schéma, la migration rurale se compose essentiellement d’individus de sexe masculin, au faible niveau de scolarité. Leur taux de retour au Mexique est plus faible que pour les citadins, mais les probabilités pour qu’ils envoient de l’argent à leur famille sont plus élevées (Roberts et Hamilton, op.cit. ; Lozano et Rivera-Sánchez, op.cit.). Ils font un usage intensif de leurs réseaux sociaux, construits à partir de liens familiaux, d’amitié ou d’une origine géographique partagée, lors de l’organisation du départ et du recrutement du passeur mais aussi lors de leur installation dans le lieu d’arrivée. En conséquence, ils ont tendance à se concentrer dans un petit nombre de lieux de destination (Ibid. ; Ibid.).
Le profil-type du migrant urbain est le contrepoint de celui qui a été ébauché pour les migrants ruraux. Les émigrants citadins ont un meilleur niveau scolaire que leurs homologues ruraux (Marcelli et Cornelius, 2001, par exemple). Ils sont légèrement moins jeunes, la proportion de femmes est plus grande, et ils ont moins tendance à s’installer de façon permanente aux États-Unis. Outre cette plus grande circularité migratoire, l’une des différences majeures avec le schéma rural réside dans le type de réseaux sociaux mobilisés. Les relations familiales et amicales jouent un rôle moindre dans l’organisation du voyage. Les migrants urbains ont également moins recours à des passeurs recrutés dans leur ville de résidence, soit qu’ils les engagent directement dans une ville-frontière, soit qu’une proportion plus élevée d’entre eux ait accès à des visas de tourisme (Lozano et Rivera-Sánchez, op.cit.). La migration depuis la ville s’organiserait donc sur un mode plus individuel. Elle donnerait lieu à une installation plus diffuse sur le territoire nord-américain.
Il convient toutefois de préciser que ces profils sont soumis à débat, y compris par les auteurs qui les ont forgés et qui reconnaissent la dimension schématique inhérente à tout idéal-type. Des divergences apparaissent quant à la part des femmes, l’âge des migrants ou leur plus grande mobilité. Les auteurs s’accordent cependant sur l’usage différentiel que feraient des réseaux sociaux migrants urbains et migrants ruraux. Dans la ville, espace d’anonymat, de différenciation sociale et de division du travail, les relations sociales seraient plus fragmentées (Hernández León, 2008). On retrouve là les grands traits de la sociologie classique qui oppose sociabilités communautaires des campagnes et processus d’autonomisation et d’individualisation dans les villes(9).
Les variations du contenu de ces idéaux-types, selon les périodes et selon les auteurs, rappellent toutefois les limites de cette approche quantitative des flux migratoires. Le profil-type « urbain » recoupe par ailleurs des populations si hétérogènes (position sociale, origine ethnique, insertion sur le marché de l’emploi, niveau éducatif, etc.) qu’il présuppose une généralisation très large. Pour contourner ces difficultés et mieux cerner les particularités de la migration urbaine, certains auteurs ont proposé d’intégrer la taille de la ville comme une variable déterminante, permettant d’expliquer les caractéristiques socio-économiques des migrants et de leurs schémas migratoires (Roberts et Hamilton, op.cit. ;Massey et al, 1994). D’autres ont mené des recherches sociologiques mêlant approche qualitative et quantitative, consacrées à des populations spécifiques, dont le profil contraste a priori avec celui des migrants ruraux : femmes, membres des classes moyennes, ouvriers spécialisés, micro-entrepreneurs (Papail, op.cit. ; Arias et Woo, op.cit. ; Hernández León, op.cit. ;Castañeda, 2009). Si ces approches partent de l’impossibilité d’établir un profil-type migratoire valable pour l’ensemble des citadins, elles reprennent donc l’idée d’une nette différenciation entre contextes urbain et rural.
A l’inverse, des auteurs s’attachent à souligner les similitudes et les passerelles qui s’établissent entre des points de départ supposés divers. Dans une étude comparative menée dans l’Etat de Morelos sur la migration depuis une ville et depuis un village, Fernando Lozano et Liliana Rivera-Sánchez (op.cit.) concluent que le contexte migratoire pris dans son ensemble détermine davantage les formes de la migration que la taille du lieu de départ. Ils mettent alors en évidence le rôle de la migration interne comme un phénomène qui brouille les limites entre migration urbaine et rurale. Dans cette perspective, qui prétend non pas opposer mais articuler ville et campagne, l’expérience migratoire des populations indiennes s’avère tout particulièrement heuristique.
B. Les Indiens dans les villes mexicaines. Migrants et résidents : des citadins comme les autres ?
Les populations indiennes mexicaines sont des acteurs majeurs de l’exode rural et de l’urbanisation qui s’en est suivie pendant la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd’hui, plus d’une personne sur trois (38,5%) qui se déclare indienne au Mexique vit dans une ville (INEGI, 2000), au point que l’expression d’ « Indien urbain » a fini par se diffuser(10). De nombreux groupes et individus d’abord engagés dans des migrations cycliques, saisonnières, se sont installés durablement dans les villes. Même si elle se donne davantage à voir dans le centre ou dans les faubourgs(11), à Mexico la présence indienne s’est diffusée dans toute la ville, sans aboutir à la constitution de quartiers spécifiques (Hiernaux, 2000). Les migrants originaires de Santiago illustrent cette insertion dans les interstices de la ville, tout en se caractérisant par leur grande précarité. Plusieurs familles ont en effet construit des micro-bidonvilles dans les décombres d’immeubles détruits par le tremblement de terre de 1985 ou squatté des immeubles abandonnés, en plein centre-ville. L’installation dans le centre relève d’un choix: outre les possibilités de logement que le centre recèle, la présence de bars ou d’hôtels fournit un débouché économique aux femmes qui vendent de l’artisanat, des cigarettes ou des bonbons à l’unité. La grande majorité des enquêtés sont commerçants ambulants ; certains hommes lavent les pare-brise des voitures arrêtées aux carrefours, ou travaillent dans le bâtiment avec des contrats journaliers. A partir de 2001, la mise en place de politiques publiques inspirées du multiculturalisme a toutefois permis à une soixantaine de familles de Santiago de devenir propriétaires d’un appartement construit sur le terrain précédemment squatté. Parallèlement à leur insertion urbaine, la plupart des familles ont maintenu des liens forts avec les lieux d’origine : certaines y sont propriétaires d’un lopin de terre ou d’une maison, d’autres se rendent au village pour des occasions spéciales, comme la fête du saint local (Sánchez, 1995 ; Martínez, 2004).
Bien que l’installation dans les villes prenne des formes très diverses en fonction des histoires collectives et individuelles, les migrants identifiés comme indiens ont rencontré des obstacles spécifiques. La marginalisation spatiale, sociale, économique et culturelle dont ils font l’objet en est une première manifestation. Le fait qu’ils continuent à être renvoyés à leur origine rurale dans leurs interactions quotidiennes avec les autres citadins et avec les institutions, y compris lorsqu’ils sont nés en ville ou y résident depuis plus de dix ans, en est une autre. Comme j’ai pu le constater lors du travail de terrain, il n’est pas rare qu’avec une bienveillance empreinte de paternalisme, des citadins conseillent aux Indiens de retourner dans des campagnes où ils trouveraient de meilleures conditions de vie. Cette assignation continue à la ruralité, profondément enracinée dans l’histoire coloniale (Bonfil, 2005), est source de souffrance pour des individus qui revendiquent, eux, le droit d’être traités en citadins à part entière. Cette exigence peut se manifester individuellement, par l’adoption d’habitus urbains, en termes de présentation de soi, d’expressions de langage ou de mode de consommation. A l’instar de Martin, 17 ans, certains jeunes nés en ville mais ayant grandi dans des groupes qui s’identifient publiquement comme indiens, se revendiquent « à 100% de Chilangolandia »(12). La volonté d’être considérés comme des citadins à part entière se manifeste aussi collectivement : des associations indiennes militent pour que le terme de « migrants », qui réactive la mémoire de l’exode rural, ne soit plus systématiquement utilisé pour les désigner et que lui soit préféré celui de « résidents ».
A partir des années 1990, les Indiens se sont engagés de façon massive et visible dans la migration vers les États-Unis. Le travail de terrain réalisé auprès des Otomis de Santiago Mexquititlán, confirme l’essor d’une migration vers les États-Unis depuis le début des années 2000, à la fois depuis le village d’origine et parmi les familles établies à Mexico. Cette migration irrégulière, essentiellement masculine, a pour principales destinations la Californie, le Wisconsin, l’Illinois et le Tennessee. Elle mobilise des adultes et des jeunes (à partir de 15 ans) au faible niveau éducatif.
La mobilité des populations indiennes tend à être analysée à travers une modélisation propre. Elle se rapproche du schéma rural précédemment cité, en raison du rôle prépondérant des réseaux sociaux, le réseau dit communautaire, considéré comme spécifique aux Indiens, venant renforcer les liens familiaux ou de proximité géographique (Sánchez, 2007). Migration interne et migration internationale ont toutefois généré deux champs d’études parallèles, qui pensent l’émigration à partir des villages : les travaux sur la mobilité internationale des Indiens installés en ville ne se comptent encore que sur le doigt d’une main(13). Pourtant, d’après Rubén Hernández-León, ces populations sont à l’origine de « l’émergence de nouveaux systèmes migratoires qui font le lien entre flux internes et flux internationaux » (2008 : 6).
Les expériences migratoires des Otomis ne peuvent être érigées en modèle des migrations urbaines ou même des migrations indiennes urbaines. Mais elles permettent d’observer la façon dont ses membres parviennent, à différentes étapes de leur migration, à combiner et resignifier l’urbain et le rural.
II. La résurgence de la tension ville/campagne aux différentes étapes du projet migratoire
Dans les expériences migratoires des « Indiens urbains » de Santiago Mexquititlán, la ville et la campagne constituent à la fois des espaces d’opportunités concrètes et le support d’identifications, d’imaginaires et de représentations différenciées.
A. L’empreinte du monde rural
Deux éléments illustrent l’usage que font les migrants otomis qui partent pour les États-Unis de leur ascendance rurale : l’organisation du départ et le choix du passeur, ainsi que le mode de présentation de soi adopté aux États-Unis.
Au moment de choisir leur passeur, d’abord, sans exception, tous les migrants rencontrés aux États-Unis ou à Mexico au cours de l’enquête s’en étaient remis à un passeur originaire de Santiago Mexquititlán, au lieu d’engager quelqu’un depuis Mexico ou depuis une ville-frontière comme le voudrait le profil-type des migrants urbains. Comment l’expliquer ? Le passeur du village est connu, recommandé, et donc estimé digne de confiance. Les candidats à la migration ont parfaitement conscience des risques qu’ils prennent en traversant la frontière. Choisir un passeur depuis le village permet de limiter ces risques, non seulement parce que les migrants se seront informés sur la réputation du passeur, mais aussi parce que le réseau communautaire est en soi gage de protection. « S’il y a un problème, moi, ici, je connais des gens. Je tire un fil, et l’autre, et puis l’autre, et j’arrive à la famille du passeur », explique un représentant indien(14). En outre, le convoi lui-même part de Santiago Mexquititlán. Pour les Indiens urbains, le périple vers les États-Unis commence ainsi par un voyage de retour, en bus, de Mexico au lieu d’origine – un déplacement géographique qui a aussi une portée symbolique. Le choix d’un passeur issu d’un lieu d’origine rurale n’est pas propre aux Indiens : les travaux menés auprès de résidents urbains ayant connu une migration interne montrent que ces derniers se tournent de préférence vers leur lieu d’origine, pour recruter un passeur, quelle que soit leur appartenance ethnique (Fussel et Massey, 2004; Arias et Woo, 2004 ; Lozano et Rivera-Sánchez, 2006). L’origine rurale constituerait donc un atout, par rapport à des candidats à la migration qui ne bénéficient pas du double ancrage rural-urbain.
Il est toutefois intéressant de noter que la migration interne et l’expérience d’insertion urbaine interfèrent dans ce processus d’ancrage des réseaux migratoires dans le lieu d’origine. Sur le groupe de migrants qui partent avec un passeur de Santiago se greffent en effet des personnes connues en ville. Ni originaires de Santiago, ni nécessairement indiennes, elles vont pourtant s’insérer dans le même réseau migratoire, bénéficiant dès lors elles aussi des garanties attribuées au passeur. Ainsi, dans l’un des convois qui a quitté Santiago pour les États-Unis en 2006, sur la dizaine de candidats à la migration, deux au moins n’étaient pas originaires du village mais faisaient partie de la famille par alliance de Santiaguenses. Le réseau qui se tisse quand les migrants organisent leur voyage depuis le lieu d’origine intègre donc les nouvelles relations qu’a favorisées la vie urbaine. La ville fonctionne alors comme un lieu d’échange et de brassage des expériences migratoires (Roberts et Hamilton, 2007). Dans un contexte de risques accrus à traverser la frontière, les passeurs jouent ainsi un rôle central dans le brouillage des frontières entre émigration rurale et émigration urbaine, et dans l’articulation des migrations internes et internationales.
L’origine rurale des Indiens urbains s’exprime également dans les modes d’identification qu’ils privilégient aux États-Unis lorsqu’ils se présentent à d’autres Mexicains. Les Santiaguenses affirment que lorsqu’ils sont interrogés sur leur origine par d’autres migrants, ils mentionnent le village dont ils sont originaires, y compris lorsqu’ils ont longtemps vécu dans de grandes villes mexicaines ou y sont arrivés très jeunes. Une telle réaction n’est pas spécifique aux Indiens, mais s’observe chez la plupart des migrants originaires de Mexico. Aux États-Unis, des représentations négatives sont en effet associées à la capitale mexicaine et à ses habitants: être identifié comme originaire de la capitale devient source de stigmate (Sabates et Pettirino, 2007). D’après mes enquêtés, être qualifié de chilango dans ce contexte migratoire pouvait relever de l’insulte, étant rattaché à une culture de l’astuce ou de la petite délinquance. Il est intéressant de noter qu’en développant ce mode d’identification, les Indiens non seulement réagissent comme les autres migrants provenant de Mexico, mais aussi mettent en exergue une aptitude à analyser et à s’adapter à des situations d’interaction complexes qui constitue une « compétence citadine » (Berry-Chikhaoui et Deboulet, op.cit.).
Pour les Indiens urbains, cette stratégie d’identification prend toutefois une signification particulière, puisqu’elle amène à faire le chemin inverse de celui effectué au cours des années précédentes. Les Indiens qui ont vécu dans une ville mexicaine s’y étaient efforcés de se fondre dans la masse des citadins pour éviter le racisme, comme le rappelle Tonio, orphelin de père et de mère, arrivé en ville avant l’âge de sept ans:
Bon, c’est vrai que depuis que je suis enfant, j’ai toujours cherché à parler comme tu m’entends parler maintenant [en espagnol et avec l’accent chilango]. Pourquoi ? A cause de la discrimination. Parce que je voyais bien, les autres enfants qui venaient de là-bas, comment on se moquait d’eux en ville. Moi, je me suis toujours dit « Non, je vais parler bien, je vais essayer de parler normalement, de parler l’espagnol »(15).
Au cours de la migration internationale, la valorisation des catégories identitaires s’inverse par rapport à celle en vigueur à Mexico. Tonio se raccroche alors à une origine villageoise qu’il a longtemps niée :
[Aux États-Unis] quand on me demandait d’où je venais, je disais que je venais de province, d’un petit village. Parfois on me posait des questions à cause de mon accent, on me disait que j’étais un chilango. Mais moi : « je suis né au village »(16).
Aux États-Unis, où de nombreux migrants sont originaires de « province », les racines rurales, l’ascendance régionale des migrants indiens, se trouvent revalorisées : c’est la revanche des identités locales et des campagnes, qui tranche avec la culture centralisatrice et urbaine qui prime au Mexique.
B. Les contraintes du monde urbain
Le cadre urbain n’est toutefois pas sans influence sur les formes que prend la migration vers les États-Unis, comme en témoignent les possibilités de réalisation du projet migratoire qu’il offre, l’image qu’il construit du migrant au sein du groupe, et les destinations qu’il détermine.
La vie quotidienne en ville, d’abord, de par les frais qu’elle engendre (loyer, nourriture, eau, etc.) rend plus difficile pour les migrants d’épargner et de réaliser des dépenses ostentatoires, sources de prestige. Si les motivations au départ sont diverses (améliorer sa situation économique, mais aussi vivre l’aventure, découvrir un autre mode de vie, s’affranchir de certaines contraintes sociales, acquérir des compétences professionnelles), avec des variations en fonction de l’âge et du genre, les indicateurs destinés à signifier aux proches restés au pays le succès de l’entreprise migratoire ne diffèrent pas de ceux qui sont opérants dans le monde rural : s’acheter une voiture et construire sa maison sont les signes matériels du succès. Automobile et maison ne sont pourtant que très peu adaptés au cadre urbain, et moins encore aux centres-villes d’où partent les Otomis. En raison de normes régulant le bâti en centre-ville, pour ceux qui ont bénéficié de l’accession à un appartement avant leur départ, aucune surenchère architecturale ne peut refléter le succès au-delà des frontières, comme il est d’usage dans les villages : impossible de rajouter un étage ou des ferronneries au balcon pour afficher son aisance. Ceux qui vivent encore dans les squats n’ont pour leur part aucun intérêt à investir dans un logement conçu comme précaire. Acheter un terrain pourrait être une option, mais où investir ? Dans le village d’origine ? Après quinze ans de vie dans la capitale, les enquêtés savent qu’ils ne se réinstalleront pas à la campagne. Dans un autre quartier de Mexico ? Dans une ville de taille moyenne ? Faute de trouver une réponse à ces questions, qui comportent une forte portée identitaire, la plupart des migrants diffèrent l’achat et ne construisent pas la maison qui marquerait aux yeux des autres le succès de l’entreprise migratoire.
L’investissement dans une voiture, une troca (spanglish pour « truck », qui désigne ici un 4x4),s’avère tout aussi inopérant. L’exemple de Pedro, retourné dans la capitale, après six ans aux États-Unis, au volant d’un rutilant 4x4, l’illustre. Dans le centre de Mexico, les places de parking sont rares, et en extérieur : dès le lendemain de son arrivée, la voiture était rayée sur toute sa longueur. Après quelques semaines, Pedro l’a remisée au village. Les histoires de voitures vandalisées ou abîmées par des accrochages, dont les réparations successives épuisent peu à peu la cagnotte du migrant de retour, sont nombreuses(17).
En outre, les représentations collectives de l’économie urbaine forgées au sein des groupes otomis contribuent à façonner une image négative des migrants. L’idée prévaut en effet que celui qui veut vraiment travailler en ville n’a pas besoin d’émigrer. Pourtant, dans les faits, les emplois accessibles aux Otomis à Mexico sont rares, précaires et mal payés. Il est donc bien question de représentations, socialement construites, des opportunités accessibles en ville. Elles s’élaborent par opposition à l’image d’un monde rural où, faute d’option économique alternative, il n’y aurait d’autre solution que de migrer et de se sacrifier pour les siens. En justifiant la migration depuis la campagne, ce discours légitime l’histoire migratoire des groupes otomis établis en ville et discrédite les migrants qui souhaitent partir pour les États-Unis depuis la ville: sur eux pèse alors le soupçon d’individualisme, d’arrogance ou d’irresponsabilité.
Enfin, les migrants indiens urbains ne se dirigent pas vers les mêmes destinations que ceux qui partent de la campagne. La spécialisation économique de certaines de ces destinations l’explique : en Californie, les migrants sont employés dans l’agriculture ; dans le Nord-Est des États-Unis (Indiana, Wisconsin, Illinois, Caroline du Nord et du Sud, Tennessee), autres destinations privilégiées des Otomis, ils travaillent essentiellement dans les services ou l’industrie. Or la perspective d’accomplir des travaux agricoles semble discriminante pour ceux qui ont grandi en ville, en raison des représentations que les Indiens urbains construisent d’eux-mêmes. Ils se définissent en effet comme des citadins qui ne sauraient plus travailler la terre. Rencontrés à Mexico en 2007, Marta et Bernardo comparent les possibilités que rencontrerait aux États-Unis leur fils qui a toujours vécu en ville, par rapport à des cousins qui viennent du village :
Bernardo : Mes cousins, aux États-Unis, ils travaillent dans les champs. Ils disent que c’est plus pénible physiquement mais que c’est mieux payé que travailler comme serveur ou pour faire la plonge. C’est plus dur mais ça rapporte plus.
Marta : Oui, mais c’est qu’eux aussi ils viennent de la campagne, ils sont habitués. Mais quelqu’un qui ne connaît rien du travail de la terre, comment est-ce qu’il pourrait partir avec eux ? Quelqu’un qui n’a aucune idée de comment on fait pour semer, pour faire pousser les récoltes… Mes fils, ils ne connaissent rien au travail de la terre.
Bernardo : Même moi je n’y connais plus rien ! (rires)(18).
Les réticences des Indiens urbains à travailler la terre aux Etats-Unis montrent bien l’indétermination dans laquelle ils se trouvent quant leur « identité pour soi », telle que la définit Goffmann dans ses analyses sur le maniement du stigmate et le rapport à soi, à savoir comme le ressenti le plus intime quant à son stigmate (Goffmann, 1975 : 128): même s’ils se présentent comme venant de la campagne aux Etats-Unis, leur choix de destination migratoire révèle qu’ils ne savent plus ou ne souhaitent plus travailler dans l’agriculture.
Finalement, les Santiaguenses qui n’estiment plus savoir travailler la terre ont un choix de destinations et de débouchés professionnels moindre aux Etats-Unis que ceux qui s’en jugent capables. L’ambivalence qui caractérise les identifications des Indiens urbains – pour soi et pour les autres –, a donc des conséquences concrètes sur l’organisation spatiale de la mobilité vers les Etats-Unis : parce qu’ils ne se conçoivent plus comme paysans, ils s’auto-excluent de certaines destinations et se concentrent dans les villes états-uniennes.
Que la ville apparaisse surtout, au terme de cette analyse comme un cadre contraignant le projet migratoire, ne signifie pas pour autant que les migrants n’y aient acquis aucune expérience qui pourrait influer positivement sur leur projet migratoire. Ce que certains auteurs qualifient de « compétence migratoire », de « savoir-circuler » ou encore de « compétence citadine » (Tarrius, 2002 ; Bredeloup, 2008 ; Berry-Chikhaoui et Deboulet, op.cit) se manifeste toutefois principalement dans un autre volet du projet migratoire, une fois aux Etats-Unis, et se traduit par la compétence à établir des relations, à analyser les interactions, à se localiser dans les villes et à se déplacer au quotidien (Perraudin, 2011).
Conclusion
Quel est l’impact du contexte de départ sur la conception et la réalisation du projet migratoire, pour des candidats à la migration internationale que l’on pourrait qualifier de « double migrants » dans la mesure où ils partent des villes mexicaines mais ont maintenu des attaches avec le monde rural ? L’analyse des stratégies migratoires des Indiens otomis, à Mexico, conforte les résultats de recherches préalables menées dans la région de Morelos (au Mexique) sur l’interconnexion entre migration interne et internationale : les candidats à la migration internationale qui ont une expérience de migration interne préalable construisent leur projet migratoire à l’intersection entre monde rural et monde urbain (Lozano et Rivera Sánchez, 2006). Les « double migrants » invitent à dépasser l’opposition conceptuelle entre migrations issues des villes et migrations issues du monde rural, pour mettre l’accent sur des stratégies migratoires qui puisent dans un monde et dans l’autre.
L’ancrage dans le monde rural constitue un net atout dont savent se saisir les Otomis, y compris lorsqu’ils se définissent par ailleurs comme « résidents » des villes mexicaines. Ils remobilisent les réseaux migratoires constitués depuis le lieu d’origine et choisissent un passeur qui en provient également. Hormis ces ressources en termes de capital social, le contexte rural s’avère déterminant par sa capacité à façonner les objectifs du projet migratoire : achat d’une automobile, d’un terrain et construction d’une maison sont les indicateurs d’une migration réussie, y compris lorsque l’environnement urbain en rend difficile la réalisation. Un décalage s’opère alors entre ce projet migratoire et l’indétermination dans laquelle se trouvent les migrants quant à l’espace concret dans lequel ils souhaitent matérialiser ses fruits. Car les Indiens urbains n’envisagent pas un retour définitif au village. La ville, où ils résidaient avant leur départ et où vivent toujours leurs proches, exerce des contraintes fortes (difficultés à stationner et normes architecturales, illusion d’emplois accessibles) et empêche de valoriser le projet migratoire. Les migrants peinent à tirer un prestige social de leur séjour aux États-Unis et à construire une image positive de leur expérience.
Outre les contraintes et opportunités propres à chacun des contextes de départ et la mise en évidence des usages stratégiques que peuvent en faire les migrants, le principal apport de cette analyse axée sur la subjectivité des migrants, est de mettre en évidence le poids des représentations de soi des migrants, comme urbains ou ruraux, sur leurs projets migratoires. Ces images sont construites en fonction des attentes exercées sur eux dans les différents contextes d’interaction. Ainsi, aux États-Unis, les Indiens urbains vont mettre en avant une origine rurale qu’ils tendaient à reléguer au second plan à Mexico. Cependant, parce qu’ils ne se considèrent plus comme des paysans à part entière, les migrants vont s’exclure des destinations aux États-Unis qui impliquent un travail agricole. Leurs représentations de soi ont donc une influence concrète sur leurs pratiques migratoires.
Situer l’analyse au croisement entre migration des villes et des campagnes, de la migration interne et internationale, amène enfin à reformuler une question récurrente dans la littérature sur les Indiens dans les villes mexicaines : celle de leur intégration au monde urbain. La position des Indiens est encore souvent pensée à travers une alternative : rester attaché au monde rural ou se fondre dans le monde urbain. Plutôt que d’observer seulement les groupes indiens à Mexico ou leur lien avec le village, faire le détour par la migration aux États-Unis met en évidence ce que les individus puisent dans chacun de ces espaces, y compris en termes de ressources identitaires.
(1) Ce phénomène s’observe également dans d’autres contextes géographiques. Ainsi au Sénégal, Dakar, reconnue depuis longtemps comme un pôle de transit des migrants de l’intérieur vers l’étranger, est aujourd’hui la première pourvoyeuse de migrants internationaux (Lessault et al., 2011).
(2) Le District Fédéral compte désormais parmi les dix premiers Etats expulseurs de migrants internationaux au Mexique (INEGI, 2000 ; 2010).
(3) Comme le souligne Rogers Brubaker, la notion d’identité est en soi ambigüe et donne lieu à des usages qui le sont tout autant : l’identité est reprise tantôt dans une perspective réifiante et essentialiste lorsqu’elle est le support de revendications de groupes minoritaires, tantôt dans une perspective constructiviste dans une série de travaux scientifiques (Brubaker, 2001). Nous utiliserons ici « identifications », non pas seulement au sens d’exo-identification opérée par des institutions classificatrices mais également au sens individualisé de « s’identifier à », sous l’influence de la littérature anglo-saxonne qui ne distingue pas autant les deux processus.
(4) Le lieu d’origine des migrants, Santiago Mexquititlán, défie d’ailleurs la catégorisation de « village »: ce gros bourg compte 17 000 habitants environ (INEGI, 2010), et dépasse donc très largement le seuil de 2500 habitants à partir duquel l’INEGI définit une localité comme « ville ». Cependant, du fait que la plupart des habitants de Santiago se dédient à l’agriculture, il me paraît pertinent de qualifier ce lieu de « village ».
(5) Si des travaux empiriques ont été réalisés sur Monterrey ou Guadalajara (Castañeda, 2009 ; Woo, 2007 ; Hernández-León, 2008 ; Papail, 2003), la migration internationale depuis Mexico a jusqu’à présent été moins explorée. L’étude de Mendoza Pérez sur la migration internationale depuis le quartier périphérique de Chalco ou les travaux de Liliana Rivera Sanchez doivent toutefois être signalés (Mendoza Pérez, 2009 ; Rivera-Sánchez, 2007).
(6) Les effets des migrations sont moins prononcés et moins visibles en milieu urbain. À la campagne, les envois de fond sont utilisés pour acheter des terres, tandis qu’en ville, ils sont davantage investis dans la consommation individuelle ou l’amélioration du logement (Fussell et Massey, 2004).
(7) La théorie du « cumul des causes » (theory of cumulative causation) veut qu’une fois engagé, le processus de la migration internationale continue à s’accroître. Il devient un processus qui s’auto-entretient (self-reinforced process), de plus en plus indépendant des conditions qui l’ont généré (Massey et al., 1994 : 1496). En milieu rural, la diffusion d’un capital social lié à la migration facilite l’élaboration du projet migratoire, par ailleurs, l’émigration et l’envoi de devises diminuent le nombre de terres cultivées, donc le besoin de main d’œuvre locale. Ce phénomène ne s’appliquerait pas dans le milieu urbain (Fussell et Massey, op.cit.).
(8) La région traditionnelle ou historique de l’émigration vers les Etats-Unis comprend les Etats de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima et Nayarit.
(9) On pense, par exemple, aux textes de Simmel ou au modèle de personnalité urbaine élaboré par Louis Wirth (2004).
(10) La notion d’ « Indiens urbains » – indígenas urbanos en espagnol, urbanized indigenous people ou indigenous urban residents en anglais – est désormais bien établie (Yescas, 2008). Elle est revendiquée par certaines organisations indiennes à Mexico (Yanes, 2004).
(11) D’après les chiffres les plus récents, les populations indiennes résident dans tous les quartiers de la ville, mais leur concentration varie. Entre 1990 et 2000, les recensements révèlent une diminution de la population indienne dans les quartiers centraux (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc) et une augmentation de cette population dans les franges de la ville, en particulier au nord (Tezoyuca, Tultepec et Tultitlán) et à l’est de la ville (Atenco, Chimalhuacan et Ixtapaluca), dans des zones de peuplement récent où les bas prix de terrains souvent accidentés et très éloignés du cœur de la ville facilitent l’accès à la propriété de populations modestes (Molina et Hernández, 2006 : 33).
(12) Martin, 17 ans, 1 enfant, ouvrier sur des chantiers, né à Mexico. Mexico, 2007.
(13) Voir les travaux de Liliana Rivera-Sánchez, qui analyse les circuits migratoires établis entre la région mixtèque, New York et le quartier populaire de Nezahualcóyotl à Mexico, et ceux de Daniela Oliver, qui s’interroge sur l’influence de l’imaginaire des gangs importé des Etats-Unis, sur les constructions identitaires de jeunes Mixtèques nés à Neza (Rivera-Sánchez, 2007 ; Oliver, 2009).
(14) Juan, 30 ans, 5 enfants, commerçant, arrivé à Mexico à 10 ans. Mexico, 2009.
(15) Tonio, 30 ans, 3 enfants, commerçant, arrivé à Mexico à 7 ans. Mexico, 2009.
(16) Ibid.
(17) L’appartenance des populations étudiées aux classes populaires est importante pour expliquer les difficultés qu’elles rencontrent à entretenir une voiture en ville : les frais d’entretien et de réparation pèsent lourdement sur leurs budgets ; les logements des classes populaires n’ont pas de garages qui leur permettraient de mettre les voitures à l’abri.
(18) Bernardo, 37 ans, 5 enfants, maçon sur des chantiers, arrivé à Mexico à 16 ans. Mexico, 2009 ; Marta, 36 ans, 5 enfants, commerçante ambulante, arrivée à Mexico à 15 ans. Mexico, 2009.
Bibliographie
Agier Michel (1999). L’invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et favelas, Editions des Archives contemporaines.
Arias Patricia et Woo Morales Ofelia (2004). « La migración urbana hacia Estados Unidos. Tres ejemplos desde la Zona Metropolitana de Guadalajara ». Papeles de población, vol. 42: 36-72.
Baby-Collin Virginie (2005). «Des marges dans la ville : mobilités citadines et métissage de l'urbanité», Dans, Capron G., Cortès G., Guétat H. (dir.), Lieux et liens de la mobilité : ces autres territoires, Belin, Paris, 2005 : 145-167
Bertrand Monique (dir.) (2010) Mobilité, pauvretés : les villes interrogées, n°201, janv-mars
Berry-Chikhaoui Isabelle et Deboulet Agnès (2000) Les compétences des citadins dans le monde arabe : penser, faire et transformer la ville, Paris : Karthala
Bónfil Batalla Guillermo (2005) [1987]. México profundo, una civilización negada, Mexico : Random House
Bredeloup Sylvie (2008) « L'aventurier, une figure de la migration africaine ». Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 2, n°. 125, p. 281-306.
Brubaker Roger (2001). « Au-delà de l'identité ». Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 139: 66-85.
Castañeda Camey Nicté Soledad (2009). « Dinámica y proceso de migración a Estados Unidos : Jóvenes de Guadalajara, Jalisco, México ». Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 7: 1459-1490.
Dureau Françoise, Barbary Olivier, Lulle Thierry(2004)« Dynamiques de peuplement et ségrégations métropolitaines » in Dureau F. et alii (dir.), Villes et sociétés en mutation. Lectures croisées sur la Colombie, Paris, Anthropos (coll. « Villes »), pp. 123-182
Durand Jorge, Massey Douglass S., Zenteno René M. (2001). « Mexican Immigration to the United States : Continuities and Changes ». Latin American Research Review, vol. 36, n°.1 : 107-127.
Faret Laurent (2006). “Introduction”, L’Ordinaire latino-américain, numéro spécial « La ville latino-américaine : regards et pratiques en mutations », n°205 : 5-8.
Fox John et Rivera-Salgado Gaspar (ed.) (2004). Indigenous Migrants in the United States: La Jolla/University of California, San Diego, Center for Comparative Immigration Studies and Center for US-Mexican Studies.
Fussell Elizabeth et Massey, Douglass S. (2004). “The Limits to Cumulative Causation: International Migration from Mexican Urban Areas”, Demography, vol.41, n°1 : 151-171.
Goffman Ervin (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris : Les Editions de Minuit
Hernández León Rubén (2008). Metropolitan Migrants: the Migration of Urban Mexicans to the United States, Los Angeles, University of California Press.
Hiernaux Daniel (2000) Metrópoli y etnicidad ; Los indígenas en el Valle de Chalco, México: Colegio Mexiquense A.C., Fondo nacional para la cultura y los artes ; ayuntamiento de Valle de Chalco solidaridad.
INEGI (2000). XII Censo General de Población y Vivienda : INEGI
Kearney Michael (1996). Reconceptualizing the peasantry. Anthropology in Global Perspective, Boulder, Colorado, Westview Press.
Lessault David, Beauchemin Cris, Sakho Papa (2011). « Migration internationale et conditions d’habitat des ménages à Dakar », Populations, N°1, vol.66 : 197-228.
Lévy Jacques et Lussault Michel (2003) Dictionnaire de la géographie, Paris, Editions Belin
Lewis Oscar (1975). Five Families: Mexican Cases Studies in the Culture of Poverty, New York: Basic Books
Lozano Ascensio Fernando (2001). « Nuevos orígenes de la migración mexicana a los Estados Unidos : migrantes urbanos vs. Migrantes rurales ». Scripta Nova, vol. 94, n°. 14 [URL: http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-14.htm Consulté le 26 avril 2012]
Lozano Ascensio Fernando (2002). « « Migrantes de las ciudades : nuevos patrones de la migración mexicana a los Estados Unidos », in García Guzmán, B. (ed.) Población y Sociedad al Inicio del Siglo XXI, : El Colegio de México, p. 241-259.
Lozano Ascensio Fernando et Rivera-Sánchez Liliana (2006). « Los contextos de salida urbanos y rurales y la organización social de la migración ». Migración y desarrollo : 45-78.
Lussault Michel (2001) « La ville des géographes », dans, Paquot T., Lussault M., Body-Gendrot S., La ville et l’urbain. L’état des savoirs., pp. 21-35
Marcelli Enrico A. et Cornelius Wayne (2001). « The changing profile of Mexican Migrants to the United States. New Evidence from California and Mexico ». Latin American Research Review, vol. 36, n°.3 : 105-131.
Martínez Casas Regina (2004). Vivir invisibles : la resignificación cultural entre los otomíes urbanos de Guadalajara, thèse doctorale, Guadalajara, CIESAS Occidente.
Mendoza Pérez Cristobal (2009). «La emergencia de la migración internacional en la periferia empobrecida de la ciudad de México: Valle de Chalco-Solidaridad, Estado de México». Migraciones internacionales, vol. 5, n°. 2 : 4-37.
Oliver Rucavalda Daniela (2009). « Fricciones transnacionales en la ciudad étnica », communication présentée au 53ème Congrès International des Américanistes, Mexico.
Papail Jean (2003). « Migraciones internacionales y familias en áreas urbanas del centro occidente de México ». Papeles de población, vol. 36 : 109-131.
Perraudin Anna (2011). Mobilités et ethnicité : l’expérience migratoire des Indiens mexicains, de la migration interne à la migration internationale, Thèse en sociologie, EHESS.
Redfield Robert (1949). A Mexican Village: a Study of Folk Life, Chicago: University of Chicago Press.
Rivera-Sánchez Liliana (2007). « La formación y dinámica del circuito migratorio mixteca-Nueva York- mixteca. Los trayectos internos e internacionales ». Norteamérica, vol.1 : 171-203.
Roberts Bryan et Hamilton Erin (2007) « La nueva geografía de la migración : zonas emergentes de atracción y expulsión, continuidad y cambio ». Dans, Ariza M. et Portes A. (ed.) El País Transnacional, Migración mexicana y cambio social a través de la frontera : Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM : 83-118.
Sabates Ricardo et Pettirino Fabio (2007). « The identity of emigrants from Mexico city ». Papeles de población, vol. 52 : 211-229.
Sánchez Gómez Marta Judith (1995). Comunidades sin límites territoriales. Estudio sobre la reproducción de la identidad étnica de migrantes zapotecos asentados en el área metropolitana de la Ciudad de México, thèse doctorale, Colegio de México.
Sánchez Gómez Marta Judith (2007). «La importancia del sistema de cargos en el entendimiento de los flujos migratorios indígenas». Dans, Ariza, M. et Portes, A. (ed.) El país transnacional: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM : 349-390.
Sayad Abdelmalek (1999). La Double Absence, Paris : Seuil
Tarrius Alain (2002) La mondialisation par le bas : les nouveaux nomades de l’économie, Paris : Balland
Valladares Lidia et Prates Coelho Magda (s/d). « La investigación urbana en América Latina. Tendencias actuales y recomendaciones”, Gestiones de transformaciones sociales – MOST [URL: http://www.unesco.org/most/vallspa.htm Consulté le 24 avril 2012]
Withol De Wenden Catherine (2009). Atlas mondial des migrations internationales, Paris, Editions Autrement.
Woo Morales Ofelia (2007) « La experiencia migratoria de las mujeres urbanas hacia "El Norte"». Dans, Arias, P. et Woo Morales O. (ed.) Campo o ciudad ? Nuevos espacios y formas de vida : Universidad de Guadalajara, p. 149-168.
Yanes Pablo (2004). « Urbanización de los pueblos indígenas y etnización de las ciudades: hacia una agenda de derechos y políticas públicas », in Yanes P. et al. (ed.) Ciudad, Pueblos Indígenas y Etnicidad : Universidad de la Ciudad de México, Dirección General de Equidad y Desarrollo Social : 191-225.
Yescas Carlos (2008). Indigenous Routes, International Office for Migrations [URL : http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/Indiginous_route_final.pdf. Consulté le 25 août 2010]
Pour citer cet article :
Perraudin Anna, « « Chilangos » et « campesinos ». La migration internationale des Indiens depuis les villes mexicaines ». RITA, N° 6: février 2013, (en linea), mis en ligne le 28 de février 2013. Disponible en ligne: http://www.revue-rita.com/villes-et-campagnes/anna-perraudin.html



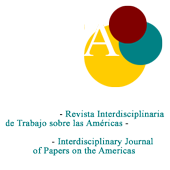








 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8