Douleurs privées et problème public. Ressources et contraintes associées à la position de victime dans l’espace public
Private pain and public problem. Resources and constraints associated with the victim's position in the public sphere
Résumé
Cet article s’intéresse à la structure de l’espace public et plus particulièrement à la position de victime, entendue comme position de sujet. Il s’agira à partir d’un cas particulier observé en Argentine de comprendre comment cette position peut offrir une surface d’exposition médiatique très rapide et importante mais aussi contraindre l’énonciation dans un registre particulier empêchant toute capitalisation politique. Ce cas particulier permettra de saisir les ressources et les contraintes qu’offre une telle position dans l’élaboration des problèmes publics, tel que la sincérité et l’apolitisme, empêchant une véritable subjectivation politique.
Mots clés : Politique; Espace public; Argentine; Discours; Démocratie.
Abstract
This article focuses on public space structure and more particularly to the position of victim, understood as subject position. It will be from a particular case observed in Argentina to understand how this position can offer a very quick and large area of media exposure but also constrain in a particular register preventing political capitalization. This particular case will capture the resources and constraints offered by this position in the development of public problems, such as sincerity and apolitical, preventing effective political subjectivity.
Key words: Politics; Public Space; Argentina; Discourse; Democracy.
-------------
Américo Mariani
Docteur en Sociologie
LISST-CERS
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Douleurs privées et problème public.
Ressources et contraintes associées à la position de victime dans l’espace public
Introduction
L’histoire de l’émergence de la figure de la victime n’est plus à faire (Chaumont, 1997; Fassin and Rechtman, 2007; Wievorka, 2003). Après avoir été longtemps laissés pour compte, ceux et celles qui parviennent à faire admettre leur statut de victime ont droit désormais à « participer à l’écriture de l’Histoire », (Lefranc, Mathieu and Siméant, 2008) non sans difficultés et censures bien évidemment (Romano and Cyrulnik, 2015). Cet article abordera le paradoxe de la position de victime qui à la fois confère une exposition médiatique forte, sorte de « droit à la parole ». Tout en assignant les personnes à une place énonciative contrainte et limitée dans la construction des problèmes publics. Position de victime non comme condition ou statut de victime, l’une se définissant par l’expérience d’un vécu traumatique et l’autre par la reconnaissance, mais position entendue comme place relative dans l’espace public. Je fais référence ici aux positions de sujets dans l’espace de l’énonciation de M. Foucault (2008). L’organisation de la prise de parole et de l’apparition publique, confère à cette position un registre d’énonciation particulier. Autrement dit, la dramaturgie des problèmes publics (Gusfield, 2009) aurait partie liée avec une certaine esthétique du politique (Rancière, 1995), la position de victime permettant de comprendre la configuration et l’économie générale de l’espace public[1]. Ainsi, il s’agira de saisir ce que cette place d’énonciation particulière nous apprend sur l’économie de la place publique médiatique, et non d’évoquer la mobilisation et constitution d’un groupe à partir d’une expérience victimaire, i.e. d’un vécu traumatique particulier.
C’est alors que j’effectuais mon travail de terrain, dans le cadre ma thèse (Mariani, 2012), au sein du congrès argentin, que j’ai en quelque sorte croisé ce que je vais développer ici : la position de victime comme position d’énonciation. C’est depuis l’espace public parlementaire, à partir de la résonnance en son sein, que je vais me saisir de cette question. Ce qui est présenté à la suite est en quelque sorte un résultat périphérique de ce travail de terrain. Les entretiens effectués auprès des parlementaires, les observations et analyses des sessions du congrès n’ont pas spécifiquement portée sur cette question et pourtant, elle n’a cessé de surgir. Je l’ai ensuite approfondi à travers un travail d’observation spécifiques et une analyse de la couverture médiatique. Nous sommes alors dans au mitant de la mandature Kirchner et pour l’heure aucune personnalité ou force politique semble pouvoir lui disputer le pouvoir (Bernadou, 2009). C’est le moment de la construction du kirchnerisme qui va se caractériser très tôt par une politique de promotion de la question des droits humains et la prise en compte des victimes du terrorisme d’Etat de la dernière dictature en rupture avec ce qui avait été fait jusqu’alors. À travers un cas particulier, celui de Juan Carlos Blumberg en Argentine, nous poserons d’abord les caractéristiques propres d’une position d’énonciation victimaire. Nous développerons ensuite plus précisément les questions de sincérité et d’authenticité considérées ici comme centrales. Enfin, nous verrons les fragilités de l’appropriation des problèmes publics à partir d’une position de victime. Et aussi les liens que l’on peut faire avec l’organisation de l’énonciation des torts, la tâche de les rendre visibles et dicibles dans le cadre des gouvernements représentatifs[2].
I. L’appropriation d’un problème public à partir d’une position de victime : réflexion à partir du cas Blumberg
Juan Carlos Blumberg apparaît sur la scène publique à la suite de l’enlèvement et du meurtre de son fils Axel en 2004. Les parents deviennent alors le point focal des nombreuses équipes de radio, de télévision et de la presse de la capitale (Annunziata, Mauro and Slipak, 2006). Les médias donnent à voir un père de famille « comme tout le monde » accablé par la douleur, mais capable de surmonter ses peines propres au nom du bien commun, de l’intérêt général. Un rassemblement devant le Congrès national est organisé le 1er avril 2004, moins de 15 jours après la découverte du corps, ce sont 130 000 à 150 000 personnes[3] présentes, des milliers de bougies allumées en souvenir. Ici, nous avons effectivement toute la gamme de l’usage des « codes » de la protestation victimaire : blanc, deuil, bougies, un répertoire qui se transmet (Crossley, 2006). D’une tribune, Juan Carlos Blumberg déclare : « Nous sommes venus là où sont nos représentants pour demander de petites choses, simples, pour que nos enfants puissent travailler, étudier et qu’ils ne soient pas assassinés. Aujourd’hui, Axel est l’enfant de tous ». Il a d’ores et déjà une pétition en sept points à soumettre aux législateurs. L’écho politique est immédiat, le vice-président de la république et le président de la Chambre des député.e.s reçoivent en mains propres les doléances. Le ministre de l’Intérieur s’exprimera immédiatement après la marche signalant la justesse des réclamations, la nécessité d’une révision de la politique de sécurité : « Pour le gouvernement, cela n’a pas été sans importance. Nous partageons la douleur des victimes, nous les accompagnons et nous leur renouvelons l’engagement de combattre la délinquance et d’en finir avec l’impunité. » Cette phrase illustre le malaise provoqué par les demandes « sécuritaires » de Blumberg en associant « combattre la délinquance » et « en finir avec l’impunité ». Le mandataire tente d’inscrire ces demandes dans le registre des luttes pour « la vérité et la justice ». En effet, l’influence des causes nouées autour des tragédies est, en Argentine, marquée par l’histoire récente. La matrice de la position de victime est fortement liée à la lutte associée aux disparitions forcées, tortures et globalement à la répression de la dernière dictature (1976-1983). Les Mères de la Place de Mai sont centrales dans la construction de cette symbolique victimaire. Leur lutte pour la « vérité et la justice », pour la « ré-apparition en vie » est celle qui, par ses formes « sauvages »[4], en dehors de ce qu’il était alors possible et accepté, va participer de l’émergence de la démocratie en Argentine. Bien évidemment les Mères et grands-mères de la Place de Mai ne sont qu’une partie, très symbolique, d’un « mouvement des droits humains » qui a participé au développement d’une « culture du droit » dans la société argentine (Cheresky, 1989) et qui va marquer profondément les modalités du politique de l’après dictature jusqu’à nos jours. Leurs actions ont contribué à l’ouverture d’un espace d’énonciation des torts, et de constitution de sujets revendicatifs, marqué par une contestation de l’arbitraire et de la répression étatique. C’est pourquoi, lorsqu’une « figure victimaire » s’impose en prônant des mesures dites de mano dura —répressives et sécuritaires— elle se décale du modèle et révèle avec plus de force l’autonomisation de la position de victime dans l’espace public. Blumberg, que l’on surnommera « l’ingénieur », gagne immédiatement un statut de référence sur la question de l’insécurité et il va, alors devenir le « propriétaire » de la définition du « problème de l’insécurité ». C’est-à-dire qu’il va se retrouver dans une position privilégiée pour distribuer les responsabilités et élaborer les « solutions ». C’est un véritable statut de représentant politique des « victimes » qui lui est conféré, le mettant en concurrence avec les élu.e.s. Ceci est énoncé très clairement dans les statuts de la fondation créée à la suite des mobilisations :
L’objectif de la fondation est celui que les citoyens lui ont assigné par leur appui dans chacune des trois manifestations massives : canaliser les demandes de plus de justice et de sécurité à travers un nouveau compromis citoyen pour le bien commun [...].
Cette volonté de représentation des desiderata citoyens, même si elle ne remet pas formellement en cause les mécanismes du gouvernement représentatif, puisqu’elle se veut simple médiation, remet en cause le travail législatif. C’est clairement exprimé par les représentant.e.s élu.e.s qui se sentent alors mis en concurrence directe avec elle[5] : « La victime a le droit depuis sa douleur de tout manifester. Mais ce qu’elle n’a pas, c’est l’autorité au nom de sa douleur d’imposer une législation comme veut le faire Blumberg. » (N. M. députée depuis 2005). Juan Carlos Blumberg est, à la fois celui qui sait pour avoir vécu dans sa chair la douleur et celui qui dépasse celle-ci pour formuler des propositions qui ne sont pas issues d’un savoir froid et technique, mais directement de nécessités vitales : l’expérience contre l’expertise, mais l’expérience qui sait parler le langage du droit. En effet, il proposera directement des projets législatifs qui seront pour une bonne part effectivement transformés en loi. La question demeure de savoir ce qui confère à cette position d’énonciation sa force et sa capacité d’être entendue et prise en compte.
II. La sincérité et l’apolitisme comme ressources de la légitimité à dire
Une fois devenue un des registres d’énonciation disponibles, la position de victime excède la question du traumatisme. Ce n’est pas dans le traumatisme qu’il faut chercher l’efficace de cette position, mais dans une économie générale de l’expression sur la place publique médiatique. Ici, la mort de l’enfant, malgré toute la charge émotionnelle et l’incontestable tort qu’elle constitue, ne peut être l’élément qui fait la différence (Latté, 2012). La victimisation —l’expérience traumatique— n’a de sens que comme « sésame » de l’exposition médiatique. Ensuite, le droit de citer (de prendre place dans la cité) est conditionné par des éléments connexes, en premier lieu desquels la sincérité et l’apolitisme.
L’énoncé, pour être audible, doit être marqué par la sincérité, l’authenticité de la victime, par l’expression de ses blessures propres. Ainsi s’expose un réel sans fard, un fait brut sans interprétation. C’est la vie même qui s’exprime et se donne à voir. Bien évidemment le désintéressement, le caractère non partisan sont des conditions d’une sincérité « réelle » —la parole victimaire pour être légitime ne se situe pas sur l’échiquier politique— « ni droite, ni gauche », simplement à ras d’une réalité quotidienne, celle de monsieur et madame tout le monde. Le soupçon de l’appât du gain, de la vengeance, du débordement par l’émotion pèse de manière importante sur l’énonciation victimaire (Latté, 2015). Pour conserver sa légitimité elle doit donner des gages de ne pas agir pour son bien propre, de ne pas être animé par des intérêts matériels. Jeux d’équilibre où la position singulière doit s’exprimer dans les mots du commun. Si l’on se réfère au modèle dramatique de l’action publique, on comprend que ce registre ne renvoie pas à une « substance » réelle de la victime et à une hiérarchisation des traumatismes mais à une « performance réussie », un « faire croire » qui touche sa cible. « L’expérience est restituée de telle façon qu’elle simplifie des idées complexes et intensifie l’engagement émotionnel des spectateurs » (Gusfield, 2009 : 87). Le registre de la victime est une sorte d’image d’une réalité, et dans une économie médiatique où l’image vaut mille mots, elle bénéficie d’un privilège d’énonciation indéniable.
On peut voir comment, dans le cas de l’ingénieur Blumberg, ce registre de la spontanéité est mobilisé pour assurer la position de « propriétaire » de la question de l’insécurité avec une mise en scène virtuose de « la mobilisation sans mobilisation ». Précisons que, si l’histoire veut que ce soit la spontanéité qui soit la cause principale de la mobilisation, la réalité est toute autre, des liens institutionnels ont permis le succès de la première marche et des suivantes : le syndicat des personnels législatifs, Red solidaria, un réseau d’associations et de groupements citoyens principalement, mais aussi d’autres syndicats, des centres commerciaux, Canal 9 (une chaîne de télévision), des collèges qui organiseront des transports en bus de leurs élèves et parents d’élèves pour assister à la manifestation. Rien de bien étonnant qu’une mobilisation s’appuie sur des réseaux pour assurer son succès et pour s’organiser. C’est la disparition de cette dimension en privilégiant, dès le départ, la spontanéité, qui est ici intéressante. Le journaliste de La Nación [6] qui assiste à la première manifestation reste complètement sous le charme du dispositif, étant dès lors un élément d’accréditation de celui-ci :
[…] la manifestation a eu par moments la force mystérieuse d’une procession religieuse, dans laquelle il n’y avait pas pour autant de foi mobilisatrice (qui convoque) ni une institution organisatrice sinon un paysage agglutinant de bougies qui semblait nous renvoyer à une réalité supérieure et transcendante.
Cet éditorial qui n’accompagne pas moins de 7 articles sur le sujet, au lendemain de la première manifestation, s’intitule : « La véritable voix de la majorité silencieuse »[7]. L’auteur insiste sur le caractère « spontané », « non convoqué par une chapelle », mais par une « réalité supérieure et transcendante ». Il est clair que l’importance de l’événement tient dans son inscription en dehors des structures traditionnelles de mobilisation. C’est, d’une certaine façon, une expression du « vrai peuple » qui est ici mise en scène, une authenticité des « gens » qui tranche avec les mobilisations d’intérêt sectoriel et construit l’illusion d’une expression sans écart à la réalité. Est-ce que pour autant il s’agit d’un calcul ? Difficile de le savoir et cette simple évocation renvoie au soupçon qui pèse sur les victimes. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’intuition de la part de non professionnels qu’il leur fallait jouer de sincérité et de neutralité pour être crédibles. Dans une mobilisation, l’enjeu est d’avoir un impact, d’être visible et audible.
Cette dramatisation de l’authenticité liée à la position de victime se retrouve à différents endroits et fait partie d’un savoir commun sur les possibilités de prise de parole publique que l’on retrouve tout aussi bien dans le cadre d’un agir politique situé (Gusfield, 2009). On peut retrouver des éléments comparables dans le contexte français. Stéphane Latté, dans son travail sur la catastrophe d’AZF[8, rapporte l’épisode d’une militante « peu prompte (…) à l’épanchement intime » qui livrera à un journaliste de télévision un témoignage sur mesure, habilement ponctué par des larmes (Latté, 2012 : 419). Ou encore cette insistance des journalistes pour que les anciens ouvriers de l’usine mettent en avant leur statut de victimes pour prendre part et place dans le débat qui a suivi l’explosion et leur refus d’endosser cette position. Les exemples ne manquent pas montrant la consistance d’une position de victime comme registre énonciatif. Ce registre d’énonciation particulier est une ressource pour prendre part et place de manière efficace et légitime dans la sphère publique.
Être désigné et reconnu comme victime devient dès lors un enjeu. Faire valoir un droit, une revendication, énoncer un tort en s’adossant à la revendication de ce statut est un phénomène qui revient sans cesse dans la sphère publique, et pas uniquement dans les médias comme on a pu le voir. La petite ritournelle du « Qui est la vraie victime dans cette histoire ? » est devenue incontournable, mobilisée pour poser une ligne de démarcation entre le juste et l’injuste, pour argumenter de sa légitimité à dire et surtout pour délégitimer les arguments adverses. C’est la mise en scène de la douleur privée, comme expression d’un réel sans déformation partisane, comme expression d’une sincérité et d’une authenticité incontestable, qui est mobilisée pour prendre place dans le drame de l’action publique. Si cette position d’énonciation permet, dans certain cas, un accès rapide à une position de propriétaire il n’en reste pas moins limité du fait même de ses conditions de possibilité.
III. Une propriété conférée : les limites de l’énonciation dans la position de victime
L’affaiblissement et la progressive disparition du phénomène Blumberg confirment l’importance de la dépolitisation comme facteur de légitimité. Nous verrons comment l’assimilation progressive du discours à une prise de position partisane va affaiblir l’audience jusqu’à la rendre complétement anecdotique. Cet exemple permet de saisir les limites de la position de victime.
Ce seront quatre marches organisées au fil des années, la dernière amenant l’ingénieur et ses partisans sur la Place de Mai le 31 août 2006. La « plaza de Blumberg », titrent les quotidiens. Cette arrivée de la croisade sur cette place centrale dans la symbolique du pouvoir —la Place de Mai— reste marquée par une volonté d’apparaître comme apolitique : « La marche est apolitique, sans pancarte de parti. Nous porterons seulement une bougie comme symbole de la vie », affirment les organisateurs, désormais la fondation « Axel Blumberg pour la vie de nos enfants »[9]. Mais la présence d’une contre manifestation et les prises de position de l’ingénieur donnent une autre tonalité qui politise de plus en plus ces manifestations. Le lien entre l’installation croissante de l’ingénieur dans le jeu politique et sa chute de popularité pose très clairement les limites imposées par les conditions de légitimité qui sont les siennes (Annunziata, Mauro and Slipak, 2006). En effet, l’appel à manifester sur la Place de Mai réunit un grand nombre de personnes, mais il s’agit de plus en plus de cristalliser un mécontentement vis-à-vis d’une politique et d’un gouvernement. À un moment où le président au pouvoir affirme son hégémonie en insistant sur une politique progressiste, ce mouvement apparaît comme une contradiction et est, de plus en plus, présenté comme telle. Blumberg s’en défendra dans un premier temps tout en cherchant à intervenir dans le champ politique —moins d’un an plus tard en 2007, il se portera candidat au poste de gouverneur de la ville de Buenos Aires. À la tête d’un parti provincial, « Frente vamos » (Front allons-y), il n’obtiendra que 0,89 % des suffrages. Comment un personnage médiatique de premier ordre, qui a alimenté par ses prises de position et ses propositions un grand nombre de débats législatifs, est-il passé en peu de temps du devant de la scène à la discrétion la plus totale ? Notre hypothèse ici est qu’on ne représente les « vrais gens » qu’au prix d’une mise à distance de l’arène politique qui, sur le long et moyen terme, est difficile à tenir. Maintenir l’image de bon père de famille qui pourrait être n’importe lequel d’entre nous, le courage et l’altruisme en plus, n’est pas aisé lorsque l’on cherche par ailleurs à influer sur le politique et l’écriture des lois comme sur l’agenda de l’exécutif. La sincérité est alors l’apanage de la spontanéité, une frontière ténue sépare la sincérité des « citoyens mobilisés » et le calcul politique partisan.
La position de victime ne résulte pas d’une décision délibérée. C’est parfois la seule possible pour énoncer un tort, pour prendre part et place dans la définition d’un problème et dans sa résolution. Pour le meilleur, comme dans le cas des mères de la Place de Mai qui ont su pérenniser une intervention politique dans le temps. Dans un contexte dictatorial violent cette position s’est révélée porteuse d’une puissance insoupçonnée qui perdure encore dans la politique argentine. Parfois pour le pire, si l’on prend comme exemple le cas en France, des personnes abattues par la police, comme le souligne S. Latté (2015), les familles sont renvoyées à du compassionnel, ne pouvant participer à l’émergence de cette question sur la place publique[10]. Dès lors la position de victime agit surtout comme une assignation à l’expression de la douleur, au grognement inarticulé de la phonè plus qu’à l’expression politique du logos. De marche silencieuse en marche blanche, d’émeutes en voitures brulées, la question peine à émerger comme un problème public, comme une question politique. Qu’est-ce qui, alors, fait la différence entre deux prises de paroles, deux énonciations ? Quelles sont les conditions de félicités qui permettent là une inscription durable et ailleurs au contraire une position éphémère ?
Comme l’a déjà montré S. Latté (2012) ce n’est pas à la force de l’événement traumatique qu’il faut attribuer la puissance des « vivants parlant au nom des morts » (Wievorka, 2003 : 28). Ainsi, il faut distinguer deux éléments en partie contradictoire, d’une part, ce qui fait politique et d’autre part la position de victime. Politique est entendue ici comme interruption d’un ordre : à la fois par l’évocation d’un tort et, dans le même temps, la désignation de responsabilités. La position de victime elle relève de l’agencement de l’espace public, elle est alors un registre d’énonciation qui, s’il amène de l’exposition et de la visibilité médiatique, limite au final les possibilités proprement politiques des énonciateurs. C’est-à-dire la possibilité de faire voir et entendre le tort et d’énoncer les moyens d’y mettre fin.
Ici se pose la nécessité de comprendre le contexte qui rend possible une position plus « conférée » que réellement autonome —répondant à des règles et des buts élaborés en propre. À l’analyse les registres victimaires se révèlent comme donnant lieu, sur la place médiatique, à ce qu’il est possible de désigner comme de véritables « bulles représentatives » : elles se développent rapidement —la fulgurance de leur émergence étant un trait définitoire— s’imposent comme une référence obligée et incontournable, puis disparaissent sans laisser de trace. La propriété, (au sens que lui donne J. Gusfied) associée à la position de victime dans le débat public, a tout d’un bail précaire qui peut être interrompu unilatéralement. C’est une propriété « conférée », qui est conséquence de l’agencement de la scène plus que résultat d’une caractéristique propre des personnes. C’est pourquoi la qualité de victime (comme condition et comme statut) n’est pas intrinsèque à l’expérience concrète, le traumatisme n’est pas définitoire ; il est reconnu ou pas, en dehors de tout constat clinique, du fait de son adéquation avec un registre d’énonciation. S’il est aisé de remarquer le caractère éphémère des existences médiatiques, il faut souligner aussi que la position de victime donne lieu à une parole limitée dans son champ d’énonciation. Encore une fois, ce n’est pas le lien avec le traumatisme —l’expérience traumatique— qui est en cause mais une position de sujet, une place d’énonciation qui préexiste à l’énoncé. Cette passerelle, privilégiée pour la prise de parole publique —la mise en lumière sous le « feux des projecteurs » selon l’expression consacrée— conditionne aussi le périmètre de la parole et peu être très vite un carcan dont il est difficile de se défaire. Plus qu’une énonciation propre, c’est un discours déjà existant qui trouve ses sujets, qui distribue des positions d’énonciation. Il n’est pas irruption d’une parole et « inscription d’un nom dans le ciel » comme le font les plébéiens lors de leur sécession sur l’Aventin (Rancière, 1995 : 45-49) transformant à la fois la place de l’énonciation et le contexte de celle-ci. Au contraire la position de victime est un ticket d’entrée pour une parole déjà là, en quelque sorte déjà pré écrite, et qu’on occupe de manière précaire un temps qu’il est impossible de maîtriser.
Conclusion
« La réalité n’est pas une entité amorphe qui attend d’être découverte » (Gusfield, 2009 : 54). La position de victime apparaît effectivement comme une ressource permettant d’accéder à la place publique et de faire voir une réalité. La mise en lumière des douleurs privées, le récit d’un vécu individuel rend possible une exposition de soi et de sa situation. Cette modalité d’énonciation des souffrances privées permet la « transformation de faits abstraits en faits à la portée dramatique, qui impliquent des prises de position, qui réveillent des images et des valeurs, qui ont une signification d’ordre poétique plutôt que sémantique. » (Gusfield, 2009 : 86). Cette visibilité, sur la place médiatique rend possible une appropriation de la définition d’un problème public mais de manière limitée et contrainte. Cette position de victime est conséquence de la configuration de la dramaturgie du débat public en régime médiatique et l’efficace de l’énonciation victimaire a partie liée avec une prise de distance avec le politique, voire comme une antithèse de ce que l’on prête de calcul et d’intentionnalité à la parole politique. La victime se doit d’être sincère là où le politique est mensonge ou demi-vérité, la victime est désintéressée là où le politique est expression partisane des intérêts. Paradoxalement la victime incarne un « bien public » de par l’expression radicale de sa douleur privée. Mais attention, si les « victimes » font des fausses notes sur la partition serrée qui est la leur, qu’elles « en fassent trop » ou qu’elles « sonnent faux », et tout s’arrête. La conjonction entre douleur privée et problème publique se brise et l’universel du cas disparait. La position de victime est l’introduction d’un corps sensible dans la représentation du réel. Dès lors, elle est en charge de la faire tenir telle qu’elle est, pas de la transformer. Ceci parle donc moins de la réalité de la victimisation, que de la configuration de l’espace public, notamment médiatique. Déjà Frank Capra, dans son film Meet John Doe (1941), montrait un magnat de la presse créer de toutes pièces une victime de la crise qui allait donner un second souffle à l’Amérique par ses discours empreints de sincérité et de spontanéité. Mais le héros n’a que peu de marge de manœuvre et d’expression. Et comme il l’a créé, le magnat le renverra dans les affres de l’oubli, le contraignant au suicide pour prouver sa bonne foi et sa sincérité. Le film de Capra pourrait être une allégorie de la position de victime mais, arrivée à la surexposition médiatique, ce n’est pas la manipulation d’un magnat de la presse qui est à craindre, mais les contraintes structurelles d’une position d’énonciation qui n’admet pas de remise en cause du cadre qui la rend possible.
Notes de fin
[1] « Le référentiel de l’énoncé forme le lieu, la condition, le champ d’émergence, l’instance de différenciation des individus ou des objets, des états de choses et des relations qui sont mises en jeu par l’énoncé lui-même ; il définit les possibilités d’apparition et de délimitation de ce qui donne à la phrase son sens, à la proposition sa valeur de vérité. » (Foucault, 2008 : 121)
[2] Cet article prolonge et approfondi des éléments de mes travaux de thèse (Mariani, 2012).
[3] Non signé, « Masiva marcha frente al Congreso para pedir seguridad », Clarín du 1er avril 2004. Sauf indication contraire les citations qui suivent sont issues de cet article.
[4] Je fais référence ici à la manière dont Claude Lefort utilise le terme de « sauvages » en rappelant que « la démocratie que nous connaissons s’est instituée par des voies sauvages sous l’effet de revendications qui se sont avérées inmaîtrisable. » (Lefort, 1994 : 26)
[5] Entretien réalisé dans le cadre de mon travail de thèse.
[6] Journal de référence en Argentine, basé à Buenos Aires, conservateur et profondément anti péroniste il existe depuis 1870.
[7] De Vedia (B.), « La verdadera voz de la mayoría silenciosa », La Nación du 2 avril 2004.
[8] Le 21 septembre 2001 l’usine chimique AZF (groupe Total) partie prenante de l’important complexe militaro industriel toulousain explose faisant des dégâts considérables dans la ville.
[9] http://fundacionblumberg.com/ dernière consultation en février 2012 aujourd’hui inaccessible.
[10] Ce parallèle est particulièrement intéressant si on songe à l’épisode des « folles de la Place Vendôme » qui ont essayé d’importer le modèle des mères de la Place de Mai pour dénoncer collectivement la mort de leurs enfants en 1984. Les morts et blessés en relation à une action de police et les mobilisations liées sont une illustration intéressante de problèmes sociaux qui n’arrivent pas à atteindre le statut de problèmes publics. Voir à ce sujet (Abdallah, 2012).
Références bibliographiques
Abdallah Mogniss Hamed (2012). Rengainez, on arrive! : Chroniques des luttes contre les crimes racistes ou sécuritaires, contre la Hagra policière et judiciaire des années 1970 à nos jours. Paris : Libertalia.
Annunziata Rocío, Mauro Sebastián et Slipak Darío (2006). « Blumberg y el vínculo representativo. Liderazgo de opinión en la democracia de audiencia ». Dans Cheresky I. Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Buenos Aires : Miño y Dávila : 143-172.
Bernadou Vanessa (2009). « Nestor Kirchner : du président “sans pouvoirs” au “chef hégémonique” ». Critique internationale, vol.43, n°2 : 89–107.
Chaumont Jean-Michel (1997). La concurrence des victimes : génocide, identité, reconnaissance. Paris : Ed. La Découverte.
Cheresky Isidoro (1989). Populisme, autoritarisme et dynamique démocratique dans la société argentine. Thèse de doctorat, Toulouse, Toulouse2-Le Mirail.
Crossley Nick (2006). « Changement culturel et mobilisation des patients ». Politix, n° 73 : 23-55.
Fassin Didier et Rechtman Richard (2007). L’empire du traumatisme : enquête sur la condition de victime. Paris : Flammarion.
Foucault Michel (2008). L’archéologie du savoir. Paris : Gallimard.
Gusfield Joseph Robert (2009). La culture des problèmes publics : l’alcool au volant. Paris : Economica.
Latté Stéphane (2012). « La “force de l’événement” est-elle un artefact ? Les mobilisations de victimes au prisme des théories événementielles de l’action collective ». Revue française de science politique, vol. 62, n°3 : 409-432.
Latté Stéphane (2015). « Des “mouvements émotionnels” à la mobilisation des émotions ». Terrains/Théories, n°2. Juillet. URL : http://teth.revues.org/244 Consulté le 9 août 2015.
Lefort Claude (1994). L’invention démocratique : les limites de la domination totalitaire. Paris : Fayard.
Lefranc Sandrine, Mathieu Lilian et Siméant Johanna (2008). « Les victimes écrivent leur Histoire ». Raisons politiques, vol. 30, n° 2 : 5–19.
Mariani Américo (2012). De la démocratie en Argentine: représenter le peuple après le 2001. Thèse de doctorat, Toulouse, Toulouse2-Le Mirail.
Rancière Jacques (1995). La mésentente : politique et philosophie. Paris : Galilée.
Romano Hélène et Cyrulnik Boris (2015). Je suis victime : l’incroyable exploitation du trauma. Savigny-sur-Orge : P. Duval.
Wievorka Michel (2003). « L’émergence des victimes ». Sphera Publica, 003 :19–38.
Pour citer cet article
Américo Mariani. « Douleurs privées et problème public. Ressources et contraintes associées à la position de victime dans l’espace public. ». RITA [en ligne], n°11 : juillet 2018, mis en ligne le 16 juillet 2018. Disponible en ligne:



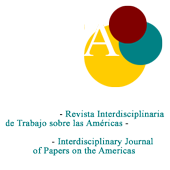






 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8