Parcours haïtiens au Québec : rencontres, connivences, coïncidences, conflits et malentendus
Cette Table-ronde s’est tenue le 9 octobre 2015 à l’Université de Montréal et a été retranscrite intégralement par Violaine Jolivet. Les participant.e.s (Robert Bérouet-Oriol, Monique Dauphin, Annick Maugile Flavien, Stéphane Martelly, Marjorie Villefranche, Frantz Voltaire) ont été réuni.e.s à l’initiative de Stéphane Martelly. Que tou.t.e.s soient remercié.e.s pour leurs précieuses contributions.
Parcours haïtiens au Québec : rencontres, connivences, coïncidences, conflits et malentendus
Table-ronde animée par Stéphane Martelly, en présence de Robert Bérouet-Oriol, Monique Dauphin, Annick Maugile Flavien, Stéphane Martelly, Marjorie Villefranche et Frantz Voltaire.

Stéphane Martelly :
En premier lieu, je voudrais présenter les personnes autour de cette table. Je commence par Marjorie Villefranche qui est arrivée à Montréal à l’âge de 12 ans et qui a été témoin de tous les changements qu'a connu le Québec durant les quatre dernières décennies. Elle est présente à la Maison d'Haïti depuis pratiquement sa création. C'est une institution très importante à Montréal. Elle est d'abord directrice des programmes, désormais directrice générale, et se consacre depuis plus de trente ans à l'éducation et à la participation citoyenne des populations immigrantes ainsi qu'à la défense des femmes immigrantes et des personnes analphabètes. Elle est impliquée dans les luttes de mouvements communautaires et sociaux féministes et internationaux. Elle fut la marraine de la marche « du pain et des roses ». La lutte contre le racisme et toutes les formes d'exclusion et de discrimination fait également partie de son quotidien. Elle a participé au chantier sur la démocratie de la ville de Montréal, elle est membre du Comité action femmes et sécurité urbaine (CAFSU) de Montréal et du jury de sélection du premier conseil des montréalaises. Actuellement, elle préside le conseil d'administration de la table de concertation « Vivre Saint-Michel en Santé ». Elle a organisé en 2000 et 2003 la biennale « Africa-America », forum culturel en arts contemporains. Intéressée au cinéma engagé, elle a produit trois documentaires : Port-au-Prince ma ville, District 67, sur les jeunes exclus de Saint-Michel, et Petites mères, sur la vie et la résilience des mères adolescentes. Elle fut honorée par plusieurs prix. Marjorie Villefranche a surtout, tout au long de ces dernières années, occupé le premier plan de l'actualité par son implication depuis le séisme du 12 janvier 2010 dans l'accueil et l'insertion des familles endeuillées et des sinistrés arrivant d'Haïti. Elle est présente sur tous les fronts et on entend beaucoup parler d'elle concernant la relocalisation de la Maison d'Haïti dans ses nouveaux locaux, dont la beauté architecturale sera digne de toutes les communautés qui s'y retrouvent.
Je voudrais ensuite présenter à ma droite Frantz Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), historien et politologue. Il a travaillé à la production et à la réalisation de plusieurs documentaires dont : Potoprens se pam, en 1999, sur le bicentenaire de la ville de Port-au-Prince ; Les chemins de la mémoire, qui est un documentaire très important sur la dictature des Duvalier ; suivi d’Au nom du père, en 2004, au sujet de la même dictature. Il est né en Haïti en 1948, a obtenu un Bachelor of Arts et une maitrise en science politique de l'Université du Chili, ainsi qu’une maitrise en relations internationales de l'UQAM. Il a reçu beaucoup de bourses et a présenté des conférences dans plusieurs villes des États-Unis, du Chili, du Japon et dans toute la Caraïbe. Il a écrit de nombreux articles ainsi que des chapitres dans Pouvoirs noirs en Haïti et Une brève histoire des noirs du Canada. Il est le fondateur du festival des droits humains à Montréal. Le CIDIHCA est une institution extrêmement importante pour la mémoire de la communauté haïtienne et caribéenne au Canada.
À ma gauche, j'ai la joie de vous présenter Robert Bérouet-Oriol, linguiste, terminologue, qui est l'auteur de la première étude théorique relative au concept exploratoire d'écriture migrante et métisse que l'on cite partout. Il a collaboré à diverses revues au Québec, aux États-Unis, en France et en Haïti. Il a fait paraitre des essais et des recueils de poèmes dont, entre autres : Lettres urbaines, Dire à soi et Humeurs des Siècles chez Triptyque en 2009. Il est né à Jacmel, vit à Montréal depuis 1969, a fait des études à l'UQAM et est spécialiste en aménagement linguistique et en communication institutionnelle. Dès le début des années 1980, et ce durant quatorze ans, il a travaillé à l'alimentation, la mise à jour et la diffusion de la banque de terminologie du Québec pour l'Office québécois de la langue française, responsable des accords termino-linguistiques entre le Québec et les écoles de traduction au Canada. Sur mandat du gouvernement du Québec, il a joué un rôle majeur dans la conceptualisation et la mise à l'œuvre du premier accord de coopération linguistique entre le Québec et Haïti dans le domaine de la formation à la méthodologie, de la recherche et de la terminologie. Il a enseigné la linguistique et la communication à l'Université d'État d'Haïti et à l'Université Quisqueya entre 1992 et 1997. Il a contribué à la mise sur pied en Haïti du Secrétariat d'État à l'alphabétisation. Critique et essayiste, il a contribué à de nombreuses revues dont Kalalou, Chemins critiques, Dérives, Québec Studies et Vice-Versa, la célèbre revue interculturelle des années 1980. Il est également co-auteur du livre L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions.
Il est côtoyé par Monique Dauphin, militante engagée dans le mouvement des femmes immigrantes haïtiennes depuis plus de vingt ans au Québec. Elle a été engagée dans le mouvement des organisations féministes ainsi qu'au Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes de 1995 à 2001. Elle est membre du CA du réseau d'action pour l’égalité de femmes immigrées et racisées du Québec. Madame Dauphin, récemment retraitée, est aussi Mambo et a été longtemps responsable du dossier des femmes à la Maison d'Haïti, notamment du cercle des femmes endeuillées créé après le séisme de 2010 et qui a donné aux femmes un espace d'expression et de réparation de soi. Elle a aussi été très impliquée dans l'association entre les spiritualités haïtiennes et autochtones dans le cadre de la grande exposition Vodou qui a eu lieu il y a quelques années à Québec.
Finalement, Annick Maugile Flavien, plus connu sous le nom de Monique MF, qui est étudiante à la maîtrise en communication, affiliée au Centre d'histoire orale et de récits numérisés de l'Université Concordia. Animatrice de radio, cinéaste et journaliste multimédia, elle est née à Montréal de deux parents haïtiens et, contrairement à plusieurs de ses confrères haïtiens, elle a été élevée dans le secteur anglophone de Montréal, ce qui fait qu'elle a un vécu et une identité qu'elle appelle stratifiés. Ce vécu est le fil conducteur de ses travaux communautaires, créatifs et académiques. Ses principaux thèmes de travail sont la mémoire transcaribéenne, la division linguistique, la transmission intergénérationnelle des connaissances, l’impact de l’art urbain ou encore les générations stratifiées.
Avant de vous laisser la parole, j'aimerais rappeler la thématique de cette table-ronde. L'objet de cette table-ronde, qui s'intitule « Parcours haïtiens au Québec : rencontres, connivences, coïncidences, conflits et malentendus », est de présenter différents parcours de personnes d'origine haïtienne au sein de la société canadienne et québécoise. À travers le témoignage et la réflexion sur leur parcours, les participant.e.s nous brosseront un portrait complexe de ce que représente Haïti dans le contexte nord-américain ou, comme l'exprimait avec grande justesse feu Émile Olivier, « ils se sont retrouvés à la fois otages et protagonistes ». Les traces d'Haïti se retrouveront dans leurs présentations à travers l'histoire, la littérature, les mouvements intellectuels et sociaux, la militance, le vécu migratoire ou minoritaire qui ont durablement marqué l'évolution de notre société. Aborder ces parcours nous permettra aussi de nous questionner depuis la perspective haïtienne sur les modalités et la nature des rapports tissés entre les peuples sur le territoire du Québec. Ce questionnement sera conduit en examinant à la fois les moments où la rencontre a été possible et porteuse ainsi que ceux où elle a été plus trouble et ambigüe, sans oublier les points de violence ou d'achoppement de cette rencontre. Je cède désormais la parole à Marjorie Villefranche.
Marjorie Villefranche :
Pour raconter cette première rencontre, je vais passer par ma vie personnelle. Je suis arrivée ici, j'ai immigré à douze ans, j'étais seule, toute seule, dans un avion, avec un petit papier et j'avais le nom de la dame qui devait venir me chercher. C’était la première fois que je foulais le sol québécois, la première fois que je quittais Haïti. Ma rencontre avec le Québec a été importante. Je vais vous avouer mon premier étonnement quand je suis sortie de l'aéroport : j'ai vu des ouvriers, et j'étais étonnée parce que les ouvriers étaient blancs, pour moi, un ouvrier ne pouvait pas être blanc. Cela a été ma première rencontre et mon premier choc. Ensuite, à douze ans, je n’avais pas mes parents avec moi. Haïti, je ne connaissais pas beaucoup. Je connaissais comme enfant, petite, mais je n'ai eu personne pour m'expliquer Haïti, personne pour m'expliquer mon histoire, personne pour m'expliquer ce que je faisais là. Et donc j'ai dû apprendre Haïti au Québec.
Ce n’est pas pour rien que je suis à la Maison d’Haïti depuis longtemps. C’est parce que c’est à la Maison d’Haïti que j'ai appris Haïti. C'est là que j'ai appris d'où je venais, l'histoire, mes traditions, tout. Voilà une étrange rencontre qui fait qu'il y a quelqu'un qui arrive d'Haïti mais qui n'est pas haïtienne parce que personne ne lui a expliqué et qui finit par trouver un organisme qui lui explique et qui prend la peine de faire tout ce trajet avec elle. Je dis toujours pour cette raison que la maison d'Haïti m'a sauvé la vie car j'avais l'impression de toujours être une personne à qui il manquait un morceau, comme un puzzle. Il y a toujours une pièce qui manque, et je pense que c'est la Maison d'Haïti qui m'a rendu la petite pièce qui me manquait, qui fait que je suis une personne entière maintenant.
Bien sûr, j'ai vécu toute cette communauté. J'ai vécu l'histoire de la communauté parce que travailler à la Maison d'Haïti c'est comme si on était à l'avant-plan et que l’on regardait la communauté se développer. On regarde le Québec se développer et s'adapter à la communauté haïtienne, on regarde la communauté haïtienne s'adapter au Québec et on est presque placé dans une position où on voit venir les choses. J'ai pu voir changer une communauté. Vous savez, c'est un privilège d'être dans la position où on peut voir les choses changer : regarder les besoins dans les années 1970, les voir changer dans les années 1980/1990, observer comment les gens changent, comment au travers des générations des choses évoluent et des choses demeurent les mêmes. Voir tous les chocs : le choc des jeunes, le choc des taxis, le choc du SIDA où on nous a stigmatisé. J'ai pu assister à tout cela. Mais j'ai aussi assisté à la réconciliation parce que cela n'a pas toujours été que des chocs. Il y a eu aussi des réconciliations, surtout après le tremblement de terre. C'est là que l'on a vu la plus grande manifestation de solidarité de la communauté québécoise avec la communauté haïtienne.
Les choses ne sont pas toutes réglées mais je trouve qu’il y a quand même beaucoup moins de chocs. Et à force de regarder cette communauté, de vivre dedans, d'être à l'avant plan, je trouve intéressant de constater à quel point la communauté haïtienne et Haïti alimentent le Québec. On se connait tellement que l’on est désormais un peu dans l'imaginaire les uns des autres. Les Québécois vont créer des choses et il y aura la présence des Haïtiens dans leurs créations. Respectivement, les Haïtiens vont aussi faire des créations caractérisées par la présence des Québécois. On imagine les choses en considérant la présence de l'autre à côté de soi. Quant aux moments les plus difficiles pour la communauté haïtienne, je pense qu’il s’agissait de toutes les manifestions de racisme au niveau des taxis, du Sida ainsi que de la stigmatisation au niveau des gangs de rue. Ce sont des chocs lors desquels une partie de la communauté s'est détournée du reste de la communauté pour se démarquer de ces évènements-là, et c'était vraiment dommage. La communauté haïtienne au Québec est aujourd'hui une vieille communauté. Lorsque l’on parle de nous, on dit : « une vieille communauté comme la vôtre ». Et c'est une vieille communauté qui s'est bien installée dans le pays, qui a produit énormément de choses au Québec, et qui a produit énormément de professionnels de tout ordre qui travaillent dans ce pays-là. Je pense qu'une de nos créations, avec le reste de la communauté noire bien sûr, c'est cette nouvelle culture afro-québécoise. Cela nous appartient mais cela appartient au Québec également. L'une des batailles que l'on doit encore mener est que cette culture-là ne reste jamais à la marge. Elle est québécoise, c'est quelque chose de nouveau, et c'est beau.
Robert Berrouet-Oriol :
En guise de mise en contexte, je crois utile de rappeler ce qu’a été pour moi le magazine transculturel Vice-Versa au court des années 1980-1990 dans le paysage littéraire et culturel montréalais. Vice-Versa, auquel j'ai collaboré un certain temps, a fortement donné de la voix durant le fameux colloque de 1985 « Écrire la différence », organisé par Sherry Simon de l'Université Concordia, qui interpella à bon escient les mirages univoques du multiculturalisme canadien. « Écrire la différence » cristallisa l'ouverture sur d'autres ailleurs, d'autres cultures, d'autres imaginaires alors que je préparais la sortie chez Triptyque de mon premier recueil de poèmes, Lettres urbaines, en 1986. J'ai trouvé dans l'environnement immédiat de la revue Vice-Versa d'innovants pisteurs de signes, de langues, de cultures et d'inventives copulations. J'y ai fréquenté des guetteurs de signes urbains, interpellant les replis identitaires de la pensée unique ainsi que le principe de l'assignation de l'identité par la langue. Dans le contexte de la large et sinueuse quête d'identité des Québécois pure laine, alors que je vivais à grande cuvée à l'Office de la langue française où je travaillais une singulière entreprise d'aménagement linguistique du Québec issu de la loi 101, voici que je trouvais au carrefour fécond de la revue un environnement propice à des réflexions plus amples, plus polyphoniques, plus ouvertes à l'enrichissement transversal et constamment mutant des identités comme des différences. Á son époque, la revue Vice-Versa, publiée entre 1983 et 1996, attira fortement mon attention par le repositionnement qu'elle promouvait au cœur même du débat sur le multiculturalisme et le biculturalisme. Voulant transcender tous ces paradigmes qu'elle considérait comme restrictifs, elle militait pour une position transculturelle. Cette revue se référait clairement au mouvement anti-globalisation, laissant entendre qu'un autre monde était possible et cela, avant même que ces idées passent dans la doxa et que les échecs des politiques sociales en lien avec la globalisation soient discutés et remis en cause. Vice-Versa a en son temps proposé le transculturalisme comme alternative au multiculturalisme canadien, au nationalisme québécois et au néolibéralisme déchainé des années 1980-1990. Porteur de neufs questionnements et d'une autre vision, autrement plus moderne, plus urbaine, polyphonique, plus polysémique que l'audacieuse revue Dérives, le magazine transculturel Vice-Versa – qui a publié 54 numéros – a constitué pour moi le plus fertile des terreaux sur lequel mon cheminement intellectuel et poétique a su trouver sa décisive et durable articulation. Avec le recul du temps, j'assume que ce n'est pas l'île native Haïti qui a été dans ce contexte au centre de mon cheminement intellectuel et linguistique alors même qu'elle s'y trouvait en structure profonde. C’est avec le compagnonnage convivial des artisans de Vice-Versa – aujourd'hui en ligne – que j'ai questionné mes petits dogmes identitaires. J'y ai confronté la séduction de la mono-identité québécoise, interpellé le multiculturalisme canadien et dessiné mes premières poésies tout en accueillant d'un œil critique des productions littéraires du Québec et d'ailleurs. Je suis également redevable à l'aventure vice-versienne de m'avoir incité à réfléchir au sédimentaire de ma culture d'origine. À la suite de Jean Price-Mars, qui est sans doute le premier à avoir identifié ce qu'une certaine sous-culture haïtienne recèle d'exclusion et de racisme en écho poétique et contemporain, l'œuvre romanesque de Frankétienne en témoigne. C'est bien au creuset de ces idées que j'ai trouvé quelques éléments de réponse à la question du lieu d'où je parle.
Dynamique d'une redéfinition de la transculture menée par Vice-Versa, la revue m'a ouvert les voies d'accès d'une pensée transculturelle œuvrant à la salutaire contamination des cultures caribéennes comme des cultures continentales. J'ai alors entrepris de faire mien le lègue de l'anthropologue cubain à qui nous devons Transculturation, Fernando Ortiz, auteur de Contrapunteo cubano del tabaco y el azucar paru en 1940. Ce titre a été édité chez Mémoires d'encrier en 2013. Dans ce contexte, j'ai adopté l'acculturation pour en déceler les signes contemporains probants comme pour revisiter les apports de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais de l'âme coloniale, et pour entrevoir cette émergence emblématique de toute cette littérature post-indépendance en France et en Afrique. Vice-Versa a alimenté ma curiosité à guetter les signes contemporains de la transculture dans un environnement où les discours cultuels dominants et médiatisés étaient à l'évidence d'une autre cuvée. Dans la belle province de la diversité culturelle qui se réclame de l'enrichissement de plusieurs dizaines de mémoires dites ethnoculturelles, dans le Québec de l'homme rapaillé qui est devenu la matrice aux îles de la Madeleine, à Chibougamau ou en Gaspésie, j'ai vu aller des rituels unijambistes forts exaltants de la mono-identité et du multiculturalisme. Rarement, très rarement, j'ai vu à cette époque la transculture dans nos manuels scolaires, dans nos films, nos multiples festivals d'été et dans la scène culturelle hyper-médiatisée. Alors, faut-il en conclure que la transculture au pays de la diversité culturelle est et demeure une pensée minoritaire ou une pensée pour minoritaires ayant fort peu d'emprise sur les mutations culturelles et sociales des vingt-cinq dernières années ?
Dans un texte, « L'effet d'exil », je m'interrogeais sur la faible réception ou la non réception des sujets migrants producteurs de fictions en langue française au Québec et il m'apparut nécessaire, grâce au travail pionnier de Ronald Sutherland, d'en dresser un tableau taxonomique accompagné d'une réflexion d'ensemble. J'ai entrepris de jeter les bases conceptuelles du phénomène des écritures migrantes et métisses au Québec, micro-corpus de la littérature québécoise d'environ cent soixante-quinze titres, publiés en français sur plus de vingt ans et au sein duquel les Italiens et les Haïtiens, mais aussi Haïti, la mémoire de l'île, occupaient le peloton de tête par le nombre et la qualité de leurs productions. C'est donc dans le contexte de mon compagnonnage avec Vice-Versa, véritable laboratoire de la postmodernité et de la transculture, qu'a été élaborée la première réflexion inaugurale sur les écritures migrantes au Québec, ample phénomène littéraire par la suite sur-théorisé sous la plume de plusieurs chercheurs universitaires de renom qui ont élargi l'environnement réflexif initial à d'autres perspectives (en témoigne entre autres le livre de l'essayiste québécois Pierre Neveu, L'apologie du réel, publié en 1999 ; celui de Clément Moisan et Rénaté Hidebrand, Ces étrangers du dedans. Histoire de l'écriture migrante au Québec, en 2001 ; celui de l'essayiste et psychanalyste Simon Harel, Les passages obligés de l'écriture migrante, paru en 2005 ; ainsi que l'étude de Gilles Dupuis de l'Université de Montréal, parue en 2007, Redessiner la cartographie des écritures migrantes). Il me semblait évident à l'époque que le phénomène des écritures migrantes était la meilleure illustration de la transculturation, abécédaire sur le versant de la culture urbaine du Québec. Le magnifique roman posthume d'Émile Olivier sur la pruderie, où il poétise les multiples mémoires de l'errance urbaine montréalaise, en est la parlante mise en signe.
Auparavant la météorite déstabilisante lancée en pied de nez par Dany Lafferière avec son Comment faire l'amour avec un noir sans se fatiguer annonçait une autre sorte de littérature nourrie non plus au petit lait de l'identité frileuse mais plutôt au fiel salutaire de Bukowski. Les producteurs de fictions venues d'ailleurs sont désormais reconnus dans le champ littéraire québécois. La présence au Québec de la première minorité visible francophone en provenance de la Caraïbe, la minorité haïtienne, ainsi que la première lutte de cette minorité ont contribué à une redéfinition de l'altérité et ont conduit à l'interrogation des manifestations du racisme dans un pays, le Canada, qui n'a pas de passé colonial institutionnel au sens où il n'a pas bâti d'empire colonial extraterritorial assorti de la constitution d'un système esclavagiste. Le référent contradictoire Haïti, par son mode d'inscription dans son combat contre la déportation des travailleurs, a contribué à une réarticulation de la réflexion sur les droits de l'Homme et sur l'accueil des réfugiés politiques. C'est dans ce contexte que le Québec a découvert non plus l'île paradis aux plages ludiques mais plutôt une île prison embastillée par la dictature des Duvalier.
La quatrième séquence, je vais terminer là-dessus, identifié en termes de parcours personnel, s'est installée suite au tremblement de terre de 2010. Je me suis alors fixé l'objectif avec plusieurs collègues d'apporter ma contribution de linguiste à la reconstruction du pays par la production en 2011 d'un livre de référence : L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Ce livre porte les traces de mon enseignement de la linguistique en Haïti vers 1992, période d'une courte migration au pays natal, et consigne une inédite réflexion théorique sur la problématique des langues en Haïti par l'introduction, entre autres, d'un appareillage conceptuel sur le droit à la langue, le droit à la langue maternelle, le bilinguisme de l'équité des droits linguistiques, de convergence linguistique et de didactique de convergence créole français, préfacé par le linguiste Jean-Claude Corbeil, le père de la loi 101 adoptée par le parlement du Québec il y a plus de trente ans. Jean-Claude Corbeil est une des grandes figures pionnières de l'aménagement linguistique du Québec et est co-auteur du fameux dictionnaire thématique Visuel traduit en vingt-six langues. Dans les différentes séquences de mon parcours personnel, la nécessité de la production d'une fiction poétique ne m'a jamais quitté, elle demeure centrale dans mon être au monde, dans mon enracinement au Québec et dans mon arpentage anaphorique de deux îles, Montréal et Haïti. J'assume que je suis né à la poésie au Québec, durant mon long engagement professionnel à l'Office de la langue française. C'est la réflexion sur une éventuelle poétisation des vocabulaires scientifiques et techniques qui m'a incité à entrer en poésie comme autrefois on entrait au monastère. Avec le recul du temps, il m'apparait aujourd'hui qu'Haïti n'a pas été au centre de ma production poétique. Mon projet poétique, qui porte en ses avenues les voix diverses de l'intime, sorte d'esthétisation de la langue elle-même, n'a pas élu l'île native de manière explicite au mitan de ma démarche de poète mais sur le mode d'une interpellation à distance. L'île native apparait par des traces lexicales dans mes Lettres urbaines. Ces traces se font plus nominales dans mon livre de 2005 tandis qu'elles s'énoncent tel un palimpseste par la convocation interrogative de mémoires des ancêtres dans En haute rumeur des siècles publié en 2009 et, de manière plus distanciée, dans mon Poème du décours paru en 2010, livre dans lequel je fais fiction de la mémoire de l'ailleurs.
Frantz Voltaire :
J'ai essayé d'aborder ce que j'appellerais une sorte de préhistoire de cette présence haïtienne dont on retrouve des traces depuis 1928, à partir de cette rencontre ou non-rencontre entre le premier groupe d'Haïtiens existant au Québec, entre Dantès Bellegarde et Robert Rumilly. Dantès Bellegarde, représentant d'une partie des élites francophones en Haïti et ministre de l'Éducation nationale, grand penseur francophile qui définissait Haïti comme une province intellectuelle de la France, voit dans le Québec une des voies d'accès à la modernité pour Haïti – nous sommes à l'époque de l'occupation américaine (1915-1934). Il voit une sorte d'hypothétique alliance entre deux sociétés qu'il définit comme francophones dans un contexte à la fois anglophone et hispanophone. C'est à ce moment-là que se constituent autour de l'Université Laval des premiers groupes, « Amitiés haïtiennes », où les gens vont visiter Haïti. C'est à ce moment-là que l'on voit ces premières tentatives d’alliance qui vont se cristalliser en 1941 avec quelque chose qui va être déterminant dans les relations futures : l'arrivée massive de missionnaires québécois et franco-américains en Haïti. En 1941, sous le gouvernement Lescot, le clergé français – et plus particulièrement breton – en Haïti se révèle très vite vichyste. Pour les Américains, qui viennent de rentrer en guerre, il faut combattre ce clergé et envoyer en Haïti un clergé francophone canadien, notamment monseigneur Collignon aux Cayes. On voit ainsi débarquer en Haïti les premiers missionnaires canadiens-français. Dans leurs journaux, les missionnaires bretons dénoncent l'arrivée des étrangers qui viennent prendre leur place dans l'Église en Haïti alors que celle-ci est contrôlée par un clergé breton depuis le concordat de 1860. On assiste à l'arrivée de missionnaires et, avec eux, à tout ce que cela implique, c'est à dire la formation de prêtres qui, ne pouvant plus aller en Europe, sont envoyés au Québec. De plus, des liens vont se tisser entre ces missionnaires et les villages québécois qui vont envoyer des sous pour les enfants en Haïti, ce qui va entretenir ces liens mais aussi une fausse connaissance d'Haïti. Ensuite, alors qu'il était venu en visite en 1943, le président Lescot trouvera l'asile au Québec en 1946. Entre 1928 et 1958, c'est une petite communauté qui s'établit ici. Cette communauté est composée d'étudiants qui maintiennent des liens avec Haïti mais qui sont à la fois francophones et issus des élites haïtiennes. Certains d'entre eux vont rester mais cette communauté est essentiellement de passage. Toutefois, elle contribue à établir d'une certaine façon le dialogue avec le Québec.
La rupture arrive avec la dictature des Duvalier, en 1958. Un changement va s'opérer, une dictature va se radicaliser de plus en plus et, entre 1958 et 1971, on assiste à l'arrivée d'exilés politiques. Parmi ces exilés, on trouve tout le groupe « d'Haïti littéraire » autour d'Anthony Phelps et de poètes qui arrivent comme exilés sortant de prison pour la plupart. Tout ce groupe rencontre des écrivains québécois en rupture comme Nicole Brossard et Gaston Miron autour d'un café, « Le perchoir d'Haïti ». Il y a donc toute cette rencontre qui se fait dans les années 1960 entre ces groupes littéraires et cet exil qui va se perpétuer dans le Québec de la Révolution tranquille. J'ai eu la chance de visiter le Québec en 1958, j'avais dix ans, et j'ai encore cette photo où, devant l'oratoire St Joseph, on distingue le Québec catholique avec des religieuses voilées. C’est alors un Québec où le nombre de femmes voilées est bien plus important qu’aujourd’hui... Certes, le Québec s'en est émancipé mais cela ne fait pas si longtemps.
Je prends ensuite la date symbolique de 1971 pour marquer une nouvelle rupture parce que, dans le cheminement de la communauté haïtienne, c'est à partir de 1971 qu'il y a une sortie de la clandestinité. La plupart des Haïtiens qui arrivaient au Québec s'inséraient sur le marché du travail en tant qu’enseignant, médecin, dans le secteur de la santé ou de l'éducation. Mais à partir de 1971, autour d'une revue qui s'appelle Nouvelle optique – dont le nom était déjà tout un programme parce qu'en Haïti, Optique était la revue de l'Institut français – il va y avoir une réorganisation politique après la mort de Duvalier. C'est également le moment des organismes communautaires avec deux grandes tendances qui étaient dans la gauche haïtienne de l'époque. D’une part, celle des curés catholiques de gauche, autour de Paul Dejean, Carl Lévesque, et des gens de la mouvance social-catholique qui vont créer le Bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. D’autre part, des rencontres entre des jeunes étudiants haïtiens comme Monique Jumelle, Charles Tardieu et des gens liés à la gauche haïtienne laïque qui vont être à l'origine aussi de la Maison d'Haïti. Ils vont tous écrire dans la revue Nouvelle optique. Max ou Adeline Chancy, Paul Dejean, tout le monde écrit parce qu’autour de cette revue, qui aura une vie courte (neuf numéros), commence un certain nombre de débats notamment autour du marxisme. Certains s'en détachent, comme Claude Moïse. Entre 1967 et 1969, Montréal a servi de relais. Auparavant, c'était Paris qui était le relais pour la gauche haïtienne parce que les gens sortaient des pays socialistes, passaient par Paris, et re-rentraient par la Colombie, par la Jamaïque et tous les circuits clandestins. À partir de 1967, ces circuits sont coupés par le travail de renseignement et Montréal va devenir une sorte de relais, de lieu de passage et de support à cette tentative de résistance armée en Haïti. En 1969, c'est la grande débâcle. À partir de là, effectivement, il n'y a pratiquement plus de résistance en Haïti. Donc en 1971, à la mort de Duvalier, les gens vont ressurgir.
1986 est un autre moment important, avec la chute de Duvalier fils et l’accélération de la migration. Il y a un changement aussi dans la composition de la migration. La migration auparavant était essentiellement une migration de classe moyenne et d'élites, ce qui donnait une caractéristique sociologique à la communauté qui, à mon avis, n’est pas représentative de la population haïtienne. Cela n'est pas le cas de la communauté à Miami, aux Bahamas, en République dominicaine ou à Cuba. Pendant très longtemps, l’attitude de la communauté était résumée par cette phrase d'Émile Olivier qui avait dit à Jacques Godbout : « écoutez-moi. Je suis ici, comme on dit en créole, pour parer la pluie », c’est-à-dire « je viens ici m'abriter et après je retourne chez moi ». Godbout lui avait alors répondu : « Tu sais ce qui va t'arriver lundi ? Tu vas chercher du travail. Et ce qui va t'arriver, c'est que ta petite-fille, des années plus tard, sera devenue québécoise ».
Certains sont retournés en Haïti à la chute de Duvalier. Dans les années 1970, lors des rencontres importantes entre les intellectuels haïtiens et les intellectuels de la communauté noire – notamment lors du congrès des écrivains noirs – on a développé des relations. Les débats qui se posaient alors étaient les suivants : comment définir l'identité ? ; comment saisir cette identité qui était en train de se transformer ? ; est-ce qu'il fallait se définir comme Haïtien ou comme Noir ? Là aussi, c'est un débat qui s'est posé. Je me rappelle des débats très aigus qu'il y a eu avec Esmeralda Tornhill qui disait : « mais non, vous n'avez pas à vous définir comme Haïtiens, vous êtes des Noirs ». Ce sont des questions qui semblent abstraites aujourd'hui mais qui étaient posées à l'époque. Durant ces années, on assiste à la fondation de revues comme Dérives, par Jonassin, et Le collectif paroles, qui a été un élément moteur d'ouverture, de débat et de découverte. Il n'y avait pas d'autre revue haïtienne à l'international. Et cela a duré jusqu'à la chute des Duvalier. J'étais lié à ces débats de loin, car j'étais au Chili, jusqu'à ce que Pinochet me pousse dans le dos. À partir de l'administration Carter, il y avait un débat sur la nécessité du retour en Haïti. Je suis rentré, mais de nouveau arrêté en 1979, on m'envoie ici, au Canada, où j'arrive comme réfugié. J'avais vécu ici deux ans auparavant, à ma sortie du Chili entre 1973 et 1975, comme étudiant, mais je suis véritablement revenu en 1979. Dans les années 1980, on observait déjà les grandes mutations de la communauté haïtienne et on s'est posé la question, dès ces années, de savoir s'il fallait créer ce centre de documentation et de réflexion (CIDIHCA), de savoir comment sauvegarder la mémoire de cette communauté. Est-ce qu'une communauté peut exister sans mémoire, sans traces ? C’est ce qui nous a poussé à créer ce centre et à vouloir y intégrer l'ensemble des gens. On a négocié avec tout le monde. Cela a pris beaucoup plus de temps. Cela a pris trois ou quatre ans pour convaincre les gens de travailler ensemble, beaucoup plus que pour former administrativement le centre, ce qui a pris quinze jours. De 1983 à nos jours, et quand Nouvelle optique a fait faillite, le centre est devenu par la force des choses une maison d'édition qui dure encore.
La nouvelle rupture est arrivée avec la chute des Duvalier, ce qui a débouché sur une mutation au niveau des organismes communautaires. Ceux qui sont arrivés à la tête de ces organismes communautaires étaient des personnes d’une génération née en Haïti mais qui avait grandi à l'extérieur ou dont l'éducation politique s'était faite essentiellement à l'extérieur et non pas en Haïti. Personnellement, j'avais quitté Haïti à dix-huit ans donc mon expérience politique s'est faite au Chili, très loin d'Haïti, et nous étions une grande communauté haïtienne de sept personnes... La chute de Duvalier va donc pousser des gens qui ont mis en place les premiers organismes communautaires à retourner en Haïti, des gens qui étaient arrivés ici adultes mais qui, politiquement, étaient Haïtiens. Même la revue Collectif Paroles va se saborder car la question du retour en Haïti va poser la pertinence du maintien de telles revues. À partir de ce moment, on (le CIDIHCA) s'est retrouvé à rentrer dans l'édition par effraction car il n'y avait plus de maison d'édition haïtienne. Nouvelle optique avait fait faillite, Le collectif paroles n'existait plus et il fallait quand même continuer à éditer quelque part. Autre chose de remarquable de cette communauté : le nombre d'intellectuels, d'écrivains ou de journalistes qu'elle a produit ou qu'elle avait ici. Quand même, s'il y a une comparaison à faire, c'est peut-être avec Vice Versa. Et encore, Vice Versa représentait essentiellement les Italiens du nord alors que l'immigration au Québec venait essentiellement du sud. Et il faut par ailleurs souligner la difficulté de cette communauté italienne à créer une animation culturelle au sein même d'un centre comme le centre Leonardo Da Vinci. En somme, ils ont de l'argent mais ils jouent aux boules... Donc se pose la question de l'après Duvalier. Pour moi, 1986 est une rupture parce qu'il fallait se redéfinir et redéfinir qu'elle était notre identité. Est-ce qu'on était ici pour rester ? Autre élément qui démarque cette histoire de l'histoire de la communauté haïtienne aux USA : c'est 1976 et l’Entente Cullen-Couture. À ce moment, la décision est prise de légaliser la présence haïtienne au Québec et il faut rendre hommage à Paul Dejean, à Carl Lévesque et à Maurice Couture, jésuite qui était ministre de l'éducation du Parti québécois à l'époque et qui avait décidé de faire des réfugiés vietnamiens et des Haïtiens un enjeu capital de sa politique. D'ailleurs, une fois résolu ce problème, il a démissionné et est parti pour une mission. Pour finaliser, la chute de Duvalier va nous obliger à redéfinir la communauté et on voit comment elle commence à s'insérer ici. On voit le niveau de participation politique augmenter au Québec. Il faut dire que la constitution haïtienne de 1987 avait établi un principe d'exclusion de la diaspora de la citoyenneté haïtienne. Donc nous n'étions plus des citoyens haïtiens. Nous étions des étrangers légalement en Haïti. Là aussi, cela poussait les gens non pas à rompre avec le pays mais plutôt à se redéfinir dans ce territoire que l'on s'était approprié. La création d'institutions communautaires et la multiplication d'organismes haïtiens montrent bien comment les Haïtiens se sont appropriés ce territoire. Une communauté très vivante s’était installée, avec une multiplicité d'organismes, aussi bien des organismes de retraités, de médecins, d'avocats ou encore la multiplicité – même si ce n’est pas ma tasse de thé – d'églises protestantes. Et donc voilà, je m'arrête là.
Monique Dauphin :
C’est quand même soixante-huit années de vie alors vous comprenez que… Moi je suis née dans une ville qui s'appelle Gros Morne – d’où je suis revenue hier soir – et je viens d'une famille militante, d'un père opposant à ce régime dictatorial dont mes camarades ont largement parlé. J'étais opposante mais je ne savais pas trop comment faire pour chasser ce régime. J'ai été diplômée dans une école que plusieurs connaissent, Elie Dubois, et j'ai enseigné pendant une année en Haïti comme professeure. Le 25 octobre 1969, je suis rentrée au Québec comme domestique.
Alors je m'arrête un petit peu pour que vous puissiez essayer de vous mettre dans la peau d'une fille de 22 ans, anciennement institutrice, et qui rentre ici dans une famille bourgeoise, même aristocrate je dirais, comme domestique. Pourquoi je m'arrête là ? Parce que dans cette petite partie de ma vie au Québec, mon introduction au Québec je dirais, il y avait la cloche… Madame m'appelait avec la cloche et je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué et qui, de plus en plus, continue à me marquer. Je me souviens encore être revenue en arrière, du temps de l'esclavage, et retrouver ce traitement qui m'était fait. Au lieu de m'appeler par mon nom, on sonnait la cloche. Et moi, je savais que je devais venir… Alors je vous fais grâce de tout ce qui se passait en moi, mais cela a été mon introduction au Québec. Je suis arrivée le 25 octobre, ne sachant absolument rien, de chez mes parents, à Dorval – à cette époque-là, c'était encore l'aéroport Dorval –, à dix heures le soir, avec cinquante dollars en poche. Des personnes qui devaient venir me chercher – Marjorie m'a incité à en parler parce que c'était important –, des religieuses qui devaient venir, ne venaient pas. Je ne savais pas comment passer un coup de téléphone. Je ne savais absolument rien. Et j'étais toute petite, on me donnait 14 ans... Alors je suis parvenue à demander à quelqu'un de m'aider à passer un coup de téléphone et, au bout du fil, on me dit que la religieuse qui devait venir me chercher a eu un problème et que je dois prendre un taxi. Alors là, comment prendre un taxi ? Heureusement, cette même personne m'a aidé à prendre un taxi. Là, j'étais en arrière d'un taxi, avec un monsieur qui avait les épaules larges comme ça et moi, j'étais toute petite comme ça, en arrière, avec une peur que je ne pourrais même plus expliquer. Et le moment grave de cette histoire, c'est quand le taxi est monté sur le métropolitain. Alors ça, ça a été… haan…, j'ai comme arrêté de respirer et ce monsieur-là qui disait : « calmez-vous mademoiselle, je vais vous amener ». Je vous fais grâce de tout cela. Cela a été mon introduction au Québec. Après une semaine, je regagnais la maison où je devais aller travailler en tant que domestique. De cette maison-là, j'ai travaillé comme puéricultrice puis à la manufacture. En tout cas, j'ai traversé le temps en faisant tout ce qu'une personne, une jeune fille, pouvait faire de correct, de normal pour gagner sa vie. Parce que derrière moi, il y avait toute une famille. Moi, je jouais le rôle de Legba, c'est-à-dire que je venais ouvrir les portes. Mais derrière moi, il y avait toute une famille pratiquement à supporter économiquement, avec le peu que je gagnais, mais aussi avec la mission de les faire rentrer au Québec, parce qu'il fallait quitter Haïti absolument. Mes camarades ont parlé de cette dictature qui nous poussait carrément dehors. On ne pouvait donc pas rester dans le pays. Même quand on avait un diplôme, qu'on avait trouvé un travail, il fallait s'en aller.
Après être arrivée, j'avais le sentiment que pendant tout le temps vécu ici jusqu'à 1995, j'avais laissé quelque chose derrière moi. Je me sentais comme amoindrie de quelque chose, malgré tout ce que j'ai pu faire avec des camarades que j'ai rencontré sur mon chemin à travers l'implication politique, le communautaire, la lutte des femmes. Bref, malgré tout ce que je pouvais faire, il me manquait quelque chose que j'avais laissé derrière moi. Je suis donc retournée en Haïti en 1995, avec cet espoir suscité par un gouvernement élu démocratiquement. Je suis retournée en Haïti, et arrivée en Haïti, la sensation que j'ai eu c'est d'avoir retrouvé cette autre partie de moi-même que j'avais laissé pendant tout ce temps-là. C'est là aussi que j'ai découvert le vaudou, le vaudou que j'ai adopté comme pratique, comme spiritualité ancestrale. J'ai commencé aussi à chercher à travailler pour comprendre ce que c'était que cette nouvelle réalité. J'ai aussi été impliquée dans les organisations des femmes en Haïti, notamment au Ministère à la condition féminine et aux droits de la femme où j'ai travaillé un peu avec Marjorie. J'ai cofondé l'organisation fanm yo la (les femmes sont là) qui devait intervenir sur la participation politique des femmes et, à un moment donné, il y a eu la réforme agraire et en 2001, j'ai dû à nouveau quitter Haïti.
Je reviens au Québec complétement anéantie, avec un sentiment d'échec parce qu’on gardait les valises encore faites, parce qu'il était question de retourner au pays. On a toujours travaillé pour retourner en Haïti. Voilà que je passe six ans là-bas avec mes enfants et je suis obligée de revenir au Québec. Et une fois qu'on finit par accepter cela – enfin, « accepter » c'est un grand mot –, je découvre la Maison d'Haïti. Alors là, la Maison d'Haïti a été fantastique, avec une personne en particulier, Marjorie, qui me dit : « je suis rentrée depuis une année » ; et moi, je lui dis : « je reviens là » ; et elle me répond « si tu restes, il y a quelque chose pour toi ici ». C'est comme cela que je peux dire que la Maison d'Haïti a été la maison d'accueil, la maison qui m'a permis de revenir au Québec d'une façon positive. Voir mon retour au Québec d'une façon positive m'a permis de m'impliquer dans un dossier qui était un projet pour jeunes mamans. Cela m'a permis de reprendre ma vie au Québec, de me refaire psychologiquement aussi et de réaliser quelque chose que je n'avais pas fait et qui m'a été signalé lors de mon retour en Haïti.
C'est donc à partir de 2001 que j'ai rencontré les Autochtones et c'était cette action là que je n'avais pas faite. Bien sûr, je devais retrouver mes enfants aussi, qui avaient perdu l'habitude de vivre ensemble, la famille avait été écartelée à nouveau. Donc j'ai rencontré les Autochtones et depuis ce temps-là, j'ai commencé à faire un travail d'échange sur le plan mystique, sur le plan culturel avec eux. Jusqu'à la participation à cette exposition sur le vaudou en 2012 et cette fameuse rencontre le 18 novembre 2012 avec les Autochtones dans le cadre de l'exposition. C'est une activité qui se continue d'ailleurs et notre projet futur est d'organiser une rencontre similaire, mais en Haïti cette fois. Mon dernier voyage en Haïti – dont je suis revenue hier – avait précisément à voir avec cet aspect-là. Je devais rencontrer des gens pour préparer ce voyage qui se fera quand les esprits donneront le « ok », parce qu'on ne fait pas les choses nous-même comme cela. Alors, j'ai découvert les Autochtones et la retraite a commencé à me faire signe. Cela a été une période extrêmement difficile. Je suis passée par toutes sortes d'émotions. Comment faire ? Car je ne savais pas faire autre chose que travailler, participer, militer… Là, il fallait que j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. Ma directrice m'a beaucoup aidé. Elle m'a accompagné dans ce processus qui est difficile, pénible, jusqu'à ce que je le fasse.
Ensuite, un nouveau retour en Haïti a été pour moi très difficile. En 2010, après le tremblement de terre, je suis partie en Haïti avec Pascale Anoual pour donner un atelier thérapie à des femmes dans un autre cadre que la reconstruction matérielle, celui de la reconstruction de la personne. Quelque chose s'est passé pendant ce temps-là. Ce n'est pas tellement le tremblement de terre, mais c'est que moi aussi, je me suis retrouvée endeuillée à mon tour avec la perte d’un cousin, de sa femme et de sa petite fille dans un accident de voiture. Donc j'ai dû enterrer ces trois personnes là et je suis revenue à Montréal avec l'odeur de la mort qui m'a poursuivie. C'est là que j'ai compris quand les femmes avec qui on travaillait dans le cercle des femmes endeuillées me disaient qu'elles sentaient la pourriture. On disait que le pays était un pays propre mais que ça puait partout. C'était l'odeur de mort. À partir de là, il y a eu une coupure avec Haïti. Une peur. J’ai développé une peur de ce pays. Au début, il fallait l'admettre, l'assumer et pouvoir en parler. J'ai réussi à faire tout cela mais je savais que c'est à partir des lakou, des cours sacrées, que j'allais pouvoir faire ce retour là et cette réconciliation. Tout de suite après ma retraite, le voyage est arrivé. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas organisé moi-même. Le voyage est arrivé. Quand j'ai appris que la course vers Souvenance allait fêter ses deux cents années de pratique vaudou, tout de suite, j'ai compris que c'était le signal, qu'il fallait que j’y aille. Et c'est à travers cela que j’y suis allée. Il y a eu des réconciliations, des réconciliations et des réconciliations. Je suis revenue hier soir avec cette énergie nouvelle et en paix avec moi-même car c'était quelque chose d'affreux pour moi de vivre fâchée avec Haïti. Les gens qui me connaissent savent ce qu'Haïti peut représenter. Être fâchée avec Haïti, trembler à l'idée même de mettre les pieds en Haïti, c'était quelque chose qui me rongeait.
Je ne ferai pas d'analyse. J'avais juste envie de vous parler. Je n'ai pas eu le temps de penser à cette table-ronde, je l'avoue. Je suis trop plongée dans des histoires de réconciliation, de redécouverte de ce peuple. Quand on me demande comment je vois cela, je dis : « j'ai vu un peuple qui refuse de mourir ». Tout est réuni pour qu'il meure, mais il refuse de mourir. Je regarde les femmes, je regarde cette énergie, je regarde comment les gens bougent, je regarde les élections dont le peuple ne parle pas lui-même. Ce peuple, il parle de trouver à manger. Comment font les gens pour manger ? C'est la grande question à laquelle personne ne peut répondre. Quand les prix sont hors d'atteinte, comment ces gens qui n'ont personne pour leur envoyer de l'argent de l'extérieur, qui n'ont plus de terre, ces gens qui vivent, comment ils font ? C'est la question que je me pose. Personnellement, je ne peux pas comprendre ce qu'il se passe mais en même temps, je comprends que c'est un peuple qui refuse de mourir. Si on refuse de mourir, faut-il bien qu'on vive. C'est cela que j'ai vu et c'est cela que j'avais envie de partager.
Annick Maugile Flavien :
Pour me présenter, je vais présenter mon travail parce que je suis jeune… donc mon parcours... je préfère vous montrer mes travaux. On va commencer par un épisode de The Matriarch qui présente les réflexions sur la relation maternelle et l'expérience monoparentale. Dans cet épisode on écoute Keithy Antoine Ladyspecialk qui me reçoit dans son espace « Espace Urbain » à Montréal. L'idée de la série The Matriarch est d’écouter les récits de mères célibataires à Montréal, de déconstruire les idées reçues sur les familles monoparentales et d’offrir un espace pour leurs histoires. Ce projet m’a été inspiré par ma mère et souhaite répondre au biais trop souvent présent dans la façon d’appréhender le quotidien de mères seules, notamment dans les communautés noires.
Je veux également vous présenter un autre travail, notamment parce qu’en tant que deuxième génération montréalaise, j’ai grandi dans quatre langues. Et puis j’ai été élevée comme Haïtienne dans un quartier anglophone de Montréal. Dans BUT I SPEAK SOUND (2014), j'ai voulu aborder les barrières langagières qui ont été imposée à mon expérience par des normes sociales qui opèrent une classification, une hiérarchisation des langues et des sons.



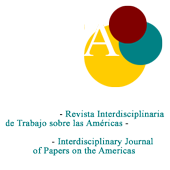




 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8