Entretien avec Alice Kaplan - Etienne Sauthier / Blanche Cerquiglini
Professeure de littérature française à Yale, Alice Kaplan, est l’une des plus grandes spécialistes américaines du XXe siècle littéraire français. Elle couple son travail en littérature à une démarche d’historienne et à un important travail d’archives. Elle est aussi romancière et essayiste. Dans cet entretien, elle nous parle de son rapport à la langue et à la littérature française, de la place de la littérature française et francophone au sein du monde universitaire américain. Elle évoque aussi de la manière dont celle-ci est aujourd’hui abordée par ses étudiants mais aussi son rapport actuel à la francophonie, qui passe notamment par l’Algérie, Marseille et se construit dans un rapport qui dépasse à bien des égards l’idée d’un centre parisien.
------------------------------
Entretien avec Alice Kaplan - Etienne Sauthier / Blanche Cerquiglini
Alice Kaplan, nous aimerions commencer notre échange en vous demandant quel est votre rapport à la langue française ?
Je suis née à une époque où le français était très important aux Etats-Unis, surtout dans le cadre de la formation des jeunes filles de la bourgeoisie. Dans mon école de jeunes filles du Minnesota, ma première enseignante de français était une Française, une femme de GI qui avait suivi son mari au retour de la guerre. Dans mon enfance, Jackie Kennedy, dont on connaît les origines françaises et qui était alors à la maison Blanche, nous apparaissait comme un modèle d’élégance et de beauté qui nous fascinait. Nous étions littéralement fascinées par la France. La langue française était déjà là, quelque part, dès mon enfance. Plus tard, ma mère m’a envoyée en Suisse, en pensionnat, durant un an : assez pour me donner le goût du français. Cela m’a permis de me sentir à l’aise dans la langue, et le français ne m’a plus jamais quittée. Le premier roman que j’ai lu en français, c’était L’Etranger de Camus, en colonie de vacances dans le Maine. La règle était de vivre entièrement en français : on lisait et apprenait des poèmes par cœur, on était censés ne pas prononcer un seul mot d’anglais, sinon on avait des mauvais points. Dès lors j’ai toujours gravité autour des cours de français, jusqu’à l’université ; ça s’est fait tout naturellement. J’ai fait ma thèse sur les écrivains fascistes français. Le tournant historique (« the historical turn ») en études littéraires était alors à ses débuts, après la période du formalisme. J’avais hérité de mon père, juriste au procès de Nuremberg, une passion pour les thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale ; j’ai hérité aussi de son intérêt pour le fonctionnement de la justice.
Quelle réception pour ces auteurs fascistes aux États-Unis (Brasillach, Rebatet, Céline) ? Etait-ce des auteurs maudits ? étaient-ils lus?
Ce sont des écrivains parfaitement inconnus aux États-Unis, sauf Céline qui a été très admiré par les écrivains américains, surtout dans les années 1960-1970. Au moment de la guerre du Vietnam, il était perçu comme un anarchiste enragé contre la guerre. Kurt Vonnegut en parle très bien dans sa préface à la traduction de la trilogie (D’un château l’autre, Nord, et Rigodon). Avec Philippe Roussin (Misère de la littérature, terreur de l’histoire), on a organisé un colloque à Duke University, « Céline, USA » dont les actes sont publiés[1] ; pour préparer ce travail j’ai envoyé un questionnaire à des écrivains américains de tous bords, afin d’essayer de comprendre leur rapport à Céline. J’ai découvert que peu d’écrivains connaissait ses pamphlets ; son antisémitisme restait plutôt anecdotique.
Quelle a été votre porte d’entrée pour la découverte de ces écrivains ? L’intérêt pour la Seconde Guerre mondiale ?
Yale, où j’étais étudiante, était alors le centre des études de la déconstruction, et notre éducation était très portée sur les travaux de Paul de Man et de Jacques Derrida dont on suivait les séminaires. Après la mort de de Man en 1983, on a découvert qu’il avait fait ses débuts comme journaliste en Belgique ; quelques-uns de ses articles portaient les traces de l’antisémitisme de l’époque. L’affaire de Man a été une sorte de ligne de démarcation entre une époque portée sur la déconstruction des classiques et un retour à l’histoire. À partir de là, on a commencé à élargir le spectre des textes qu’on lisait : des textes de genres littéraires qu’on n’aurait jamais lus auparavant, mais aussi des textes qui nous intéressaient non pas tant pour la beauté de leur style que pour l’idéologie qu’ils véhiculaient ; nous voulions comprendre leur forme et leur originalité par rapport au contexte. Ce sont des questions qu’on traite encore aujourd’hui au niveau doctoral. Au niveau « undergraduate » (licence), j’offre depuis dix ans, avec Maurice Samuels, un collègue 19emiste, un survol du roman français, où on ne lit que les « grands classiques », de Stendhal à Duras. L’année passée on a ajouté Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, à la fin du programme, pour une approche post-moderne et postcoloniale. Les étudiants ont tous lu L’Etranger au lycée ; je mets donc au programme de ce cours La Peste, qui a une forte actualité.
C’est justement une question que je voulais vous poser : quel statut pout les auteurs de la francophonie aux Etats-Unis, pour des auteurs comme Kateb Yacine, comme Kourouma et d’autres ? Est-ce que leur circulation vers les Etats-Unis passe par la France ? est-ce qu’il y a d’autres canaux d’arrivée ? d’autres espaces de circulation ?
La francophonie compte énormément aux États-Unis en ce moment. L’année passée, 80% des postes universitaires étaient tournés vers la francophonie non métropolitaine, du Maghreb aux Antilles et à l’Afrique subsaharienne. Cette année les postes disponibles offrent un profil plus classique mais l’intérêt pour la francophonie perdure, même dans les champs d’études littéraires avant 1900. Il est naturel de nous intéresser au post-colonialisme aux États-Unis, car on a été une colonie ; c’est dans notre ADN.
Est-ce que ces auteurs arrivent directement aux Etats-Unis ? Y-a-t-il un passage par la France ?
Il y a une différence entre Haïti et les Antilles, par le fait que les Haïtiens immigrent souvent au Canada, alors que la Martinique et la Guadeloupe sont des départements français, alors leur littérature passe par la France.
Et les auteurs antillais ? Quelle est leur réception aux Etats-Unis ?
Les auteurs antillais sont très lus et commentés, par exemple Chamoiseau, Confiant, Maryse Condé. Maryse Condé a enseigné aux États-Unis, à Harvard, en Louisiane, à Columbia, ce qui lui a donné un vrai impact. Son livre sur la sorcière noire de Salem, Moi, Tituba sorcière, est préfacé par Angela Davis dans son édition américaine. Pour revenir à cette réception des Haïtiens et des Antillais ici, on a recruté récemment à Yale un enseignant dont l’activité sera partagée entre le département d’Etudes Africaines-Américaines et le département d’Etudes Françaises et Francophones ; parmi les candidats les mieux classés il y avait plusieurs spécialistes d’Haïti, sensibles aux échos culturels et historiques autour de la révolution haïtienne, autour de Toussaint-Louverture, autour de l’abolition de l’esclavage, etc.
Toute autre question, celle du statut de la traduction : est-ce que le passage à la lecture traduite n’est pas aussi le symptôme d’un rapport moins important à la langue ?
En enseignant les classiques en traduction, on ouvre l’accès à la littérature aux non-francophones. Et en même temps, notre cours sur le roman français est proposé avec un TD pour ceux qui veulent lire et discuter en français. Ce modèle bilingue fonctionne bien pour les cours magistraux. Les étudiants ont souvent envie par la suite d’apprendre le français, par amour pour cette littérature. D’autres séminaires au département de Français ont lieu entièrement en français. Mais je reste une militante de la traduction aux États-Unis : il faut absolument l’encourager. Je considère comme un devoir à la fois la recommandation de livres en langue française et leur traduction. Plus que l’enseignement de la langue, c’est l’enseignement de la littérature qui est un combat. On a mis en place à Yale une initiative pour l’étude de la traduction. Notre idée est d’étudier la traduction et son fonctionnement sous toutes ses formes, et les thématiques qui y sont associées : traduction et rapport aux nationalismes, justice et traduction, traduction dans un cadre médical et hospitalier, politique de la frontière… Il y a tellement d’angles, de lectures essentielles, et beaucoup de travail à faire. Il existe un célèbre site web de Chad Post, qui s’appelle 3% [https://www.rochester.edu/college/translation/threepercent/]. « 3% », c’est le chiffre qu’on donne comme pourcentage de livres traduits sur le marché américain. On est censé être un pays d’immigration, mais l’anglais domine de plus en plus ; on ne sent pas assez le besoin de traduire, ce qui nous appauvrit.
Cela pose la question de la traduction des implicites (le sens d’une madeleine pour un français chez Proust, le type de langue choisi pour rendre la langue de Céline, etc.). A votre avis comment dépasse-t-on cette difficulté ?
Il y a une grande littérature critique concernant cette question chez Céline. Il y a eu deux traductions : celle de John Marx, qui a rendu la langue de Céline par une sorte de cockney english qui ne passe plus, et il y a son traducteur américain, Ralph Manheim, qui a décidé d’universaliser un peu plus la langue de Céline, se disant peut-être que si l’on avait pris l’argot new-yorkais des années 1950, ça n’aurait pas tenu dans le temps.
Sur cette question de la pérennité, cela me conduit à vous poser la question des traductions multiples, des retraductions. Quel enjeu quand on retraduit ?
Je viens de faire un cours pour les doctorants où on a travaillé la question de la retraduction. J’ai invité Laura Marris, qui travaillait à l’époque sur sa nouvelle traduction de La Peste pour Knopf, et avec qui j’ai écrit un livre à quatre mains sur la nouvelle lecture de ce roman pendant la pandémie [States of Plague : Reading Albert Camus in a Pandemic, à paraître en traduction française chez Gallimard]. Avec elle, je suis allée en Algérie, et à Oran, sur les lieux du roman. Ce sera la deuxième traduction du roman. La première, celle de Stuart Gilbert de 1948, est étrange, car Gilbert ne pouvait pas s’empêcher d’en rajouter, de retravailler le style de Camus par des gestes rhétoriques épiques, afin de le rendre plus élaboré. Toute la simplicité de Camus en souffre. On le comprend : Stuart Gilbert traduisait à la sortie de la guerre, il ajoutait des effets d’« héroïsme » à sa traduction, ce qui n’était pas du tout l’état d’esprit de Camus, qui redoutait justement le faux héroïsme. Du coup, étudier les traductions, les retraductions et leur contexte, c’est aussi une façon de comprendre les classiques. La traduction de Gilbert de L’Etranger est encore plus choquante ; j’ai fait une conférence sur la question au Collège de France qui se trouve en ligne. Et en 1988, Matthew Ward a retraduit L’Etranger de façon géniale, c’est sa traduction que j’utilise dans mes cours, parce qu’il a respecté toutes les spécificités du texte, et notamment le discours indirect, alors que Stuart Gilbert avait transformé des conversations en discours direct avec guillemets.
Pour revenir aux traductions et à leur contexte de publication, comment expliquer que certaines traduction aient eu au XXe siècle plus de chance de se faire en Amérique plutôt qu’en Europe ? Je pense notamment à Proust traduit en entier en Amérique latine avant de l’être en Espagne et au Portugal. Les raisons étaient-elles politiques ?
C’est probable, et puis il y a aussi eu la censure. Par exemple l’Espagne franquiste a empêché la traduction de L’Etranger de Camus, qui a dû se faire en Argentine, traduction qui s’est fait aussi grâce à l’amitié entre Camus et Victoria Ocampo.
Autour de Camus justement, il y a eu un tournant important dans votre parcours, en lien avec l’Algérie ?
Mon rapport à l’Algérie a renouvelé mon engagement littéraire. J’ai découvert des auteurs d’un grand intérêt, une maison d’édition indépendante (éditions Barzakh), qui a pu donner aux auteurs algériens un « copyright » national, sans passer d’abord par la France. Il y a comme un paradoxe : les Américains qui étudient la littérature algérienne le font souvent par le prisme de leur théorie postcoloniale, tandis que les éditions Barzakh veulent dépasser les formules politique, encourager des réponses esthétiques et formelles aux tensions politiques qui structurent le pays. Avoir accès à cette maison d’édition a été très important pour moi. C’est eux qui ont publié mon essai En quête de l’Etranger en édition algérienne, et mon premier roman, Maison Atlas, en synergie avec mon éditeur français. C’était pour moi un vif plaisir de travailler avec Selma Hellal, qui a été très attentive à ma représentation de la vie algérienne. Elle m’a soutenu dans mon désir de créer un lien étroit entre mes personnages et l’espace d’Alger. Du côté français, j’ai eu la chance de travailler avec Marie-Pierre Gracedieu, qui venait de lancer une nouvelle maison à Marseille, Le Bruit du monde, maison qui s’engage à explorer la littérature au-delà des frontières.
Ce qui est étonnant, c’est cette publication en traduction française avant la publication en version originale anglaise.
Oui, c’est assez inédit de publier la traduction avant l’original ! On verra pour la suite.
Est-ce que le roman va être traduit en arabe ?
Ce serait formidable. Pour le moment il faut passer par la réception en français et voir ce que ça donne. C’est une aventure unique.
Cet intérêt pour les espaces de Marseille et d’Alger, pour d’autres espaces francophones, mène à la question de la méthode de langue française que vous êtes en train de créer aux Etats-Unis, « Nous autres ».
L’astuce de mes partenaires Elisabeth Leuvrey et Karine Bonjour (avec le reste de l’équipe, Blanche Cerquiglini, Bernard Cerquiglini, Pierre Saint-Amand) était de concevoir une méthode de langue à travers le roman photo. De jouer ainsi sur le côté mauvais genre du roman photo pour prendre le contrepied à la fois des méthodes anciennes et actuelles, tout en proposant une image différente de la France, à partir de Marseille plutôt que Paris. L’idée était aussi de faire entrer l’oralité dans l’apprentissage du français. Il existait une ancienne méthode de français à Yale, « French in Action », qui date des années 1970, et qui s’inscrit dans le décor du 6e arrondissement, avec des Français blancs et des femmes de ménage portugaises « à l’accent bizarre ». C’est quelque chose qui ne passe plus, qu’il faut absolument changer. Nous autres correspond aussi à notre volonté d’enseigner aux étudiants américains plusieurs registres de langue à l’intérieur du français et plusieurs niveaux culturels.
Pour revenir à la circulation, à votre avis quels auteurs contemporains français ont du succès aux Etats-Unis ?
Pour ne prendre que des livres qui ont été cités dans la liste des best-sellers du New York Times, je pense à Irène Némirovsky, dont Suite française, son roman posthume, a eu beaucoup de succès, mais aussi Bonjour tristesse de Françoise Sagan, L’Amant de Duras, Le Premier Homme de Camus. Parmi les publications plus récentes, Meursault contre-enquête de Kamel Daoud s’est vendu je crois à 125 000 exemplaires, un chiffre énorme pour un auteur traduit. Un peu plus loin dans le temps, L’Elégance du hérisson de Muriel Barberis a bien fonctionné malgré une thématique très franco-française. Sans oublier bien sûr les auteurs français de bestsellers internationaux tels que Marc Lévy, Guillaume Musso, Joël Dicker ou L’Anomalie d’Hervé Le Tellier.
Et parmi les classiques, quels sont les auteurs les plus reçus ?
Il y a évidemment Camus, Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe, mais aussi Mémoires d’une jeune fille rangée et Les Mandarins). Les Misérables de Hugo, par le biais des comédies musicales de Broadway. Proust, bien sûr. Mais il est difficile de répondre car la littérature française est devenue mineure (et c’est d’ailleurs pareil pour la littérature anglo-saxonne elle-même) et les humanités, qui sont encore en bonne santé dans mon université, sont partout en baisse. Quand on enseigne les classiques, on explique à nos élèves que les auteurs postcoloniaux les ont tous lus. Dans un autre registre, je pense par exemple à Alejo Carpentier, quand il relit et retravaille la madeleine de Proust en tamale[2].
Et relativement à la relation entre langue et littérature ?
Durant de longues années les concours des universités américaines (SAT) recouvraient aussi bien la littérature que la langue française. Au fil du temps, la partie « littérature » de l’épreuve a été supprimé. Il n’y a donc plus de cours préparatoires littéraires en français au niveau secondaire ; les cours de français sont devenus des cours de civilisation. On a privilégié la langue face à la littérature par utilitarisme, en considérant la langue comme un outil, et la littérature comme un luxe. Avec heureusement des exceptions. La passion pour la littérature française perdure – même si c’est parfois sous forme de mythologie, déconnectée d’une réelle pratique de lecture. Dans notre survol du roman moderne, à Yale, on a vu que nos étudiants d’origine chinoise sont passionnés par Balzac et le comprennent particulièrement bien, à un moment où la Chine subit de grandes mutations capitalistes.
Du coup, les Amériques comme territoires du livre, cela se joue aussi à travers une vraie mondialisation des circulations et des études littéraires ?
On a aussi de nombreux étudiants d’héritage francophone (antillais, africains) qui s’intéressent à la littérature francophone, parfois à des littératures issues d’autres régions de la francophonie que la leur.
On peut se demander dans ce cadre quelles sont les perspectives de diffusion de la langue française…
Pour ne pas être entièrement pessimiste, il faut souligner la politique du gouvernement français qui a implanté de nombreuses écoles françaises aux États-Unis (Brooklyn, Minnesota, etc). Même les parents américains sans aucune origine française se sont rendu compte que les écoles françaises sont moins chères que bon nombre d’écoles privées américaines, et que la qualité de l’enseignement que reçoivent leurs enfants y est très bonne. Ainsi, de nombreux étudiants à Yale ont un bac international. Il y a un espoir dans cette bonne exportation de l’éducation primaire et secondaire française.
Quels sont à votre avis les ingrédients d’un succès littéraire français aux États-Unis ?
Si on regarde le succès de Kamel Daoud par exemple, cela peut s’expliquer parce qu’il a bénéficié d’une grande couverture médiatique, mais aussi du fait du rapport de son roman à L’Etranger, classique de l’enseignement américain. J’ai appris que les étudiants en première année à West Point (notre Saint-Cyr) lisent L’Etranger de Camus en même temps que Meursault contre-enquête. L’écrivaine Anne Garréta, dont les livres contiennent souvent des puzzles philosophiques, qui sont des romans qui « font penser », ont un grand succès chez nous. J’allais dire que les prix littéraires français n’ont aucun effet, mais ce n’est plus tout à fait le cas. L’année passée, l’Académie Goncourt a inauguré un Prix Goncourt « Choix américain » impliquant des équipes d’étudiants dans une poignée d’universités où l’étude du français est importante : Yale, Harvard, Duke, NYU, etc. Anne Berest a eu le prix l’année passée pour La Carte postale. Cela a beaucoup encouragé une intense discussion sur la littérature contemporaine en langue française chez nos étudiants undergraduate et graduate, qui pourra certainement créer de nouvelles habitudes de lecture.
Notes de fin
[1] Alice Kaplan, Philippe Roussin (dir.), Céline, USA, Duke University Press, The South Atlantic Quarterly, 93 : 2, Spring 1994.
[2] Large famille de plats cuisinés d’origine amérindienne se caractérisant par une cuisson à l’étouffée dans des feuilles de maïs. Alejo Carpentier, fait référence à un gâteau de maïs cuit dans des feuilles de maïs.
Pour citer cet entretien
Etienne Sauthier e Blanche Cerquiglini, «Entretien avec Alice Kaplan », RITA [en ligne], n°15 : décembre 2022, mis en ligne mis en ligne le 02 avril 2023.



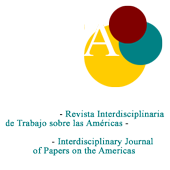
 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8