« Mauvaise» littérature, œuvres non commerciales et marché éditorial : les marqueurs d’une crise des valeurs multiple
Résumé
Les débats autour de la valeur littéraire seraient au cœur de l’actuelle « crise de la littérature » et des institutions littéraires ; le consensus entre les différents acteurs du monde littéraire sur des minima axiologiques semblerait presque inexistant. À l’aide des discours sur les écritures non-commerciales, ainsi qu’à la lumière des derniers apports de la sociologie des valeurs, cet article mène une réflexion sur les contradictions observées dans l’édition indépendante hispanophone autour de la notion de valeur littéraire et son application effective.
Mots-clés : Éditeurs indépendants ; Appropriationisme ; Valeur littéraire ; Crise.
"Bad" literature, non-commercial works and the publishing market: the markers of a multiple value crisis
Abstract
The concept of literary value seems to be tightly related to present "crisis of literature"; it is extremely improbable that the members of the literary world achieve a minimal consensus about what is worth in literary terms. Grounded on recent research in the field of the sociology of value, this article analyses alleged contradictions between literary axiologies and how independent publishers in Spanish position themselves when faced with clashing literary values.
Key words: Independent publishers; Appropriationism; Literary value; Crisis.
--------------------
Kevin Perromat
Maître de conférences en civilisation et littérature hispano-américaine
Université de Picardie Jules Verne, C.E.R.C.L.L.
Reçu le 8 novembre 2021/Accepté le 15 septembre 2022
« Mauvaise» littérature, œuvres non commerciales et marché éditorial : les marqueurs d’une crise des valeurs multiple
Introduction
Dans un ouvrage critique, la romancière espagnole Marta Sanz aborde la question de l’avenir de la littérature en partant de la « radicale conviction que la littérature n’intéresse presque personne aujourd’hui » (2014 : 8). Pour sa part, l’écrivain argentin Patricio Pron (2014 : 248-249) parle de façon encore plus pessimiste d’une sorte de « suicide » des industries culturelles en général, et plus concrètement de la littérature, dû aux mauvais choix corporatifs dans le contexte d’une crise économique globale et de transformations liées à la mondialisation (piraterie, contrefaçon, l’idée généralisée que la « culture doit être gratuite », etc.). Ce « suicide » serait dû aussi aux nouvelles poétiques qui préconisent l’effacement des auteurs, l’appropriation, les falsifications, la transformation des signatures littéraires en marques commerciales, la copie, le plagiat et, en somme, l’obsolescence des valeurs traditionnelles (style, originalité, beauté, etc.). Ces phénomènes sont expliqués en partie par Patricio Pron comme le résultat pratique des théories critiques prônant la « mort de l’auteur » à partir des théories de R. Barthes ou de M. Foucault.
Si le constat n’est pas nouveau – le même avertissement a été lancé par différentes voix depuis plus d’un siècle (par exemple, à l’occasion des querelles entre « auteurs » et « littérateurs », récurrentes depuis le XIXe siècle) –, il présente des traits paradoxaux qui semblent symptomatiques de la période contemporaine. Pour rendre publiques leurs visions critiques et appeler à des stratégies de résistance, Marta Sanz et Patricio Pron – tous les deux romanciers à succès publiant régulièrement avec des maisons d’édition pour le grand public et internationales, et dont l’œuvre a été récompensée par des prix importants – ont choisi deux labels éditoriaux indépendants, Periférica et Turner, respectivement, qui symbolisent un certain modèle de succès économique et artistique dans le monde de l’édition espagnole.
Simultanément et de manière significative, dans ce même monde éditorial indépendant, des acteurs prestigieux (Jorge Herralde, Beatriz de Moura, Roberto Callasso ou André Schriffin[1]) ont à leur tour tiré la sonnette d’alarme, non seulement en raison de l’affaiblissement et de la réduction des parts de marché des éditeurs indépendants par rapport à la production des grands groupes multinationaux, mais également pour dénoncer l’imposition par ces derniers à l’ensemble du secteur de stratégies purement mercantiles, spéculatives et industrielles − entre autres : sur publication, rotation accélérée des livres en exposition dans les espaces de vente, suivi scrupuleux du diktat des modes littéraires, externalisation et gestion entrepreneuriale des équipes allant même jusqu’à la « disparition des éditeurs » (c’est-à-dire du travail d’édition, de correction, de valorisation et de diffusion des textes[2]). Il est important de signaler que ces critiques fondent leur force non particulièrement sur des arguments que l’on pourrait qualifier de corporatifs, mais plutôt en signalant les préjudices prévisibles pour l’ensemble de la société. Ils considèrent que ces changements se produisent au détriment des valeurs traditionnellement portées et investies par le marché éditorial indépendant : notamment la biblio diversité (variété, richesse et hétérogénéité de l’offre éditoriale effective) et de manière plus fondamentale encore la valeur littéraire (artistique, esthétique, culturelle…) et critique (civique, politique, sociale…) des livres.
Or, justement, la notion même de valeur spécifiquement littéraire, qui semble essentielle pour la plupart des acteurs du monde du livre, serait également liée à l’origine de l’actuelle « crise de la littérature », dont la nature serait nécessairement polémique, et le consensus, ne serait-ce que sur des minima axiologiques, entièrement impossible. Ainsi, par exemple, alors que les « pratiques de (dé)négation et de silence » sont décriées par Patricio Pron – notamment les poétiques et les théories esthétiques appropriationistes, voire « plagiaristes » (2014 : 38-53) –, elles semblent constituer une tendance centrale de la poésie contemporaine. Ces poétiques ont été étudiées et soutenues par la chercheuse et écrivaine mexicaine Cristina Rivera Garza (2013), entre autres. Cependant, en ce qui concerne la prose, les différents scandales et les retombées économiques des contradictions avec le modèle de propriété intellectuelle en vigueur sont des facteurs qui semblent écarter ces possibilités subversives, et surtout pour le genre le plus rentable : le roman.
Dans cet article, nous mènerons une réflexion sur ces incompatibilités signalées entre les différentes valeurs littéraires et commerciales qui constituent le patrimoine littéraire, ainsi que sur certains exemples de leur application éventuellement contradictoire sur l’échiquier bouleversé de l’édition indépendante hispanophone. Pour cela, dans un premier temps, nous devrons nous interroger sur cette idée même de « crise de la littérature » à la lumière des évolutions récentes de l’édition hispanophone, des tensions et des prises de position par certains acteurs du champ littéraire. Il sera ensuite question d’essayer de dépasser les apories épistémologiques et disciplinaires à l’aide des derniers apports de la sociologie des valeurs. Enfin, celle-ci nous permettra de comprendre la coexistence d’axiologies contradictoires dans les discours et dans les œuvres des différents acteurs du champ littéraire, ainsi que d’aborder la signification dans cet état de choses de ces nouvelles poétiques : celles qui semblent de manière contradictoire enfreindre ou opposer des antivaleurs (littérature mauvaise, « post-autonome », « plagiariste », etc.) aux valeurs littéraires traditionnelles énoncées explicitement dans les discours critiques de légitimation, aussi bien qu’implicitement dans la production effective des éditeurs indépendants hispaniques.
I. La « crise de la littérature » et les valeurs de l’édition indépendante
Si l’on se concentre uniquement sur les indicateurs purement quantitatifs, la prétendue « crise de la littérature » ne serait rien d’autre qu’un fantasme, un épouvantail brandi par des hommes de lettres qui craignent la diminution et la perte à terme de leur reconnaissance et de leur sphère d’influence dans la société, comme de celles de leurs respectifs domaines académiques, médiatiques, éditoriaux, etc. Ceci était grosso modo ce que répondait Jordi Gracia (2011), professeur à l’Université de Barcelone, à son collègue Jordi Llovet (2011) − également traducteur, critique et éditeur − qui avait profité de son départ à la retraite pour dresser une esquisse apocalyptique et décadente de la littérature et de la culture, en général, et des disciplines académiques qui leur sont associées en particulier. Il semble indéniable que le nombre (et la proportion) de personnes capables de lire et d’écrire dans le monde (et dans les pays hispanophones) n’a jamais été aussi élevé ; de même que non seulement la quantité d’ouvrages, de textes artistiques écrits, publiés et lus (tous supports confondus) ne cesse d’augmenter, mais aussi celle de textes critiques ; et à cela s’ajoute le nombre toujours croissant d’étudiants en littérature (à l’échelle planétaire, malgré les différences selon les contextes nationaux particuliers), ainsi que l’augmentation du nombre de thèses doctorales consacrées à l’étude des œuvres littéraires. La crise, comme le signalait Jean-Marie Schaeffer, pourrait bien ne pas être celle de la littérature, mais celle des études (et des institutions) littéraires[3].
Face à ces arguments et chiffres qui invitent à l’optimisme, ceux qui défendent une vision plus critique ou sombre font valoir à leur tour des données hétérogènes, tout aussi objectivement vérifiables : la fermeture des librairies urbi et orbi, la réduction, voire la disparition des espaces médiatiques consacrés aux phénomènes littéraires, la relégation des maisons d’édition prestigieuses dans les conglomérats transnationaux des industries culturelles (Gallego Cuiñas, 2022 : 35-37, 54-59), la perte d’influence (et de renommée) des personnages littéraires, le rétrécissement des marges des auteurs et des éditeurs face aux géants du commerce électronique (par exemple, Amazon), la perte de prestige et d’attrait académique des « humanités »… Face aux statistiques absolues, ils avancent des paramètres moins complaisants et pointent que le temps moyen de lecture ne cesse de diminuer, que la moitié de la population ne lit presque pas, etc. Face à l’abondance de titres disponibles, ils dénoncent l’abandon des textes canoniques ou « de qualité » au profit de produits littéraires de masse, dont une bonne partie n’est composée que de produits dérivés d’autres industries culturelles… Ce qui rend particulièrement troublant ce constat si imprégné de pessimisme est le fait qu’il est partagé par des acteurs d’horizons idéologiques et aux positions relatives très divers dans le champ littéraire, allant du prix Nobel Mario Vargas Llosa (La sociedad del espectáculo, 2012), de l’écrivain et critique Damián Tabarovski (La literatura de izquierda, 2004) ou du critique et professeur Germán Gullón (Los mercaderes en el templo de la literatura, 2004) à des auteurs déjà cités comme Cristina Rivera Garza, Patricio Pron ou Jordi Llovet.
Dans cette interprétation des faits, l’édition indépendante est devenue le bastion de la résistance de la « bonne littérature » face aux attaques de la littérature commerciale – voire, selon les plus critiques[4], « non littéraire ». Ainsi, les éditeurs indépendants justifient de continuer à opérer dans le secteur et de surcroît les politiques, aides et espaces publiques qui permettent ceci, malgré des chiffres d’affaires moins compétitifs que leurs concurrents. Pour cela, ils font valoir toute un série d’arguments : une liberté face aux critères non littéraires (par exemple, économiques), un travail effectif de mise en valeur des manuscrits (correction, édition − co-réécriture avec l’auteur −, etc.), une cohérence dans le catalogue éditorial, souvent absente dans les groupes transnationaux (où les acquisitions et fusions portent atteinte à l’identité éditoriale), un traitement individualisé des œuvres et des auteurs, ce qui conduit à un meilleur suivi des ventes et des retours (et attentes) des lecteurs… Tous ces arguments sont évoqués dans Independientes ¿de qué? Hablan los editores de América Latina (2016)[5], un recueil particulièrement riche d’entretiens avec plusieurs éditeurs d’Amérique Latine (d’Argentine, du Mexique, du Chili, de Colombie, du Pérou et d’Uruguay). Des thèses très similaires avaient été avancées quelques années plus tôt par certains des éditeurs les plus prestigieux à l’échelle internationale (André Schriffin, Roberto Calasso, Jorge Herralde, etc.) lors de la création de l’Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants[6].
Cependant, il ne faudrait pas opposer complètement les valeurs portées par la « grande édition » à celles portées par les éditeurs indépendants. Comme le signalait avec fermeté Anne-Marie Métailié, un « éditeur indépendant n’est pas une ONG ». Autrement dit, les maisons d’édition indépendantes sont aussi des entreprises capitalistes et poursuivent un but lucratif[7]. Seuls les philanthropes (et les institutions publiques) bien lotis peuvent se permettre d’éditer à perte, dans le cas contraire la survie éditoriale se verrait compromise (et avec elle le catalogue des auteurs et des œuvres). Ce qui est revendiqué comme une spécificité est l’équilibre entre les raisons commerciales (en fin de compte, les indépendants se servent aussi de stratégies de marketing et de gestion entrepreneuriale pour gérer leurs sociétés) et les arguments non économiques (pas nécessairement littéraires, car un ouvrage peut être publié exclusivement pour des raisons morales, idéologiques ou civiques). Ce qui est mis en avant régulièrement par les éditeurs indépendants est la qualité de leur travail − qui suppose des activités de sélection, d’amélioration du manuscrit et de diffusion − et, par conséquent, la valeur intrinsèque de leur production. Celle-ci est une démarche explicite de différenciation par rapport à l’activité de grands groupes transnationaux pour lesquels « tout se vaudrait » (Vargas Llosa, 2012 : 35-36). Or, dans cette période de « crise de la littérature », il est légitime de se demander au nom de quoi ils valorisent les œuvres qu’ils publient. Autrement dit, si l’on reformule la question : que peut bien être aujourd’hui la « bonne littérature », celle qui aurait une certaine qualité (valeur) ?
Il y a de fortes chances pour que les réponses soient marquées par la tautologie ou qu’elles soient implicites (« nous publions ce qui est bien »), qu’elles soient subjectives (« parce que nous le trouvons bon, original, ambitieux, etc. ») ou qu’elles relèvent de l’extralittéraire (« un livre nécessaire », « il n’était plus disponible »). C’est le contraire qui serait extraordinaire. Même si l’on arrivait à rendre explicites les réponses[8], elles ne s’éloigneraient certainement pas beaucoup de celles que pourrait exprimer le responsable d’une collection d’un grand groupe transnational − ce qui est tout à fait normal considérant les mouvements fréquents des professionnels dans l’un ou l’autre sens entre l’édition indépendante et les grandes maisons d’édition. Cependant, il y a une explication d’ordre épistémologique au fait que les logiques (non-économiques) pour lesquelles se publient les livres font difficilement l’objet d’une justification complètement explicite ou raisonnée. Cette difficulté nous renvoie à la crise des disciplines et des institutions littéraires (critique, histoire, théorie, canon, etc.), évoquée plus haut. Comme l’a résumé le chercheur Vincent Jouve dans le préambule d’un ouvrage collectif consacré à la question, la définition de la littérature en tant qu’objet épistémique, ainsi que les valeurs qui lui sont associées sont nécessairement instables. Ceci est dû au fait que ces valeurs sont « évidente[s] (subjectivement) ou évanescente[s] (historiquement) », d’où l’impossibilité d’atteindre des vérités universelles, assortie de l’obligation disciplinaire de reposer inlassablement la question (2010 : 14).
II. Conflits de valeurs littéraires ou « axio-logiques » incompatibles ? La littérature à la lumière de la sociologie des valeurs
Depuis quelques années, nombreux sont les chercheurs des disciplines littéraires qui – à l’instar de ce qui s’est produit dans le monde de l’art (Schaeffer, 2016) − ont fait le constat de l’impossibilité de définir la « littérarité », et par extension la valeur littéraire, dans l’objet textuel, à moins de prendre en compte simultanément ses contextes de production, de circulation et de réception. Autrement dit, la qualité littéraire ne résiderait pas dans le texte, mais dans l’interaction entre celui-ci et ses lecteurs successifs. Les conséquences de cette démarche sont lourdes : entre autres, elle implique le renoncement à une catégorisation formelle d’ « originalité », de « beauté », de « cohérence » et à d’autres valeurs si chères (jadis) à la tradition critique et esthétique, sauf mettre en œuvre une relativisation en profondeur (qui prendrait en compte tous les contextes potentiellement pertinents) qui ôterait alors la possibilité même de vérité universelle immanente, transcendante à la matérialité textuelle en dehors de l’usage pratique − toujours circonstanciel − des notions axiologiques.
Ainsi, la principale cause de ce problème épistémique se trouverait dans sa nature sociale. C’est ce que souligne la chercheuse Annick Louis, car « si l’on accepte l’idée que la valeur des œuvres est déterminée par leur usage social, il faut se poser la question en amont et en aval, afin de permettre la constitution de corpus et de canons à partir d’autres critères que celui de la "qualité" » (Jouve, 2010 : 53). Or comment aller « en amont et en aval » de cet usage, en dehors duquel, d’ailleurs, la « littérature » n’existerait pas ? Dans un ouvrage relativement récent (2017), qui poursuit et systématise des travaux précédents, la sociologue Nathalie Heinich propose une solution qui permettrait de sortir de l’impasse théorique imposée par l’antinomie objectivisme / subjectivisme ; la série de réponses et d’hypothèses de travail apportées implique la suppression des fondements spéculatifs (notamment la tradition philosophique d’origine kantienne, qui lie épistémologiquement l’esthétique et l’éthique) au profit de la pragmatique et de la philosophie du langage d’Austin et Searle. Il y aurait une grammaire axiologique similaire au système saussurien qui comprend une langue (compétence universelle), une norme (système normatif) et une parole (actes effectifs).
Nathalie Heinich constate qu’en matière de valeurs, les chercheurs ont systématiquement privilégié dans leurs études les conflits et les oppositions axiologiques. Ce faisant, ils négligent le fait − qui semble incontestable, et qui avait déjà été remarqué par Kant – qu’il y a davantage de consensus et de communication sur les valeurs et l’ensemble des objets et des actions auxquels elles s’appliquent, que de désaccords et d’incompréhension. En réalité, les acteurs peuvent ne pas être d’accord sur des jugements concrets (sur la pertinence qu’il y a à appliquer certaines valeurs à certains objets), mais rarement ils contesteront la légitimité des valeurs en elles-mêmes. En matière littéraire, par exemple, il est plus habituel que l’on nie l’originalité effective d’un texte plutôt que l’on conteste la pertinence du critère d’originalité pour juger les œuvres littéraires en général. Celui-ci semble toujours pertinent à la seule exception du contexte spécial de l’avant-garde ou de l’expérimentation, dans lequel la bonne ou la mauvaise décodification pragmatique (ironique, mimétique, postmoderne, etc.) explique les exceptions à la valeur d’originalité (nous y reviendrons).
La deuxième constatation que fait Nathalie Heinich − et qu’il est également difficile de contester − est la polysémie et la pluralité des valeurs ; la première résulte de l’histoire de la société, la deuxième de la multiplicité des registres axiologiques : la famille, le travail, la morale, l’éthique, la loi, l’esthétique, le sensoriel/plaisir, la religion/spiritualité, etc. La valeur littéraire est en fait une galaxie de valeurs, car les valeurs semblent fonctionner plutôt par association que de manière isolée. Ainsi, dans le paradigme classique, on associait facilement la religion, l’éthique et l’esthétique, sans pour autant qu’il soit impossible qu’interviennent d’autres valeurs dans les jugements axiologiques, tels que la nation ou la famille. Par conséquent, la polysémie inhérente aux valeurs reflète, d’une part, l’histoire et les contextes contemporains dont elle résulte et où sont prononcés les jugements axiologiques et, d’autre part, les valeurs sont aussi plurielles en elles-mêmes et se déclinent en sous-valeurs (les valeurs hétéronomes qui leur sont habituellement associées). Dans le champ artistique et littéraire « par-delà le beau et le laid » existe toute une série de sous-valeurs telles que : l’authenticité, l’autonomie, la célébrité, la cherté, la moralité, la pérennité, le plaisir, la rareté, la responsabilité, la significativité, le travail, l’universalité, la virtuosité[9] ; l’énumération n’est pas exhaustive.
Ce qui rend intéressante cette approche est le fait qu’elle permet d’expliquer la simultanéité ou la succession d’« axio-logiques » − des logiques de valeur, s’il m’est permis de me servir de ce néologisme − apparemment incompatibles : par exemple, faire des bénéfices économiques/être sincère-authentique/avoir une réputation/publier uniquement de la bonne littérature sans considérer le nombre de lecteurs potentiels, etc. L’approche de Heinich nuance la conception et la division bourdieusienne aujourd’hui classique entre les pôles symbolique et économique du champ littéraire. En fait, les compromis et la complexité des stratégies de valorisation semblent être la norme plutôt que l’exception. On peut prendre comme exemple l’ouvrage déjà cité qui recueille le témoignage de plusieurs éditeurs latinoaméricains ; dans les pages préliminaires, les auteurs Hernán López Winne et Víctor Malunián définissent (2016 : 4-14), d’après Constantino Bértolo, l’éditeur indépendant comme un « être hybride » : « à la recherche de cet équilibre par lequel l’orientation de son catalogue est fixée par la qualité tout en concevant son entreprise comme un projet rentable » ; un statut qui « n’a rien à avoir avec la taille de l’entreprise ou le capital investi, mais avec le fait d’éditer à contre-courant ». Cette définition des principes est déclinée par la suite en termes de « marché » (public visé), d’« autonomie » (bénéfices suffisants), de « capital » (indépendant, ce qui exclurait les labels indépendants des grands groupes, souvent fruits d’acquisitions et non d’un projet propre), d’« agentivité culturelle » (capacité à dynamiser – « être significatif » dans − la vie culturelle de la société), de « professionnalisation » (efficacité dans l’élaboration matérielle du livre). Pour sa part, le chercheur Gilles Colleu, ajoute que :
L’éditeur indépendant de création devrait être vertueux : il cherche les alliances sans écraser les autres, il ne cherche pas à voler les auteurs des autres éditeurs, il respecte les droits des auteurs et des traducteurs, il ne fait pas des stagiaires une main-d’œuvre exploitée, il contractualise ses salariés et ne les rémunère pas en droits d’auteur, il respecte la loi sur le prix unique lorsqu’elle existe (2006 : 85).
Ce qui est remarquable dans cette caractérisation est le naturel avec lequel des valeurs (justice, moralité, civisme, légalisme, etc.) hétéroclites et hétéronomes par rapport aux valeurs esthétiques coexistent dans la mise en valeur de l’activité et de la production de l’édition indépendante, apparemment sans contradiction, parce qu’elles opèrent dans des « axio-logiques » (contextes/champs axiologiques) qui n’entrent pas en collision. Ceci est dû au fait qu’elles ne s’opposent pas effectivement entre elles (elles ne font pas référence aux mêmes domaines de l’activité d’édition), mais dans le jugement sur leur pertinence au regard des acteurs du champ éditorial pour juger des objets et des actions concrets. L’approche de l’axiologie pragmatique permet donc de surmonter l’apparente disjonction entre valeur objective et valeur subjective, car les valeurs comme catégories de communication interpersonnelle sont bien réelles (objectives) au même titre que les locuteurs d’une langue partagent un système dont l’existence n’est pas − ne peut pas être − hypothétique, dont ils font un usage unique (subjectif).
Il n’y a pas réellement de conflit concernant les valeurs revendiquées par les éditeurs indépendants. Ainsi, qui pourrait s’opposer (ouvertement) au respect éthique des lecteurs, traducteurs et auteurs ? L’objet des disputes n’est pas les valeurs, mais leurs usages. Les editoriales cartoneras − véritable phénomène éditorial et social en Amérique latine −, par exemple, font valoir le caractère artisanal (et donc unique) de chaque exemplaire qu’elles produisent[10]. Cela ne veut pas dire que la « singularité », la « rareté » ou le « travail manuel » soient des antivaleurs dans le monde de la grande édition. Tout simplement, ce ne sont pas des valeurs pertinentes dans ce contexte axiologique particulier. Un autre exemple, bien plus polémique cette fois, est celui des éditeurs indépendants qui demandent[11] le respect des « droits d’auteur » et de « la propriété intellectuelle » et qui peuvent, cependant, publier des ouvrages que d’autres trouveront contraires à ces mêmes valeurs, comme c’est le cas des poétiques « appropriationistes » (celles qui ne respectent pas les notions orthodoxes d’auteur ni d’originalité, ni les restrictions légales établies par le système du Droit d’auteur). Les défenseurs de ces pratiques ne contestent pas en réalité la valeur de la « légalité » mais sa pertinence (qu’elle puisse imposer des critères) à l’heure de juger ces œuvres littéraires[12]. Ces paradoxes axiologiques ont été monnaie courante pendant toute l’histoire de la littérature ; ils présentent un intérêt particulier pour les chercheurs, parce qu’ils dévoilent souvent les enjeux implicites des évolutions littéraires.
III. « Pour une mauvaise littérature » : plagiat et autres paradoxes axiologiques du déclin de l’empire littéraire
En 2004, le critique et professeur Germán Gullón annonçait avec une grande tristesse la « fin de l’Âge de la littérature » − période avec des bornes chronologiques bien marquées : 1800-2000 – évènement qui lui permettait de lier la fin (fatale) de l’autonomie du champ axiologique de la littérature à l’avènement de la mondialisation et d’internet : « La littérature existe confondue avec les déchets informatiques, le surplus numérique, verbal et iconique qui pullule pêle-mêle dans l’univers virtuel, filtrée par les pires desseins commerciaux, ouverts et agressifs, qui s’impose sur l’écran par ses fenêtres publicitaires » (2004: 35). L’essai de Patricio Pron, El libro tachado[13], écrit dix ans plus tard (2014), semble confirmer les pires craintes de Germán Gullón :
Cette fin d’époque s’exprime par une série de phénomènes […] : les changements produits dans l’industrie éditoriale […] ; la réduction des coûts et la popularisation des technologies d’écriture et de publication électronique […] ; l’inévitable déstabilisation du texte produite par les nouvelles technologies, qui facilitent le copier-coller jusqu’au point de rendre impossible – et peut-être non nécessaire – d’établir l’auteur du texte ; le passage à une nouvelle conception de la littérature selon laquelle la valeur et l’importance des textes sont subordonnées à l’attention qu’il peuvent susciter […] ; la consécutive uniformisation de la demande et, par conséquent, de l’offre ; l’impossibilité du côté de la critique d’arriver à un accord consensuel sur la notion de valeur en littérature […] (2004: 248-249).
Cependant, même s’ils partagent une vision assez similaire, d’autres auteurs et critiques ont fait une toute autre évaluation de ces bouleversements de l’échiquier littéraire et en ont tiré des conclusions diamétralement opposées (Schaeffer, 2016 : 15). Dans un article très influent, la critique argentine Josefina Ludmer prend acte de la fin de l’autonomie axiologique de la littérature, ce qui rend obsolète les prétentions à une définition de la littérature comme objet de jugement et d’analyse et, par conséquent, de ses hypothétiques valeurs[14]. Pour Ludmer, les notions de « littérature », d’« originalité », de « cohérence », de « style », etc. ne sont plus guère pertinentes. Certes, concède-t-elle, un certain nombre de lecteurs et d’auteurs resteront attachés aux vieilles valeurs et définitions littéraires, mais l’avènement des « littératures post-autonomes » permet de rediriger notre attention critique sur d’autres textes, même ceux qui selon les valeurs traditionnelles sont évidemment mauvais ou ceux qui, parce que considérés comme non littéraires, n’avaient pas jusqu’à présent la dignité d’être d’intérêt[15]. Dans un entretien qui portait comme titre « éloge de la mauvaise littérature », elle explique :
En littérature, je dirais qu’à côté des best-sellers et des écritures qu’on qualifie habituellement de « mauvaises » (et que je ne trouve pas du tout mauvaises), d’aujourd’hui, il existe toujours la bonne et vieille littérature, qui permet une pluralité de lectures. La littérature d’aujourd’hui comprend aussi tout le passé, même celui où elle n’était pas encore « littérature », et elle peut être chronique, lettre, message, dialogue, témoignage.[16]
La similitude des propositions de Ludmer et de celles avancées par Bertrand Mouralis dans les années 70, à travers la notion de « contre-littératures »[17], est remarquable. C’est ce suffixe « contre- » qui relie la démarche de Mouralis non seulement à celle de Ludmer (« pour une mauvaise littérature » − qui, à son tour, peut être reliée à la démarche paradoxale de César Aira : « j’ai toujours milité pour une mauvaise littérature […] jusqu’au fond de la mauvaise littérature pour trouver la bonne[18] »), mais aussi à une des valeurs évoquées plus haut par les éditeurs indépendants, et régulièrement mise en avant : éditer « à contre-courant ». Car, malgré les apparences, cette action « à contre-courant » n’est pas dans les valeurs elles-mêmes, mais dans leur application effective : le fait de publier quelque chose, qui par ce geste acquiert déjà une valeur, implique une nouvelle alliance de valeurs (autonomes ou hétéronomes). Car l’édition indépendante serait le « lieu » où certains objets et valeurs seraient possibles. Que cela ne soit pas possible ailleurs, explique, d’autre part, les invocations à la biblio diversité lors des appels à l’aide ou à la protection publiques.
Il est possible de trouver une autre preuve exemplaire de ceci dans la disparité de la réception critique des œuvres qui relèvent de l’esthétique du plagiat (plagiarismes) ou qui ont été accusées de l’être (Perromat, 2014b). Si l’on prend les cas du roman de Sergio Di Nuccio [Bruno Morales] Bolivia Construcciones (2005), de El hacedor de Borges (remake) de Agustín Fernández Mallo (2010), et de l’affaire autour de El Aleph engordado de Pablo Katchadjian– les premiers retirés du marché par leurs propres maisons d’édition –, nous pouvons constater encore une fois qu’il ne s’agit pas tellement d’opposer des valeurs économiques ou juridiques, ou d’autres valeurs hétéronomes, à des valeurs littéraires.
Conclusion
Nous pouvons conclure que, finalement, ce qui est en question, ce sont des prises de position pratiques, c’est-à-dire idéologiques ou politiques, dans des contextes axiologiques qui permettent plusieurs lectures. Ainsi, Cristina Rivera Garza ou Josefina Ludmer peuvent vanter le caractère démocratique des littératures qui permettent la valorisation de l’appropriation des matériaux et des biens culturels (la « désappropriation » selon les termes de Cristina Rivera Garza, 2013 : 267-288). Alors que pour Patricio Pron (2014 : 18-53) ces trois exemples font partie de « collaborations » (à leur insu) avec les forces qui menacent la survie de la littérature (celle qui vaut réellement).
En somme, l’édition indépendante assumerait, dans le monde hispanique comme ailleurs, sa vocation à la biblio diversité dans la mesure où elle permet l’existence d’œuvres « à contre-courant » : des poétiques et des mises en valeur autres que celles déployées par la « Grande édition » (Gallego Cuiñas, 2022 : 85-86). Elle y accueille des propositions hétérodoxes (contre-canoniques), comme celles exprimées par les auteurs de Escrituras-objeto, qui invitent à réaliser massivement des « interventions » sur des textes préexistants et faire un usage illimité du « copier-coller-supprimer » (Vera Barrós, 2014 : 9-13). L’édition indépendante serait le lieu de revendication des valeurs écartées, non pertinentes, invisibles dans d’autres contextes éditoriaux. L’endroit où il peut être non seulement possible, mais aussi « valable » d’écrire (tout en gardant le copyright de l’édition), comme le fait Washington Cucurto : « Ce que j’écris est à toi / Mais maintenant est à moi / Car je te l’ai volé » (2005 : 9).
Bibliographie
Bertrand Michel, Marin Richard, Métailié Anne-Marie (2013). « Regard d’un éditeur sur la production littéraire latino-américaniste », Caravelle, nº 100 . [URL : http://journals.openedition.org/caravelle/151. Consulté le 15/05/2018].
Calasso Roberto (2014), La marca del editor, trad. E. Dobry et T. Ramírez Vadillo. Barcelone: Anagrama.
Collectif (2005). Los editores independientes del mundo latino y la bibliodiversidad, Guadalajara: AIEI. [URL : https://universoabierto.org/2017/05/15/los-editores-independientes-del-mundo-latino-y-la-bibliodiversidad/. Consulté le 15/05/2018].
Colleu Gilles (2006). Éditeurs indépendants : de l’âge de raison vers l’offensive. Paris: Alliance des éditeurs indépendants.
Cucurto Washington Elphidio (2005). La máquina de hacer paraguayitos, Buenos Aires: Mansalva.
Darrieussecq Marie (2010). Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction, Paris: P.O.L. Folio.
Gallego Cuiñas Ana (2022). Cultura literaria y políticas de mercado. Editoriales, ferias y festivales, Berlin, Boston: De Gruyter.
Gracia Jordi (2012). El intelectual melancólico. Un panfleto. Barcelone: Anagrama.
Gullón Germán (2004). Los mercaderes en el templo de la literatura. Madrid: Caballo de Troya.
Heinich Nathalie, Schaeffer Jean-Marie, Talon Hugon Carole (2014). Par-delà le beau et le laid. Enquêtes sur les valeurs de l’art. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
Heinich Nathalie (2017). Des valeurs. Une approche sociologique. Paris: Gallimard.
Jouve Vincent (2010). La valeur littéraire en question. Paris: L’improviste.
Llovet Jordi (2011). Adiós a la universidad. El eclipse de las Humanidades. Barcelone : Galaxia Gutemberg.
López Winne Hernán, Malumian Víctor (2016). Independientes ¿de qué? Hablan los editores de América Latina. México: FCE.
Ludmer Josefina (2007). "Elogio de la literatura mala", entrevista a Flavia Costa, « Revista Ñ », Clarín, 1er décembre. [URL : http://www.josefinaludmer.net/entrevistas_files/N-2007.pdf . Consulté le 15/05/2018].
Ludmer Josefina (2007). « Literaturas post-autónomas 2.0 » Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura, nº 17, Juillet. [URL : http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/ludmer.htm. Consulté le 15/05/2018)].
Mouralis Bernard (2011). Les contre-littératures [1975], Avant-propos: Anthony Mangeon. Paris: Hermann.
Perromat Kevin (2014a). « Bondades y maldades de la literatura mala. Paradojas de juicios y de valor en la obra de César Aira », Averías literarias. Ensayos críticos obre César Aira. Puebla : Infínita: 37-65.
Perromat Kevin (2014b). « Literatura y plagio en Argentina: formas rentables y no rentables de quebrar los valores del mercado ». Cuadernos del CILHA. vol. 15, n° 2: 88-108. Mendoza : Universidad de Cuyo. [URL : http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/ludmer.htm].
Pron Patricio (2014). El libro tachado. Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura. Madrid: Turner.
Reyes Cano Jesús (2011). « ¿Un nuevo boom latinoamericano?: La explosión de las editoriales cartoneras », Espéculo, nº, 47, , Universidad Complutense de Madrid. [URL : https://webs.ucm.es/info/especulo/numero47/boomlati.html. Consulté le 02/04/2018].
Rivera Garza Cristina (2013). Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación. México D. F : Tusquets.
Sanz Marta (2014). No tan incendiario. Textos políticos que salen del cenáculo. Cáceres: Periférica.
Schaeffer Jean-Marie (2016). Adieu à l'esthétique, Paris, Éditions Mimésis, 95 p.
Schaeffer Jean-Marie (2011). Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature ? Paris : Éditions Thierry Marchaisse.
Schiffrin André (2010). L'argent et les mots, trad. Eric Hazan. Paris : La fabrique.
Schiffrin André (1999). L’édition sans éditeurs, trad. Eric Hazan. Paris: La fabrique.
Tabarovsky Damián (2010). Literatura de izquierda [2004], Cáceres: Periférica.
Vargas Llosa Mario (2012). La civilización del espectáculo. Madrid: Alfaguara.
Vera Barrós Tomás (2014). Escrituras objeto. Antología de literatura experimental. Buenos Aires: Interzona.
Notes de fin
[1] Voir les articles de Jorge Herralde « El editor independiente ante los escritores y el mercado de América Latina » et Beatriz de Moura « El editor independiente como explorador », présents dans le volume collectif publié en 2005 à l’issue de la Ière rencontre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, Los editores independientes del mundo latino y la bibliodiversidad, Guadalajara (Mexique). Disponible en ligne : [https://universoabierto.org/2017/05/15/los-editores-independientes-del-mundo-latino-y-la-bibliodiversidad/], p. 63-69 et p. 45-50 respectivement.
[2] Cette menace se trouve à l’origine du titre L’édition sans éditeurs d’André Schriffin (1999).
[3] Petite écologie des études littéraires. Pourquoi et comment étudier la littérature ? (2011) ; voir le premier chapitre de l’ouvrage « Crise de la littérature ou crise des études littéraires ? » p. 9-15 et p. 36-37.
[4] Patricio Pron (2014 : 177) : « Il ne semble pas difficile de condamner [c]es auteurs […] mais si on le fait, il faudrait aussi condamner un système littéraire qui donne une valeur littéraire spécifique à quelque chose qui n'en a point ».
[5] Voir aussi Gilles Colleu (2006).
[6] Collectif (2005). Los editores independientes del mundo latino y la bibliodiversidad.
[7] Anne-Marie Metailié, « Miradas cruzadas sobre la bibliodiversidad y la edición independiente », (collectif, 2005 : 15).
[8] Voir par exemple l’entretien de Michel Bertrand et Richard Marin avec Anne-Marie Métailié (2013), fondatrice de la prestigieuse maison d’édition Métailié, « Regard d’un éditeur sur la production littéraire latino-américaniste », Caravelle, n°100. Pour d’autres témoignages, voir López Winne et Malunián (2016).
[9] Par-delà le beau et le laid. Enquête sur les valeurs de l’art, titre de l’ouvrage collectif coordonné par N. Heinich, J.-M. Schaeffer et Carole Talon-Hugón (2014) pour envisager les valeurs artistiques en dehors des valeurs esthétiques pures.
[10] Jesús Reyes Cano, « ¿Un nuevo boom latinoamericano?: La explosión de las editoriales cartoneras » (2011).
[11] Par exemple, H. López Winne, A. Manumián, 2016 : 121-124 ; G. Colleu, 2006 : 60.
[12] C’est la thèse centrale de l’essai de Marie Darrieussecq (2010), Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction.
[13] ‘Le livre barré’.
[14] Par exemple, le diagnostic de M. Sanz, (2014 :72), est très proche de celui de Pron, mais la romancière espagnole garde beaucoup de confiance « dans le pouvoir de transformation de la littérature comprise comme un phénomène petit-bourgeois».
[15] « Literaturas post-autónomas 2.0 » Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura, nº 17, Juillet 2007.
[16] Josefina Ludmer « Elogio de la literatura mala », entretien avec F. Costa (01/12/2007), « Revista Ñ », Clarín.]
[17] Les contre-littératures [1975].
[18] K. Perromat, « Bondades y maldades de la literatura mala. Paradojas de juicios y de valor en la obra de César Aira », p. 37-65 ; la citation se trouve p. 52-53.
Pour citer cet article
Kevin Perromat, «« Mauvaise» littérature, œuvres non commerciales et marché éditorial : les marqueurs d’une crise des valeurs multiple », RITA [en ligne], n°15 : décembre 2022, mis en ligne le 02 avril 2023.



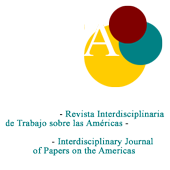
 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8