Perceptions réciproques des inégalités dans le contexte de la grande propriété agricole en Argentine .
Perceptions réciproques des inégalités dans le contexte de la grande propriété agricole en Argentine. L’analyse des phénomènes, des pratiques, des expressions du langage en tant que constructions discursives réciproques, mais bâties à partir de logiques propres, nous parait bon guide pour comprendre comment « fonctionne » la perception qui organise le corps de chacun, sujet social, sujet personnel, et tant les dominés que les dominants...
... Nous analysons d’abord l’occultation de la réalité des rapports sociaux qu’opère pour chacun la présence dans l’imaginaire collectif de la figure légendaire, charnière, du bon gaucho. Puis nous montrons comment à ce récit répond celui des « mauvais gauchos » par lequel s’énonce une autre perception de l’inégalité et des rapports de domination. Enfin nous interrogeons le lien organique de dépendance entre les familles d’estancieros et celles des peones, les deux acteurs principaux des mythes évoqués. Institué symboliquement dans la parole à travers une narration commune qui met en forme la perspective d’un amour impossible, ce lien est toujours prompt à se retourner en violence, fermant ainsi le cercle de la domination et de sa logique perceptive.
Mots clés : Latifundisme ; Gaucho ; Mystification ; Illisibilité.
---------------------------------------------------
Maureen Burnot
Première année de doctorat
Université Lumières Lyon 2
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Perceptions réciproques des inégalités dans le contexte de la grande propriété agricole en Argentine
Introduction
La réalité des inégalités économiques et sociales en Argentine est redoublée et légitimée dans, à travers un système de différenciation culturelle et symbolique, sans cesse à l’œuvre et qui emprunte nombre de ses signifiants au passé colonial. La distinction entre les « autres-internes », selon l’expression de Claudia Briones (1998), pensés et énoncés en tant qu’inférieurs par rapport à un « sujet national érigé comme neutre et non-marqué » (Rodríguez 2005, note 1) réactualise en effet avec insistance de vieilles antinomies, presque mythiques. Récits et représentations toutes prêtes, déjà là : le conte de l’oligarchie blanche et celui de la masse métisse, des portègnes et de ceux de l’intérieur, de la civilisation et de la barbarie (à l’œuvre dans une grande partie de l’Amérique latine, mais omniprésente en Argentine)[1].
La perception de l’inégalité s’inscrit nécessairement dans un rapport dialectique, un rapport intimement noué qui tient les uns et les autres. Si l’Etat et la majorité (selon la définition qu’en donne Colette Guillaumin[2]), ont besoin, pour assurer leur légitimité, de mots et surtout d’une syntaxe, d’une structure d’énonciation pour rendre visibles les inégalités, les groupes dominés (les minorités) ont, quant à eux, un « potentiel de subversion » et de réappropriation de ces « catégories forgées dans le rapport de domination pour en modifier le contenu et les signes» (Martiniello et Simon 1995, 11). Par l’inversion du stigmate, dans un processus que l’on connait bien ici et ailleurs, les groupes minoritaires actualisent en effet de façon concrète la hiérarchisation sociale souvent masquée « derrière l’édifice égalitaire formel » de l’Etat (1995, 13). Ce n’est pas tant ce possible subversif qui nous intéresse mais plutôt le fait qu’il démontre le caractère réciproque, depuis chaque logique d’appropriation, d’un discours partagé d’inégalité. L’essentiel de notre travail sera de repérer les systèmes symboliques élaborés, hérités ou inventés, par les uns et les autres, ensemble, puisque c’est un ensemble qui permet qu’il y ait les uns et les autres, pour dire la structure inégalitaire d’un monde commun.
Les inégalités sont sociales, historiques et de fait objectivables. L’analyse, sociologique économique, politique, permet de repérer les mécanismes objectifs de leur production. Mais elle ne parvient pas à dégager la « réalité organique de la liaison » (Guillaumin 2002, 125) de dépendance entre les individus qui appartiennent à la majorité et ceux qui sont minoritaires. Comment énoncent-ils, pour eux-mêmes, cet état de fait ? La question est loin d’être secondaire si l’on entend que la domination concrète ne peux pas ne pas être en même temps soutenue par une domination symbolique qui elle même doit être « consentie » par les exclus, concrètement et symboliquement. En effet, « si les différences ne sont pas codifiées par un statut symbolique elles passent d’une certaine façon inaperçues et ne donnent lieu ni à une conscience de groupe, ni à la constitution objective du groupe » (Guillaumin 2002, 124). Il y a une correspondance nécessaire entre les structures de pouvoir et les structures mentales, « correspondance qui s’établit par l’intermédiaire de la structure des systèmes symboliques, langue, religion, art, etc. » (Bourdieu 1971, 300) et qui dessine des valeurs communes aux uns et aux autres. Partant de ce principe, nous proposons de décrire certaines des énonciations, des formes discursives, par lesquelles les argentins perçoivent et donnent sens à la réalité sociale.
Ce qui frappe lorsque l’on s’interroge sur la perception des inégalités dans un pays dans lequel plus de la moitié des individus vit en dessous du seuil de pauvreté et qui se pense, « se sent », comme un pays riche, c’est d’abord cette évidence que l’inégalité – si proche de l’injustice – n’est pas perçue avec évidence par la majorité des sujets acteurs de ce régime inégalitaire. La question que cet article se pose est, douloureuse et informulable telle quelle : comment accepte-t-on l’inégalité, c’est-à-dire comment accepte-t-on d’avoir moins que l’autre, et inversement ? Comment un « sujet social », mais aussi intime, c'est-à-dire une personne, formule-t-il pour lui et pour le groupe dans lequel il vit, une inégalité qui est sociale de façon à la réintégrer dans la « nature » devant et dedans lui ?
Le présent article se concentrera sur la province rurale de Corrientes dans le nord-est du pays, et plus particulièrement sur le département de Mercedes. Province d’élevage, latifundiaire, fondée sur un régime de grande propriété et un salariat agricole de « commis de ferme »[3], les peones, qui pour la plupart parlent, en plus de l’espagnol, le guarani, langue que les premiers ne comprennent plus. Ce détail, qui n’en est pas un, pour rendre lisible l’abyme culturel qui borde l’inégalité d’accès au capital.
Nous proposons d’analyser les constructions discursives qui participent à l’acceptation de l’inégalité, qui permettent de ramener la situation d’inégalité à un ordre naturel. Parmi ces possibilités, discursives, mais produisant des réalités sociales, la narration de mythes constitue un des mécanismes clé de la production et du partage des catégories de perceptions du réel. Nous analyserons d’abord le mythe du bon gaucho en tant qu’il permet aux dominants de passer sous silence une partie de la réalité des conditions de vie servile des peones. A ce mythe hégémonique nous ferons répondre celui des gauchos malos, raconté cette fois par les populations dominées, il constitue à partir de la même figure un mode de réappropriation transgresseur et propose une nouvelle perception de l’inégalité. Ces narrations, bâties à partir de logiques perceptives propres, sont réciproques et complémentaires. Nous montrerons, pour finir, que l’on retrouve cette même solidarité de logiques perceptives dans les rapports sociaux effectifs entre les estancieros et les peones.
I. La folklorisation du gaucho : déplacement de la question des rapports de production
A. « El Mencho este prestigioso peon de Mercedes »
« La légitimation suprême qu’est la « naturalisation » » (Bourdieu 1971, 328) est un recours narratif couramment employé par les propriétaires terriens de Mercedes pour justifier les conditions de vie des travailleurs ruraux qu’ils emploient. Par la transformation de valeurs qui sont le produit de la domination en valeurs naturelles, biologiques ou culturelles, le discours hégémonique fait de l’inégalité sociale une conséquence « logique » d’une inégalité de nature. Prenons quelques exemples des procédés rhétoriques, qui sont en même temps des instruments d’auto-défense, par lesquels les estancieros légitiment et consolident, pour eux-mêmes et pour les autres, leur position de domination. Le peon d’estancia apparait comme faisant partie d’un groupe homogène dont les qualités essentielles sont bien connues des estancieros. Dans leurs discours, ils s’emploient à apposer un certain nombre d’étiquettes sous le générique « peon », jusqu’à en faire un sujet, doué de qualités et de défauts, lié à des événements et entretenant certains rapports à d’autres groupes sociaux. On veille à bien signifier, avec une énergie dithyrambique, que ce sujet existe ; la quantité d’attributs qui lui sont associés démontre bien qu’il existe. Et dans ce grand tout attirant, les acteurs disparaissent. Ils n’agissent pas mais subissent le poids d’un substrat qui les dépasse. Individuellement et collectivement.
Le refrain familier célèbre tour à tour l’authenticité, l’esprit de sacrifice, la fidélité aux traditions, la sagesse, la gentillesse du peon. Les estancieros, qui ont toujours quelque chose à dire sur la nature du peon, racontent aussi que derrière ces qualités remarquables se cache un homme capable d’une brutalité animale, qu’il s’agira donc pour eux de dompter avec ruse. La logique perceptive binaire « ou le sauvage est une brute, et il faut lui apprendre à danser, ou c’est lui le maître parce qu’il détient la vérité que « nous » avons perdue » (Bazin 2008, 75), produit un même effet, celui de faire sortir le peon de l’histoire et justifier ainsi la spoliation dont il est victime.
Au cours d’une conversation personnelle, monsieur F., éleveur propriétaire de 2000 hectares dans le département de Mercedes me parle du peon rural :
« En Corrientes tenemos la suerte de tener a esa gente tan especial, que no la hay en otras provincias, esa gente no tiene que desaparecer porque es única, es autentica. Mira, el gaucho, el peón rural, es un hombre trabajador, respetuoso, servicial, un hombre muy solitario también. Vos sabes que antes del ochenta no se pagaba sueldo a los peones, trabajaban por techo y comida nomas. El peón no tiene la misma idea de lo económico, no trabaja para la plata, no es capitalista, no tiene esa mentalidad, esta mas allá de eso, se conforma con muy poco, es impresionante»[4].
A travers cette description de l’existence authentique de cet homme qui ne semble pas connaitre de nécessité matérielle et être au-delà des rapports sociaux de pouvoir quel autre soucis anime monsieur F. sinon celui de s’abriter sous la transcendance d’une essence divine de la réalité ? Le commentaire en effet permet de dire, en filigrane, que Monsieur F. n’est pas responsable des conditions de vie des ses employés, que sa domination en somme n’en est pas une. Comme le souligne Maurice Godelier, c’est « pour des raisons sociales que le social se dérobe à lui-même, s’opacifie, se sacralise » (1996, 241), et, continue-t-il, «ce n’est pas la Société qui dérobe aux hommes quelque chose d’elle-même, ce sont les hommes réels qui se dérobent entre eux quelque chose de leurs rapports sociaux » (242). La société, les hommes, pour se produire et se reproduire à besoin de voiler la responsabilité qu’elle a à l’origine d’elle-même.
La province de Corrientes est connue par ses voisines pour être, politiquement et idéologiquement, particulièrement conservatrice et traditionnaliste. Dans les cercles de la Sociedad Rural[5], le discours régionaliste, anti-urbain et anti-internationaliste, s’est développé tout au long du 20e siècle. Corrientes serait une province à part, la « patria chica » ou encore la « republica independiente » comme il est d’usage de la désigner, dont une des caractéristiques est d’avoir su conserver le gaucho authentique, fidèle à ses traditions. Dans le nouveau « Centre d’interprétation de Mercedes », consacré à la valorisation de la culture du campo, un panneau sur l’habit traditionnel du paysan de Corrientes note ceci : « el Mencho este prestigioso peon de Mercedes, famoso, por manejar con destreza muchos de los oficios de campo ». Etonnante pirouette muséographique que celle de réunir le terme mencho (qui vient de « mensual »), dont la connotation péjorative nous a été confirmée à plusieurs reprises, et celui de « prestigieux ». Le musée se garde bien d’expliquer aux touristes les conditions de travail de l’employé rural. Ce regard exotique, car tout homme à force d’expérimenter son métier devient expert et habile et qu’il faut un regard étranger, extérieur, pour le souligner et s’en étonner, n’est pas seulement celui que l’on présente aux touristes du musée ou à ceux des estancias. C’est aussi le regard que portent de nombreux patrons sur leurs employés, comme le commentaire de monsieur F. l’indique clairement. Une anecdote rapportée par monsieur R., maquiniste dans une estancia de plus de 80 000 hectares, aidera encore à saisir la perception qu’ont les estancieros des gauchos. Un jour qu’un groupe d’australiens éleveurs de bétail venait visiter l’estancia, le patron a fait préparer un plat de mbaipy[6] pour montrer à ses amis ce que les peones mangent le matin. Sauf que cela fait bien longtemps qu’on ne mange plus de mbaipy au petit déjeuner, comme me l’explique non sans ironie monsieur R. : « a la mañana tomamos maté, o galletitas con café con leche, depende de lo que te dan, hay unos que son muy agarrados y no te dan nada. Pero el mbaipy hace mucho tiempo que no se come mas[7] ». Imaginer une telle mise en scène, falsifier la réalité pour que cela « fasse plus vrai », en dit long sur la perception qu’ont les patrons de leurs employés, simples marionnettes qui s’agitent comme par magie pour le bonheur de quelques spectateurs privilégiés, qui prendront cette scène inventée pour le réel. Il faut traiter cette anecdote comme un récit, « un acte, une intervention dans le monde social, où se nouent des espoirs, des ambitions, des règlements de compte » (Bensa 2006, 131). Comme dans le musée de Mercedes, le travail intellectuel du narrateur consiste à classer les peones, à les distinguer, à les rendre étrangers en leur attribuant des coutumes présentées comme archaïques. Les histoires racontées par les estancieros sur leurs employés sont des narrations qui visent à légitimer la hiérarchie propre au régime de propriété foncière dont ils sont acteurs. Récits qui permettent au narrateur de se situer dans un contexte historique et sociologique particulier, de justifier et de reconquérir sans cesse sa position de domination. Il s’agit d’un jeu politique, dire que le peon « no trabaja para la plata », permet de contrer une éventuelle revendication de sa part. Raconter que le peon « no tiene muchas necesidades » permet de se persuader que le peu de confort qu’on lui donne n’est pas une contrainte pour lui, qu’au contraire c’est respecter sa façon d’être, c’est montrer qu’on le connait bien. Non seulement ces récits rendent opaques les relations de pouvoir mais encore ils permettent aux estancieros de s’attribuer la conservation d’une culture « unique » et « authentique ». Monsieur D. reconnait, non sans une certaine gêne, que « la vida del peon es una vida sacrificada », mais sa gène semble immédiatement soulagée par cette autre idée que ce sacrifice est consenti librement et que les fruits qu’en retire le peon n’ont pas de prix : « Creo que son mas felices que nosotros, porqué no son atados al material, porqué tienen una relacion muy estrecha con la naturaleza ».
Ces narrations que les estancieros tissent entre eux et se répètent pour eux-mêmes participent d’une réflexion sociologique élaborée collectivement, par différentes personnes, au gré de la consolidation du modèle économique de l’exploitation latifundiste des terres nationales. On ne comprendra pas comment de telles affirmations essentialistes fonctionnent aujourd’hui sans montrer qu’elles ont été construites dans le temps, sédimentées au moyen d’un travail continuel de transmutation d’un signe, le gaucho, en fonction des intérêts de la domination. Ces narrations locales et individuelles s’appuient sur un système de représentation symbolique et imaginaire de l’ensemble social argentin dont nous souhaitons à présent détailler l’élaboration.
B. Histoire d’un nom
Comme le remarque très justement Ana Penchaszadeh, le paradoxe du cas argentin, et qui le rend particulièrement intéressant, est que la constitution de l’unité nationale s’est présentée, aux 19e et 20e siècles, en « ôtant la légitimité des éléments internes et en pariant sur la constitution du dedans à partir du dehors » (Penchaszadeh 2004, 2). L’idéologie de la blancheur, concomitante à celle de la négation de la présence indienne, a été le référent central de la constitution de l’identité nationale[8]. C’est juste sauf que la suture pour se faire s’est doublée, se double, de la mythologie du gaucho, « homme d’ici » (Garavaglia 2003, 149), homme du dedans, ni vraiment espagnol ni tout à fait indien, mais érigé en ancêtre primitif du peuple argentin. La littérature gauchesque de la fin du 19e siècle[9] a popularisé le gaucho comme symbole de liberté, masquant ainsi les conditions sociales misérables et archaïques des travailleurs ruraux. L’art, la littérature, le folklore ont poétisé le logement misérable du gaucho, son habit, sa diète alimentaire monotone et carnivore, en faisant très rarement référence à ses conditions sociales d’existence. La mythification du gaucho, récit national, énonce, de façon multiforme et donc insaisissable, une différence, un particularisme, qui renvoie implicitement à ce qui est au contraire général et indifférencié et qui constitue le majoritaire. Le gaucho, objet totémique du folklore national, vendu aujourd’hui dans les boutiques touristiques de Buenos Aires, libéré du matériel et menant sur son cheval une vie spirituelle intense, se présente à la fois comme celui qui n’est pas le même que soi et comme idéal de soi. Ethnicisé, le gaucho est le symbole de l’altérité en même temps que celui d’un passé héroïque. Martin Fierro est l’acteur de la guerre de frontière, victorieux de la présence indienne, c’est lui qui engage symboliquement le nouveau destin de la nation argentine, au moment où les premiers vapeurs débarquent les immigrants européens dans le port de Buenos Aires. Acteur du 19e siècle, de l’histoire antérieure à ce que nous appelons la seconde fondation du pays (à partir des premières vagues de migrations européennes dans les années 1880-1890), le rôle et l’importance du gaucho a été, et est toujours, largement exagéré. Les travaux récents de Juan-Carlos Garavaglia (2000), démentant l’idée partagée de la présence abondante de gauchos dans la plaine argentine, ont prouvé, non sans susciter l’incrédulité de nombreux historiens argentins, l’existence d’unités familiales considérables de petits producteurs dans la pampa, les gauchos ne représentant plus qu’une part négligeable de la population totale. Le gaucho, cet homme errant et solitaire, a été extrait de l’histoire nationale, occultant toute une partie de celle-ci, pour devenir un personnage aux vertus essentiellement positives. Le gaucho suscite l’admiration et plusieurs des expressions courantes du parler argentin le rappellent. L’expression par exemple faire une gauchada désigne un geste désintéressé, quelque chose comme « un coup de main », une faveur donnée généreusement, de façon gratuite. Elle parle en outre d’une façon d’être, de faire, propre aux gens de l’intérieur, aux habitants de la campagne, par opposition à ceux de la ville. De même on dira, pour souligner les qualités humaines remarquables d’un ami « que gaucho que sos ».
Ce sens injecté dans les catégories de pensées collectives, dans le parler quotidien, qui pourra désormais ne pas penser que le gaucho est un homme serviable, par nature ? Pour monsieur F., l’explication est simple, ces expressions viennent du fait que « el peon, el gaucho, es un hombre muy serviable ». Comme l’explique Jean Bazin, « pour que le nom accède à son statut ethnologique (…), il faut lui retrancher du sens, l’appauvrir de son ambiguïté par des opérations de prélèvements, de sélection, de censure qui lui confèrent l’univocité » (2008, 131). Une des étapes de l’invention du groupe et de son essence consiste à neutraliser les connotations négatives attachées au nom qui le désigne, car, « comment une ethnie pourrait-elle être objectivement désignée par un terme méprisant ! » (137). C’est bien ce travail qui a été opéré sur le terme gaucho, employé aujourd’hui pour désigner des vertus essentiellement positives, il était tout au long du 19e siècle très péjoratif. Selon Rodriguez Molas (1982), le terme gaucho est apparu pour la première fois dans la Bande Orientale en 1771 où il était associé à des groupes d’individus insoumis poursuivis par les autorités. Il désignait les habitants pauvres de la campagne, brigands, métis, sans foi ni loi et représentant un frein à l’entreprise colonial. Cette acceptation du terme sera celle en vigueur tout au long du 19e siècle, les gauchos apparaissant comme des individus dangereux, superstitieux, qui s’adonnent à des beuveries et à toutes sortes de jeux que les autorités se donnent pour tâche de contrôler strictement. Intégré à l’estancia à mesure que se consolide l’économie d’élevage latifundiste, le gaucho, le peon, apparaitra longtemps comme un personnage néfaste requérant une attention savamment élaborée. Ce n’est donc que tardivement, avec la naissance de la littérature gauchesque dans les années 1870, que débute la folklorisation du gaucho, lent processus qui fera disparaitre derrière les atours d’un archaïsme énoncé avec exotisme les conditions de vie contemporaines, et même jusqu’à l’existence, des travailleurs ruraux, gauchos enfermés[10] dans les estancias.
Dans quelle mesure peut-on tenir le sens actuel du terme gaucho comme pur de cette connotation négative historique ? Ceux qui sont aujourd’hui désignés sous ce terme, sont-ils dupes de l’opération de « nettoyage » qui a transformé le terme désobligeant en « nom propre » (Bazin) ? La mémoire qui est faite d’un autre type de gauchos, les « mauvais gauchos », semble signifier le contraire.
II. Le mauvais gaucho, entre transgression et fatalisme
A. Réappropriation de la figure volée du gaucho
Aux récits idéalistes du bon gaucho s’interposent en effet les nombreuses légendes de gauchos malos, personnages historiques élevés au rang de héros populaires : des gauchos errants, ayant refusé l’autorité d’un patron ou d’un commandant militaire, qui volent aux riches pour distribuer aux pauvres et qui pour certains ont des pouvoirs de guérisons. Des paysans qui ont décidé d’entrer dans l’illégalité par conviction morale, idéologique, pour lutter contre l’inégalité et l’injustice. Le gaucho Lega, le gaucho Alparicio Altamirano, le gaucho Curuzu, le gaucho San Antonio, le gaucho Gil, tous sont originaires de la province de Corrientes et ont vécu au 19e siècle, lors des guerres de civiles qui ensanglantèrent le pays. Leur mémoire est rappelée par des offrandes, des prières et des pèlerinages au lieu de leur sépulture. Depuis une vingtaine d’années le culte d’un de ces gauchos s’est diffusé à l’ensemble du territoire argentin comme cela avait été le cas pour la Difunta Correa, une autre « sainte populaire » originaire de la province de San Juan. Sur toutes les routes du pays, des fidèles anonymes érigent, avec des matériaux de mauvaise qualité, des petits autels rouges en honneur au Gaucho de Corrientes. Le voyageur y laisse toute sorte d’offrandes : bougies, nourriture, vin, argent, plaque d’immatriculation, objets de consommation courante. Le 8 janvier, jour anniversaire de la mort d’Antonio Gil des milliers de fidèles se rendent en pèlerinage au sanctuaire de Mercedes, à huit kilomètres de la ville, à l’endroit où le santito a été égorgé.
L’histoire raconte qu’Antonio Mamerto Gil Nuñez, peon d’estancia, a été exécuté après avoir déserté des rangs de l’armée des fédéraux lors de guerres civiles qui agitèrent la province dans les années 1870, refusant de combattre contre ses frères. Au cours de son année de désertion, avec deux autres compagnons, il volait du bétail aux riches estancieros et répartissaient le butin aux habitants pauvres. Avant d’être exécuté, Antonio Gil avait prévenu son bourreau qu’il trouverait son enfant malade à son retour et qu’il guérirait s’il l’invoquait. Le bourreau après avoir égorgé Gil pendu par les pieds à un arbre, a effectivement retrouvé son fils agonisant. Il est retourné à l’endroit du meurtre et a offert une sépulture chrétienne à Antonio Gil. Son enfant a immédiatement guérit, c’était le premier miracle du Gauchito.
Le culte populaire au Gauchito Gil constitue une contre-production symbolique énoncée de façon multiforme et provocante pour le « sens commun ». Si le « saint des pauvres », comme il est souvent désigné dans les articles de presse, est aujourd’hui vénéré par des familles appartenant aux classes moyennes-basses urbaines (phénomène qui doit être relié à l’émergence des « nouveaux pauvres » depuis les années 1990), il était longtemps resté cantonné aux limites de la province de Corrientes et à ses populations paysannes. Le récit de la légende, puisqu’il « transgresse les limites entre les riches et les pauvres, les humbles et les puissants » (Carozzi 2006), rend visible, fait percevoir, la hiérarchisation historique des rapports sociaux. Non seulement les nombreux autels du Gauchito Gil sur le bord des routes du pays rendent visibles les classes populaires, au cœur de la géographie nationale, mais encore la légende du saint est un moyen d’écrire et de transmettre une mémoire collective qui a été censurée, oubliée (celle de l’enrôlement forcé lors des guerres civiles du 19e siècle), à partir d’une existence singulière (quand l’histoire officielle a toujours écrit le peuple comme une masse indifférenciée, sans subjectivité). On est loin de l’image du gaucho mythique que nous évoquions plus haut, habitant mystérieux des plaines argentines, sans attache, sans histoire personnelle, sans contradictions ni angoisses. La légende d’Antonio Gil reconstitue au contraire sa généalogie, explique ses échecs amoureux avec la fille de l’estanciero pour lequel il travaillait, raconte comment l’armée l’a enrôlé de force, comment il a du voler pour survivre au cours de sa désertion. La narration fait des vaincus, les vainqueurs, mais aussi des « hors-la-loi », les justes. La morale que sous-tend le culte à ces « mauvais gauchos » manifeste, comme le remarque Anthony Pecqueux à propos d’autres pratiques signifiantes des cultures dominées en France, « une attitude spécifique à l’égard d’actes ou de pensées généralement moralement sanctionnés, faite d’empathie et de non-jugement. Cela recouvre l’absence d’émotion morale perçue comme offense. Ainsi commence à se dessiner un Nous qui comprend, non tant par idéologie que par amour, les personnes incarcérées ou celles conduites à perpétrer des actes illégaux » (Pecqueux 2003, 225). C’est d’ailleurs cet aspect de la légende, le fait que le Gaucho Gil soit aussi un voleur, qui décide certains à s’écarter du culte. Madame F. par exemple, épouse d’un producteur de Mercedes, trouve inacceptable que l’on rende un culte à un gaucho « que no era otra cosa que un cuatrerista »[11]. Deux trajets énonciatifs imperméables s’affrontent, qui persistent dans deux perceptions de la situation de l’inégalité opposées : pour les uns l’illégalité est un recours compréhensible pour échapper à la situation injuste de l’inégalité, pour les autres l’illégalité se borne à un principe atavique de certaines classes sociales et doit être réprimée.

Image 1. Autel au Gauchito Gil, Plaza de los Andes, Buenos Aires (photo de l’auteur).

Image 2. Sanctuaire du Gauchito Gil, Mercedes (photo de l’auteur).
Les légendes des gauchos malos et la vivacité du culte qui leur est rendu constituent des prises de risques pour ré-écrire l’histoire, comme l’écrit Alban Bensa, « dire un récit, c’est prendre un risque, le risque de susciter la colère ou la jalousie d’autrui » (131). Même si c’est plutôt par « amour » que par « idéologie » que les fidèles se reconnaissent dans le personnage du Gauchito Gil, la narration de son épopée personnelle tragique ouvre dans le débat public une autre perception de la situation sociale historique du gaucho. Le récit donne à voir et à penser les inégalités sociales.
Pourtant les pratiques qui lui sont liées manifestent une perception de la misère comme relevant d’une fatalité de laquelle on ne réchappe qu’à la merci d’une faveur divine. Parmi les « demandes » que les fidèles adressent au Gauchito Gil la plupart sont en effet liées à des problèmes de « dettes », de « chômage », de « prison », de « maladie ». On attend du saint la résolution d’angoisses générées par le manque du à la situation sociale : à la précarité, à la pauvreté, à l’exclusion. La situation d’inégalité – d’accès au capital économique, d’accès aux biens, aux soins - est ainsi interprétée comme un état naturel appelant une réponse qui ne peut-être que surnaturelle. Si le récit de vie du Gaucho Gil contient un potentiel subversif certain puisqu’il dit par l’événement de la désertion le réel de l’autorité et de l’arbitraire des rapports sociaux, il dissimule à la fois par le recours à l’imaginaire la réalité et le contenu des ces rapports. Parmi les systèmes symboliques exprimant et légitimant l’inégalité des rapports sociaux, la religion joue naturellement un rôle majeur et la tolérance, récente, de l’église officielle à l’égard du culte au Gauchito Gil trouve sans doute son fondement dans cette évidence. C’est là tout l’équivoque du symbole qui s’annonce comme particulièrement transgresseur mais induit, finalement, une perception fataliste du réel. Et qui, de surcroît, va devenir un prétexte pour que les classes dominantes affirment à nouveau la différence positive que les distingue des classes populaires.
B. Un goût qui dégoûte
Le culte au Gauchito Gil est un objet enjeu d’autres choses que lui-même. Un objet autour duquel s’énoncent les rapports sociaux, leur donne une forme visible et de ce fait suscite des prises de position à propos d’autre chose que la croyance religieuse. « Aller au Gaucho » (au sanctuaire) ne va pas de soi pour certains habitants de Mercedes. Certaines personnes expriment clairement que le Gaucho n’a rien à voir avec un saint, qu’il s’agit d’un culte païen à situer en dehors de l’Eglise catholique. C’était l’opinion la plus partagée il y a encore trente ans, avant que le culte ne se massifie. Monsieur D., dont la famille est propriétaire de quatre estancias dans le département de Mercedes, d’une autre dans la province voisine d’Entre Rios, d’une ligne de magasins spécialisé dans la vente de produits de cuir, et qui occupe depuis quatre ans la fonction de vice-président de la Société Rurale de Mercedes, m’explique ainsi : « Antiguamente, trenta años atras, yo recuerdo, los que veneraban al Gauchito Gil no era la gente decente, era la gente mas humilde. Hablar del Gauchito Gil en la sociedad urbana, en la iglesia principal de la ciudad era una mala palabra »[12].
Que ce commentaire soit un souvenir, préambule à la constatation que depuis les choses ont changé, importe peu. Ce qu’il faut souligner ce sont les catégories de pensée, qui sont d’abord des mots, utilisés par celui qui parle pour décrire une réalité. L’opposition entre les gens « décents » et les « humbles » vient recouvrir en même temps celle de la ville, de sa place centrale et de la campagne. Ce qui est dit ce sont des positions dans l’espace, par rapport auxquelles celui qui parle se situe : en haut, en bas, au centre, à la périphérie. Les pauvres sont à la périphérie, les riches au centre. Ces places géométriques sont doublées de jugements moraux : ceux du centre et du haut sont « décents », ceux de la marge et du bas, sont « indécents », au point qu’il ne faut pas en parler. Si depuis quelques années une messe est donnée par le curé de Mercedes en honneur au Gauchito le 8 janvier, la fracture pourtant n’a pas disparu. Le culte suscite quelque chose comme de la terreur et du dégoût, réaction symptomatique d’une impossibilité du « partage du sensible », selon l’expression de Jacques Rancière (2000). Madame F. lorsqu’elle m’avait conduit au sanctuaire le 8 janvier, n’avait pas voulu sortir de la voiture. La construction de la perception sociale des inégalités est liée au partage ou non de certaines expériences sensibles, matérielles. Les habitus construisent des jugements et des sentiments, des goûts incompatibles. Comme le souligne Capucine Boidin reprenant le théorème de Thomas, « ce que les hommes pensent être réel est réel dans ses conséquences ». Il existe des lignes de démarcations entre les groupes qui, « pour construites et artificielles qu’elles soient, engendrent des différences relatives qui finissent par avoir des effets bien réels » (Boidin 2004, 44). On ne mange pas la même chose selon qu’on habite à la marge ou au centre, on ne vibre pas sur la même musique, et pourtant on vibre bien des deux côtés. L’autre n’est pas d’abord perçu comme inférieur par ce qu’il pense, ce qu’il dit, ce qu’il rêve, puisque cela demeure ingénieusement caché, mais par ce qu’il mange, sent, touche, boit. Cette différence de traitement du corps, de l’un et de l’autre côté de la barrière, fini par aveugler. Il arrive un moment où l’autre se dérobe, soudainement, « les choses connues deviennent comme indépendantes de nous, inertes et lointaines malgré leur proximité » (Saer 1987, 152). L’impression se donne, douloureuse dans son évidence, d’un impossible partage. Les contes diffusés par l’oligarchie politique, sur la civilisation et la barbarie, jouent bien sûr un rôle clé dans l’intériorisation d’un fondement « naturel » de l’inégalité. Mais de façon plus aigüe encore, ce sont les habitudes prises et apprises dès l’enfance, ressenties et énoncées comme la vérité du monde, comme les façons normales de faire, qui viennent a contrario naturaliser, toujours négativement, les modes de l’autre. L’autre, celui qui est inégal, tient son corps d’une certaine façon, et cette façon apparait comme un effet de sa nature, pensée comme indépassable, et qui légitime à la fin sa position dans l’échelle sociale.
Avec sa diffusion dans le grand Buenos Aires, le culte au Gaucho Gil est associé par le discours dominant à la délinquance et à la drogue, au monde de la cumbia et du bidonville. Aux abords d’un autel en honneur au santito en plein cœur de Buenos Aires j’interroge un couple habitant du quartier, feignant de ne rien savoir sur le Gauchito:
MB : Bonjour, dites-moi, c’est quoi ce qu’il y a sur le talus à l’angle ?
P : Ah non ça c’est rien, non, non, c’est rien.
MB : Comment ça rien ?
P : C’est des gens qui vivent là-bas, de l’autre côté, des noirs ( negros )[13] c’est parce qu’ils vivent là ils font ça pour essayer d’avoir de l’argent, qu’est-ce que tu veux y faire.
A : Un jeune a été tué par ici il y a quelques mois c’est pour ça, c’est pour ça qu’ils ont mis ça, c’est pour l’argent.
P : Ils habitent là-bas » dit-il en montrant l’autre côté de la voie ferrée.
L’exclusion est ici plus que manifeste. Ce sont des « choses de noirs », c’est-à-dire « rien », le fait de personnes qui habitent dans un autre espace, « là-bas », derrière la frontière symbolique que représente la voie ferrée.
Race, ethnie, classe, genre ne sont pas des catégories suffisantes pour comprendre la perception qu’ont les classes dominantes sur les dominés. Ce qui distingue semble bien plutôt être certains gestes, des détails vestimentaires, des images traversées par l’ethnie, la classe et le genre, qui pour les uns sont perçus comme « inférieures », « sales », « de mauvais goût ». Les images qui sont liées au culte au Gauchito, la musique qui l’accompagne, les odeurs qu’il suggère « dégoûtent » littéralement ceux qui l’observent de loin. La distinction est d’abord une affaire de différences de « goût » au sens bourdieusien du terme. Les habitus qui construisent les corps et leurs mouvements, construisent aussi des humeurs et des sentiments, des jugements, non seulement dans la différence exotique d’un « primitif » australien et d’un sociologue, mais aussi, et donc au centre de notre propos, entre celui qui emporte chez lui en sa maison, la « mauvaise » statue de plâtre du Gauchito Gil et celui qui avec dégout, tourne ailleurs son regard. Et ne peux pas faire autrement. Cette impossibilité, conséquence des conditions de vie, est perçue comme un choix autant que comme une contrainte.
Tenir son rang, rendre visible les différences sociales, selon l’exigence déjà soulignée de les réintégrer dans la nature, est un effort couteux. L’anthropologie ne peut se satisfaire de les analyser comme de simples lois sociales auxquelles obéissent et se conforment les individus. Les pratiques sont traversées, soutenues, mues par des expressions d’affectivité, « l’économie générale des pratiques, comme le suggère Alban Bensa, débouche sur une économie des passions » (2006, 237). L’intériorisation de la perception de l’infériorité ou de la supériorité « naturelle » de l’autre est à l’aboutissement d’un intense travail des sentiments. Nous souhaitons à présent nous rapprocher du monde partagé de l’estancia, interroger la logique affective qui accompagne la relation personnelle entre les estancieros et les peones.
IV. Histoires de familles, entre passions et crimes
A. Amour impossible
La perception qu’ont les estancieros des peones est traversée par l’image mythique du bon gaucho, celle des peones est modelée par celle d’un gaucho rebelle, victime d’un système injuste. Ces récits contradictoires manifestent des logiques perceptives en accord avec un statut social déterminé. Qu’en est-il de ces logiques au moment de la relation personnelle entre les deux acteurs clés des mythes évoqués ?
La relation entre le patron et sa famille et les employés est difficile à saisir, elle est pourtant fondamentale pour comprendre comment les sujets qui y sont pris, en légitime le caractère inégalitaire. Le lien entre les uns et les autres, intime et intérieur à chacun, est énoncé à travers des propos ambivalents et contradictoires dans un double régime d’énonciation d’amour et de haine. Dans l’estancia, c’est l’espace privé qui est ouvert à l’autre, quelque chose donc de la sphère de l’intime, et tous, chacun, sont tiraillés entre connaissance et méconnaissance, inégale familiarité.
La structure sociale de l’estancia induit un certain rapport à l’autre, elle dessine des sentiments, elle introduit des liens affectifs dans le rapport de domination/subordination. Monsieur L. me dit ainsi au cours d’une conversation qu’il considère que ses peones « son parte de la familia ». Il poursuit et me confie, sur le ton de l’aveu, qu’il aimerait être un grand estanciero à l’exemple de Juan Ansola, « no por la plata sino para tener muchos empleados y moverme entre ellos ». Rêve de père, à l’origine d’une large progéniture, qu’il faudra éduquer, aimer, jusqu’à se faire aimer. Juan Ansola, mercedeño né en 1914 et propriétaire de nombreuses estancias dans la province de Corrientes, constitue un modèle d’exemplarité du « bon patron » pour la plupart des estancieros de Mercedes. Le livre Che Patron qui retrace sa vie ne manque dans aucune des bibliothèques des propriétaires terriens du département. Plusieurs anecdotes rendent compte de l’intimité du lien entre les peones et la famille propriétaire, de l’amour passion qu’ils se portent mutuellement. Toutes les fois où les employés d’Ansola lui ont signifié leur profonde gratitude sont rapportées avec emphase. Ainsi ce peon qui un jour le salua et lui dit : « - Yo te saludo a vos, patrón, no por tu plata – porqué ellos lo hacen a uno más rico que lo que es – sino por vos, por lo que vales vos… ».
Le lien de dépendance sociale qui unit les employés à leur patron produit chez les premiers des principes de perceptions, des façons de regarder, qui collaborent à leur propre domination. L’affection que certains peones portent à leur patron est si puissante qu’elle détruit parfois leurs propres liens de famille. M. âgé de trente cinq ans et peon depuis plus de quinze ans, me raconte, en les déplorant, les comportements de certains de ses collègues : « quand j’étais dans l’estancia de L, il y’en avait, un vieux, qui ne touchait même pas sa pension. C’est le majordome qui la recevait et ne la lui demandait pas. Il était retraité mais il préférait rester à l’estancia, il n’avait plus de contact avec sa propre famille ». Il poursuit en me parlant du capataz de l’estancia dans laquelle il travaille actuellement : « la femme du capataz, Maria, dit toujours que son mari aime plus son patron qu’elle, et je t’assure que c’est l’impression qu’il donne. Y’en a qui sont prêts à tout pour leur patron. Moi j’essaie de faire le travail qu’on me demande et quand ça ne me va pas je m’en vais. ». Le patron, pour certains, est perçu comme un père, comme celui a qui l’on doit la vie, sans lequel tout s’écroule. Ce don de soi à l’autre est rendu possible par une série de stratégies dont Ansola fait l’inventaire dans son livre. Il faut savoir par exemple faire des cadeaux à ses employés, parmi ceux-ci le fait de ne pas décompter la nourriture du salaire, acte dont la valeur symbolique est évidente, et que plusieurs estancieros ont pris le soin de me commenter.
Il y a une continuité entre le patron, l’estancia et ses employés. Non pas forcément une continuité dans le temps qui voudraient que les employés soient particulièrement fidèles à leurs patrons mais une continuité de nature. Ils font partie de la même branche, ils sont dans un même bateau, si dépendants l’un de l’autre. L’intelligence du lien paternaliste travaille à signifier, dans le langage des actes et des façons d’être, une identité de nature entre les deux groupes. Le secret, qu’avait si bien intériorisé Juan Ansola, s’est d’être plus gaucho que le gaucho. Monsieur L. me raconte cette anecdote qui circule de bouche en bouche : un jour des éleveurs de Buenos Aires sont venus pour acheter 7000 têtes de bétail à don Ansola. A l’homme qui leur a ouvert le portail, ils ont donné un pourboire, avant de se rendre compte qu’ils avaient à faire à don Ansola en personne. « Il s’habillait comme un gaucho, souvent il était même pieds nus ». Comme un paon qui fait la roue, le vrai patron est celui qui suscite l’admiration des ses peones parce qu’il rivalise avec eux sur le même terrain. « Si tu sais monter à cheval, continue monsieur L., si tu sais retourner un veau dans l’enclos, tu seras respecté. Si tu sais faire ce qu’ils sont capables de faire, ils t’accorderont l’autorité, c’est ça le secret ». Donner l’illusion donc d’être avec eux sur un plan d’égalité, s’habiller pour le patron, à la mode gauchesque, tout en signifiant, quelque part, qu’il y a une barrière infranchissable. L’écart différentiel (Boidin 2004) perçu entre la famille propriétaire et les employés varie selon les circonstances sans jamais pouvoir être dépassé, oublié absolument. La ligne de démarcation qui sépare les deux groupes est un fossé, que la cohabitation dans l’espace restreint, confiné, isolé-désolé de l’estancia, ne peut pas remplir puisque c’est justement ce creux qui assure la stabilité des deux rives. C’est la tension d’être au-dessus du fossé ensemble, tenus par « ce qui a toujours été » qui assure, plus que n’importe quoi la pérennité de la structure. Ils s’aiment littéralement d’un impossible amour qui les fait tenir les uns avec les autres. Chacun sait cette loi, que d’ailleurs énonce un des épisodes de la légende du Gauchito Gil qui raconte comment Antonio Gil a du renoncer à l’amour, réciproque, qu’il portait à la fille de son patron.
L’inégalité économique, sociale, culturelle entre les deux types de familles a quelque chose d’abyssale. Les uns ont reçu l’éducation de l’école, ils ont une vision du monde occidentale, les autres ne savent pas vraiment écrire, ni situer la France - puisque c’est l’exemple qui nous concerna -, dans le monde. La question des ressources intellectuelles de chacun est un enjeu de force pour la légitimation des statuts sociaux. Monsieur J., président de la Rural, suscite l’admiration de son capataz : « doctor J. si que sabe mucho, nosotros somos ignorantes, nos tiene que explicar, sino nos pueden engañar ». L’inculture des employés à son tour est perçue par les patrons comme un fait « naturel ». Suivant cette logique perceptive, un peon d’estancia est nécessairement dépourvu de culture générale, il est « comme un enfant ». Sa fonction n’est pas d’être doué à l’école puisqu’il est destiné à ne travailler qu’avec son corps, comme la structure sociale le détermine. Le réel, celui de la reproduction sociale de l’inégalité, est perçu en tant qu’ordre naturel, indépendant de la volonté des sujets :
« ce qui est exprimé par la classe majoritaire c’est l’impossibilité qu’elle présume chez les minoritaires d’acquérir la culture ; ou bien encore elle leur attribue une « insuffisance d’évolution » dont le statut est pour le moins ambigu : ce manque d’évolution, sans se référer explicitement à une interprétation de « nature insuffisante », reste souvent exprimé selon une forme sémantique qui penche dans le sens d’une insuffisance « naturelle ». » (Guillaumin 2002, 151).
Le peon est perçu comme un enfant, un fils donc, qui n’a pas les mêmes droits ni les mêmes aspirations qu’un homme adulte. Monsieur D. m’explique en souriant « entendes que el sabado quieren ir al baile, a divertirse, a tomar por ahi, emborracharse, buscar chicas (il rie), a mi se me escapan ». Au fond le désir du peon d’aller au baile est compris par monsieur D. comme un caprice d’enfant, son éclat de rire le dit clairement. Comment réagissent les patrons lorsqu’ils sont confrontés à des employés qui « s’échappent » de l’estancia le samedi, « pour aller au baile » ? Monsieur D. m’explique que certains sont « intenables » et dans ce cas qu’il finit par les laisser sortir tous les week-ends. Derrière les propos rassurants qui évoquent la gentillesse, la docilité, la naïveté d’un peon qui répond à s’y méprendre au bon gaucho du récit mythique, se dessinent d’autres traits de caractères plus rebelles, plus résistants. L’ordre paisible de l’estancia énoncé comme tel, est trompeur. C’est que le langage utilisé, les formes sémantiques qui insinuent un respect réciproque, une filiation affectueuse, ne sont rien d’autres que des énoncés performatifs, qui s’emploient moins pour « « communiquer » des « informations » préexistantes, c’est-à-dire nommer ce qui existait déjà », mais plutôt pour « faire advenir une réalité inédite » (Laplantine 1999, 119). Il arrive que cette réalité dans laquelle chacun apprend un rôle, adopte des attitudes conformes à son statut, se procurant masques et déguisements dans les boutiques du renoncement, se lézarde. Et ce qu’il reste alors, c’est la violence.
B. Ennemis irréconciliables ?
La terreur inspirée par le culte au Gauchito Gil se retrouve dans certains propos des estancieros à l’égard de leurs employés. Le fossé qui existe entre les deux types de famille est réel. C’est une distance culturelle, économique, quantifiable. Elle a pour effet de créer de la distance humaine, plus qualitative.
Un bon patron est celui qui sait « dompter » ses peones, parce que, dit-on, le peon n’est pas homme à se laisser faire. Le plus dur pour un estanciero d’après monsieur F., « ce n’est pas de gagner de l’argent mais c’est de savoir se faire respecter ». Savoir faire ce que sait faire le peon ne suffit pas, il faut montrer encore qu’on en sait plus que lui. Le travail consiste alors à signifier le régime d’inégalité, c’est-à-dire expliciter, par des gestes, des mots, que l’on est supérieur et que l’autre est inférieur. Comme l’explique Pierre Bourdieu, pour que la structure sociale tienne, le langage, en son sens large, doit la redoubler en « impos(ant) un système de pratiques et de représentations dont la structure, objectivement fondée sur un principe de division politique, se présente comme la structure naturelle-surnaturelle du cosmos » (1971, 300). La langue, la « manière de parler de ce dont ils parlent – (la syntaxe) » (1971, 298) donne à voir la division politique, elle institue symboliquement la hiérarchisation sociale, au quotidien. L’habit, le véhicule, l’habitat, la nourriture (qui sont de fait montrés à l’autre), sont des constructions discursives qui marquent avec évidence la différence. Dans l’espace clos de l’estancia, les uns sont désignés ainsi : « el patron », « doña Angela», « la señora Silvina». Les peones quant à eux sont appelés « los chicos », dénomination aussi infantilisante qu’affectueuse, qui rappelle avec douceur que « Le maître ici c’est moi » (Fanon 2002, 55).
Il s’agit de tenir un rapport de force : user de ruses, penser avec stratégie la domination, accentuer les signes de la hiérarchisation. Il faut tenir le peon, parce qu’il est capable d’attaquer ou d’échapper au contrôle. D’après plusieurs témoignages nous savons que les peones quittent souvent leur patron d’un jour à l’autre, sans les avoir prévenu au préalable. Ils disparaissent silencieusement, « renuncian callamente » m’explique monsieur R. qui travaille depuis trente ans à Renatre (une société de protection sociale des travailleurs ruraux). Il estime que quatre-vingt pour cent des peones ne reste pas plus de deux ou trois ans dans une même estancia (les capataz par contre restent plus longtemps). Il insiste sur lestanc fait que les peones « son de poco hablar, son timidos, muchos son analfabetos, muy callados ». Nous avons entendu plusieurs fois ce commentaire, auprès d’eieros notamment. Est-il encore besoin de préciser qu’ils perçoivent ce déficit de parole comme un fait culturel ? Les peones parlent peu, opposent une résistance au dialogue. D’abord on les comprend mal, ils parlent « fermé ». Il y a trente ans la compréhension était d’autant plus malaisée qu’un grand nombre d’entre eux ne parlait que le guarani. Madame L., veuve d’un uruguayen ayant hérité d’un oncle une terre dans le département de Mercedes, m’a expliqué à plusieurs reprises que son mari avait fait l’effort couteux d’apprendre le guarani parce qu’il ne supportait pas de ne pas comprendre lorsque ses peones parlaient cette langue entre eux. Il n’acceptait pas que des choses puissent se dire à son insu. Selon monsieur V., propriétaire de 1000 hectares aux alentours de Solari, « por ahi hablaban mal de vos en guarani, y no sabias ». Le guarani est perçu avec méfiance, et son emploi est interprété comme une stratégie ayant à voir avec de la désobéissance. L’essentiel est moins de savoir si effectivement les peones utilisaient le guarani pour dire les choses à l’insu de leur patron mais plutôt de noter l’effet produit chez les seconds : la peur d’être attaqué, la peur d’être méprisé, « par derrière », la peur de l’effacement de soi. La confiance accordée au peon, à qui on laisse le contrôle de l’estancia, est fragile. Dans la relation d’homme à homme subsiste une méfiance constante. La plupart des estancieros de Mercedes sont d’ailleurs armés, au cas où. Comme le souligne Rodriguez commentant l’expression « d’ennemis irréconciliables » proposée par Agüero et que nous reprenons à notre compte, les réalités du régime de la domination latifundiste empêchent « la posibilidad de un dominio por otros caminos que no fuesen los de la fuerza impuesta al desposeído, la jerarquización del dinero y del trabajo para racionalizar el poder » (131) et qu’elles produisent donc des formes de violence indépassables, entre les uns et les autres, qui s’expriment au sein de relations interpersonnelles. « El sistema, poursuit Rodriguez, determina la rebeldía anárquica e individual, la única respuesta posible entonces para el desposeído ». Le vol de bétail dans les estancias (cuatrerismo), le fait que les peones s’échappent fréquemment des estancias le week-end, qu’ils démissionnent d’un jour à l’autre, sont des attitudes qui sont le produit de la domination, et qui lui rende en même temps service puisque sa logique perceptive s’empresse de les insérer dans le « cercle vivieux » de son « système de justification » (Guillaumin 2002, 120). On retrouvera alors le commentaire, comme une idée fixe, de madame F. à propos du Gauchito Gil qui « n’était qu’un brigand », parce que c’est dans la nature des ces « autres » que de voler, au lieu de travailler.
Nous souhaitons rapporter, pour finir, ce fait divers tragique, qui raconte comment la violence latente, si elle n’est pas détournée par d’innombrables refuges narratifs, pirouettes langagières mensongères, épuisantes pour les uns et les autres, où chacun dit autre chose que ce qu’il pense, finit par advenir. Monsieur L., descendant d’une grande famille de l’aristocratie de la province de Corrientes est propriétaire de 4000 hectares de terres dans le département de Mercedes. Il est connu pour être impulsif et particulièrement autoritaire. Son neveu qui me raconte l’anecdote me dit que lorsqu’il avait un reproche à faire à un de ses peon il le faisait devant toute la peonada, au lieu de convoquer l’employé dans son bureau, « como corresponde ». Sans entrer dans les détails il me dit que le capataz a été si vexé par la façon de faire de l’oncle, qu’il a fini par l’attaquer physiquement. Le capataz à cheval s’est approché du 4x4 du patron et l’a menacé avec son couteau de travail. La réaction de l’oncle ne s’est pas faite attendre, il a tiré et tué sur le coup son employé. La justice considérant le meurtre comme un acte de légitime défense, a puni l’homme de trois mois de prison. Mais le plus significatif de cette anecdote sordide est sans doute le fait que l’estancia de monsieur L. est aujourd’hui livrée à elle-même, personne n’a jusqu’à présent accepté de travailler pour lui. Justice populaire, accord tacite collectif qui énonce, en produisant des effets réels, qu’il y a des limites à l’acceptation du régime inégalitaire.
L’existence est faite d’expériences éclatées qui « engendr(ent) une distance et un détachement : l’individu n’est pas totalement dans son rôle, il est critique par rapport à sa position dans la société. Mais grâce à sa subjectivité, il réalise un travail pour donner sens et cohérence à une expérience dispersée » (Boidin 2004, 47). C’est dans ce genre de prise de position, le refus de la violence sauvage, que les sujets trouvent une part de l’autonomie, symbolique, nécessaire au maintien de leur intégrité. Par la production de récits interposés, à l’instar de celui du Gauchito Gil, les groupes dominés font voir aux autres et pour eux-mêmes, que l’annulation du sujet opérée par la domination n’est pas totale, qu’elle résiste aussi aux fables du discours hégémonique, celui qui cherche à faire percevoir le réel comme une surface lisse et homogène, sans failles ni contradictions.
Conclusion
Le mythe aveuglant et ahistorique du bon gaucho on l’a compris permet de faire passer les conditions de vie misérables des peones rurales comme les conséquences non pas d’un ordre social mais d’un penchant naturel de ces derniers à une vie « sauvage », dépourvue de considérations matérielles. Dans cette perception idyllique le gaucho est au-dessus du reste des hommes, malgré, on le concède, la liberté dont il ne jouit pas. A ce mythe hégémonique s’interpose celui du mauvais gaucho, récit qui surligne sans détours le système d’oppression réel dans lequel se déroule l’existence d’un personnage qui choisira la rébellion plutôt que l’alignement. Il s’agit là de deux univers mythiques, deux icônes inspirés de la réalité, qui sont comme une toile de fond des principes de perceptions que l’on apprend et que l’on s’approprie selon son statut social et son expérience individuelle. Si la construction symbolique de la perception de la légitimité des inégalités est imposée par la culture dominante, elle ne fonctionne que dès lors que les dominés adhérent et consentent au système de valeurs communes établie par la première. Les réactions effarées qu’engendrent le culte au Gauchito Gil, aussi bien les qualités du personnage vénéré que les pratiques qui lui sont liées, démontrent bien a contrario, que le phénomène vient faire trembler un « ordre du monde » que l’on s’évertue à conserver et reproduire depuis des générations. Le paradoxe souligné d’un certain fatalisme entourant les pratiques liées au Gauchito Gil n’en est peut-être pas un, ou en tout cas plus pour longtemps. Le religieux doit s’entendre, comme l’écrit Achille Mbembe, « non pas seulement comme rapport au divin, mais aussi comme « instance de la cure » et de l’espérance, dans un contexte historique où la violence a touché non seulement les infrastructures matérielles, mais aussi les infrastructures psychiques, à travers le dénigrement de l’autre, l’affirmation selon laquelle il n’est rien » (2006, 127). Le risque pris de raconter une autre version de l’histoire, version aujourd’hui connue par des milliers de fidèles en Argentine, est un acte politique qui travaille à faire changer, à modeler les perceptions, suivant le même modèle narratif utilisé par le discours hégémonique. C’est un processus lent et qui ne se suffit pas à lui-même, peut-être d’abord parce qu’il se donne en dehors des relations interpersonnelles de domination, parce qu’il est un espace de lutte de l’entre-soi.
Dans le cadre de la relation inégalitaire d’homme à homme, la distance est plus difficile à prendre, parce que les sujets y sont pris affectivement. Nous avons vu qu’il existe un lien intime, d’affection sincère et réciproque qui unit les estancieros et les peones. Ce lien, énoncé par les sujets comme celui d’une filiation symbolique vécue à partir d’expériences individuelles, rappelle le consensus national selon lequel la hiérarchie sociale serait justifiée par la présence dans la société d’une classe d’individus inaptes à son administration. La docilité réelle de certains peones prouve à l’envie qu’ils n’ont pas pleinement conscience d’être dominés et qu’ils sont donc complices de la domination. Les efforts discursifs que déploient les estancieros pour dissimuler le fossé qui les sépare des peones tout en continuant de le creuser par derrière, introduit quelque chose de trouble dans le rapport social. Difficile de conclure alors sur la bienveillance ou la malveillance de l’autre. Et c’est la même chose de l’autre côté. Le peon est bon mais on sait qu’il est fourbe également. Cette indécision semble justement faire tenir le système. Lorsqu’elle tombe et que le réel s’annonce avec la clarté de l’aube, il n’y a pas d’autre issue que la mort de l’autre.
Notes de bas de page
[1] Le présent article a été élaboré à partir d’informations recueillies au cours d’une ethnographie centrée sur le culte au Gauchito Gil dans la province de Corrientes entre 2006 et 2007. Le travail de terrain a inclu des participations aux fêtes religieuses liées au Gauchito Gil, un recensement élargi des autels de la province, divers entretiens avec des fidèles du Gauchito Gil. Conjointement l’analyse de journaux, du discours des classes moyennes sur le culte, une attention flottante au discours dominant, ont permis de comprendre, par effet de miroir, bien des choses sur le culte lui-même. Plusieurs séjours prolongés dans des estancias du département de Mercedes (Corrientes) ont été l’occasion de nombreuses observations de la relation entre les propriétaires et leurs peones, et d’une connaissance intime de ces derniers.
[2] Colette Guillaumin distingue le majoritaire et le minoritaire en fonction de l’accès des individus au capital économique et à certains droits et devoirs. Ainsi, « C’est en fonction de cette disproportion d’être, et non de nombre puisqu’ils peuvent être indifféremment plus nombreux ou moins nombreux que le groupe dominant, qu’on adoptera les dénominations « majorité et minorité » » (Guillaumin 2002, 120)..
[3] Origine, résultat et mode de la domination et de l’expansion coloniale, la structure de l’agriculture latifundiste est, en Argentine, la cause principale de l’inégalité de la répartition des richesses. Le nombre de propriétaires terriens au regard de l’immensité du pays et de l’importance de l’exploitation de son sol, est minime. La main d’œuvre employée par les latifundistes, les peones, vit dans des conditions de vie précaires : salaires bas, insécurité de l’emploi, éloignement prolongé du foyer familial. Dans la province de Corrientes, les peones, gardiens de troupeaux de bovins, travaillent en général « par quinzaine », en fait treize jours consécutifs suivis de deux jours de repos et donc de retour au foyer. Leurs déplacements, sur l’échiquier des terres de Corrientes, sont limités, comme dessinés à l’avance. En plus de la peonada, le propriétaire d’une estancia emploie une famille qui participe à l’entretien de la « maison de maître » et de ses espaces extérieurs (aussi bien l’espace immédiat du jardin que de celui, immense, du campo). Le nombre d’employés varie selon la taille de l’exploitation, qui elle-même varie de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Le fonctionnement de l’estancia obéit à une hiérarchie stricte. Dans le cas où le propriétaire habite à l’extérieur de la province (c’est le cas pour les très grandes estancias), il délègue l’administration de l’estancia à un majordome, appelé aussi encargado. Celui-ci donne les ordres de travail à un capataz qui lui-même les transmets aux peones. Le salaire d’un capataz n’est pas beaucoup plus élevé que celui d’un peon. En plus des peones « fixes », un patron emploie des peones journaliers lorsque les travaux agricoles l’exigent.
[4] « A Corrientes nous avons la chance d’avoir ces gens si spéciaux, qu’il n’y a pas dans les autres provinces, il ne faut pas que ces gens disparaissent parce qu’ils sont uniques, authentiques. Le gaucho, le peon rural, est un homme travailleur, respectueux, serviable, très solitaire. Avant les années quatre-vingt on ne donnait pas de salaire aux péons, ils travaillaient pour être logé et nourri. Le peon n’a pas la même idée de l’économique, il ne travaille pas pour l’argent, il n’est pas capitaliste, il n’a pas cette mentalité, il est au-delà de tout ça, il se suffit de peu de choses, c’est impressionnant ».
[5] La Sociedad Rural est une association nationale de producteurs-éleveurs. Celle de Mercedes a été la plus importante du pays pendant de nombreuses années.
[6] Plat à base de farine de maïs
[7] « Le matin on boit du maté, ou des galettes avec du café au lait, ça dépend de ce que l’on te donne, il y en a qui sont très radins et qui ne te donnent rien. Mais la mbaipy, ça fait longtemps qu’on en mange plus ».
[8] Voir à ce propos le travail de Mónica Quijada in QUIJADA Mónica, BERNAND Carmen, SCHNEIDER Arnd, Homogeneidad y nación. Con un estudio de caso : Argentina, siglos XIX y XX, Consejo Superior de Investigación Científicas, Madrid, 2000.
[9] Bien sûr le long poème versifié, mais en langue argotique, d’Hernandez « Martin Fierro » s’impose rapidement. Il n’est que la partie émergée d’une immense production littéraire du dernier tiers du 19e siècle.
[10] L’expression couramment utilisée par les peons, « estoy a dentro » (je suis à l’intérieur), pour dire qu’ils sont à l’estancia, nous semble légitimer l’usage du terme « enfermés ».
[11] « Qui n’était rien moins qu’un voleur de bétail »
[12] « Je me souviens qu’avant, il y a environ trente ans, ce n’était pas les gens décents/respectables qui vénéraient le Gauchito Gil, c’était les gens plus humbles. Parler du Gauchito Gil dans la société urbaine, dans l’église principale de la ville, c’était comme dire un gros mot »
[13] Les inégalités sociales se construisent et se légitiment à partir du présupposé idéologique de l’infériorité d’un secteur que l’on peut difficilement, vu l’intensité des métissages qu’a connu l’Argentine, identifier en termes de race ou d’ethnie. Pourtant, c’est bien un signifiant biologique qui vient aujourd’hui dire la distinction : le terme negros employé couramment par les classes moyennes issues de l’immigration européenne du 19e siècle, pour désigner cette partie du peuple argentin qui est exclue économiquement, politiquement, socialement du destin socio-historique de la nation, qui n’est pas noire de peau mais « noire dans l’âme ». Voir à ce propos, BLAZQUEZ, Gustavo, « Negros de alma. Raza y procesos de subjetivacion juveniles en torno a los Bailes de Cuarteto (Cordoba, Argentina) », p 6-34, in Estudios en Antropologia Social, Volumen 1, Numero 1, Buenos Aires, 2008.
Bibliographie
BAZIN, Jean, Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Anarchasis Editions, 2008.
BENSA, Alban, La fin de l’exotisme. Essais d’anthropologie critique, Anarchasis Editions, 2006.
BERNAND, Carmen, « Censo Indigena Nacional I, Provincia de Buenos Aires y Zona Sur », 1966-67, p.109-111, in L’Homme, Volume 11, Numéro 4, 1971.
BLAZQUEZ, Gustavo, « Negros de alma. Raza y procesos de subjetivacion juveniles en torno a los Bailes de Cuarteto (Cordoba, Argentina) », p 6-34, in Estudios en Antropologia Social, Volumen 1, Numero 1, Buenos Aires, 2008.
BONFIL BATALLA, Guillermo, El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial, Identidad y pluralismo cultural en América, Fondo Editorial de
CEHASS/Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1992.
BOURDIEU, Pierre, « Genèse et structure du champ religieux », p. 295 – 334, Revue française de sociologie, Volume 12, Numéro 3, 1971.
BRIONES, Claudia, La Alteridad del Cuarto Mundo. Una Deconstrucción Antropológica de la Diferencia. Buenos Aires, Ediciones Del Sol, 1998.
CAPURRO, Magdalena, Che patrón. José Ansola, hacendado de Corrientes, la provincia guaraní, Buenos Aires, L.O.L.A, 2004.
CAROZZI, Maria Julia, « Otras religiones, otras politicas : algunas relaciones entre movimientos sociales y religiones sin organizacion central », in Ciencias Sociales y Religion, ano 8, n.8, p.11-29, Porto Alegre, 2006.
COMBES, Isabelle, VILLAR Diego, « Les métis les plus purs. Représentations chiriguano et chané du métissage », in Amériques métisses, 2005.
FANON, Frantz, Les damnés de la terre, Paris, La Découverte/Poche, 2002.
GARAVAGLIA, Juan Carlos, Les hommes de la Pampa, Une histoire agraire de la campagne de Buenos Aires, 1700-1830, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000.
GARAVAGLIA, Juan Carlos, « Gauchos : identidad, identidades », in Revue America, n°30, pp 143-151, 2003.
GODELIER, Maurice, L’énigme du don, Fayard, 1996.
GUILLAUMIN, Colette, L’idéologie raciste, Gallimard, 2002.
LAPLANTINE, François, Je, nous, les autres, Etre humain au-delà des appartenances, Le Pommier-Fayard, 1999.
QUIJADA Mónica, BERNAND Carmen, SCHNEIDER Arnd, Homogeneidad y nación. Con un estudio de caso : Argentina, siglos XIX y XX, Consejo Superior de Investigación Científicas, Madrid, 2000.
MARTINIELLO, Marco et SIMON, Patrick, « Les enjeux de la catégorisation », in Revue européenne des migrations internationales, vol. 21 - n°2, URL :http://remi.revues.org/index2484.html, 2005.
MBEMBE, Achille, « Qu’est-ce que la pensée coloniale ? », in Pour comprendre la pensée postcoloniale, revue Esprit, 2006.
PENCHASZADEH, Ana Paula, Figures captives. Quelques réflexions sur les bords de la nation argentine, http//www.edph.auf.org/Bulletins/Figures%20captives.pdf, 2004.
PECQUEUX, Anthony, La politique incarnée du rap. Socio-anthropologie de la communication et de l'appropriation chansonnières, Thèse pour le doctorat de sociologie de EHESS , 2003.
RANCIERE, Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, La Fabrique, 2000.
RODRIGUEZ, Mariela Eva, « ¿Indígenas, obreros rurales o extranjeros? », in Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, Puesto en línea el 08 février 2005. URL : http://nuevomundo.revues.org/index451.html, 2005.
RODRIGUEZ MOLAS, Ricardo.E, Historia social del gaucho, Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 1982.
SAER, Juan José, L’ancêtre, Paris, Flammarion, 1987.
Pour citer cet article:
Burnot Maureen, «Perceptions réciproques des inégalités dans le contexte de la grande propriété agricole en Argentine», RITA, N°2 : août 2009, (en ligne), Mis en ligne le 01 août 2009. Disponible en ligne http://www.revue-rita.com/content/view/48/117/



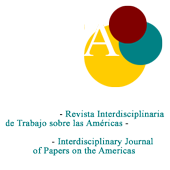








 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8