Rencontres
avec Camille Boutron et Carolina Vergel Tovar
Dans le cadre du deuxième numéro de RITA, « Inégalités et subjectivités, pour une déconstruction de la perception sociale des inégalités » élaboré en partenariat avec le groupe de recherche GECCI, le comité de rédaction a souhaité faire discuter deux doctorantes. Camille Boutron (Sociologie, IHEAL – Paris III) et Carolina Vergel Tovar (Droit, Paris X) ont accepté de répondre à nos questions sur le genre, les inégalités et les conflits armés au Pérou et en Colombie.
Les points traités dans cette rencontre sont:
1. Les formations des discutantes
2. Le Genre
3. Genre et Féminisme
4. Genre et Inégalités
5. Pérou, Colombie et militantisme des femmes
6. Les conflits armés
7. Le terrain
... Bonne lecture!
 |
Camille Boutron
|
 |
Carolina Vergel Tovar
|
1. FORMATION
RITA : Camille, Carolina, vous êtes toutes deux doctorantes en Sciences Sociales vous avez des parcours très différents et atypiques, pourriez-vous dans un premier temps présenter vos parcours et vos recherches ?
Carolina Vergel: Je suis juriste de formation, j’ai effectué mon cursus à l’Université Externado de Colombia, à Bogotá en Colombie. Là-bas on ne fait pas la différence entre juriste et avocat, on obtient le diplôme en droit qui t’habilite à faire les deux choses. Mais on peut montrer ses préférences en faisant soit un stage dans la magistrature, soit en faisant l’équivalent d’un mémoire. J’ai donc fait un mémoire intitulé « La protection juridique des personnes déplacées par la force en Colombie ». Il se trouve que ce mémoire a été publié par mon université en Colombie et grâce à cela j’ai été contactée par des associations de femmes, des ONGs féministes, qui avaient créé un observatoire des droits des femmes en Colombie. En parallèle de mes débuts en tant qu’enseignante en droit civil, j’ai travaillé durant un peu plus de deux ans en tant que consultante avec cet observatoire. Puis j’ai fini par intégrer, notamment grâce à mon expérience au sein de l’observatoire, un groupe qui élabore des rapports sur la violence contre les femmes, pour la rapporteuse des Nations Unies. Ensuite, il y a quatre ans je suis venue en France pour faire un diplôme assez particulier de l’Université Paris II - Assas appelé DSU (Diplôme Supérieur d’Université) en droit civil.
RITA : C’était pour reconnaître ton diplôme obtenu en Colombie ?
Carolina Vergel: Non, pas vraiment. C’est un diplôme conçu pour faire de l’introduction au droit français et de la méthodologie. Tu peux choisir trois séminaires de Master, tout dépend de tes intérêts et de tes ambitions, mais en soi ce n’est pas un diplôme qui t’habilite à exercer. Par la suite j’ai fait un Master 2 un peu particulier aussi car il s’effectue entre plusieurs universités : Paris X, l’EHESS et l’ENS, appelé « Théorie et analyse du droit ». C’est un diplôme qui a pour objectif d’appliquer les sciences sociales au droit, y compris ce qu’on appelle la « théorie du droit » maintenant, que l’on peut définir comme la Philosophie du droit et la dogmatique critique du droit même, mais le diplôme s’intéresse aussi à l’Histoire, l’Anthropologie et la sociologie du droit. Après cela j’ai décidé de faire une thèse qui relève plutôt de la sociologie du droit finalement. Le sujet de ma thèse est « Les usages militants du droit par les femmes victimes de la guerre en Colombie et la réponse institutionnelle et judiciaire à cette mobilisation ». Je m’intéresse notamment à deux problématiques : la violence sexuelle et la restitution des terres.
Camille Boutron: En ce qui me concerne, je suis en thèse de Sociologie à l’IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine), Université Sorbonne Nouvelle – Paris III. Je travaille sur la participation des femmes au conflit armé au Pérou, conflit qui a eu lieu entre 1980 et 1997, et sur les trajectoires des femmes qui ont été amenées à participer à ce conflit en tant que combattantes. C'est-à-dire celles qui ont été entraînées dans un processus militaire, aussi bien au sein des groupes de militants politiques rebelles, donc MRTA (Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru) ou le Parti Communiste Péruvien Sentier Lumineux, que dans les patrouilles civiles d’auto-défense. Ces dernières se sont formées dans les zones rurales les plus affectées par la violence politique, et se sont généralement organisées en collaboration avec les forces armées, suivant le modèle de lutte contre-subversive assez classique qui vient des Etats-Unis depuis la guerre de Vietnam. J’essaie donc à travers ces trajectoires de proposer une nouvelle perspective d’analyse du conflit armé péruvien. Je m’intéresse particulièrement à ses implications dans la restitution des relations sociales, en cherchant à savoir ce que la participation des femmes a changé dans les rôles sociaux de sexe, et comment ces changements éventuels influent sur la reconstruction du tissu social tel qu’il se recompose au sein d’une société post-conflictuelle.
Je suis historienne de formation initiale. J’ai fait une maîtrise d’Histoire à Paris VII, sous la direction de Gabrielle Houbre, sur la participation des femmes aux jeux olympiques entre 1896 et 1948. A l’époque, je faisais du sport, je ne voulais pas du tout faire des études, donc je me suis dis, pourquoi pas combiner les deux en choisissant un sujet de recherche qui me permette de réfléchir sur ma propre trajectoire. Après quelques errements, j’ai commencé un DEA à l’IHEAL en Sociologie et pour le mémoire de fin d’année je me suis intéressée au travail de femmes dans la police nationale péruvienne. Puis j’ai continué en thèse, où j’ai fini par arriver au conflit armé. J’étais d’abord intéressée par le genre en tant que sujet et en tant qu’axe de recherche, c’est plus tard que j’en suis venue à choisir la Sociologie comme champ d’analyse.
2. LE GENRE
RITA : Nous avons une première question sur le genre, et sur le fait de travailler sur les femmes. Qu’est-ce que cela signifie pour vous de « travailler sur le genre », « faire une étude de genre », « adopter une perspective de genre » ? Parmi toutes ces appellations de quoi doit-on parler ? Quelle est la différence entre une perspective, une étude et un objet de genre?
Camille Boutron: Le genre, j’y suis venue en Licence d’Histoire. Lors de mon inscription pédagogique, dans la plaquette des cours figurait un séminaire intitulé « Histoire des femmes XIXème – XXème siècle », dirigé par Gabrielle Houbre. J’ai été alors interpelée « l’histoire des femmes ? », et donc j’ai choisi ce cours. Ce fut très intéressant, car tout d’un coup on avait une autre lecture d’événements historiques bien connus. Je pense que c’est cela qui m’a amenée à la Sociologie d’ailleurs. Je pense que le genre, c’est avant tout adopter une autre perspective pour étudier des phénomènes sociaux. Donc pour moi, c’est à la fois un objet (on peut étudier le genre en tant que tel, au centre de l’analyse), mais ça peut aussi être une méthodologie. Je pense qu’on n’est pas obligé, pour travailler sur le genre, de travailler sur les femmes ou sur les orientations sociales de sexe mais que ça peut être un outil méthodologique novateur et dynamique pour éclairer des sujets déjà très étudiés. Il y a beaucoup de gens aujourd’hui qui font une thèse qui, a priori, n’a rien à voir avec le genre, et à la lecture de leur plan ou en parlant avec eux, tu te rends compte qu’ils ont complètement intégré la méthodologie du genre sans en avoir conscience. Donc le genre c’est à la fois un objet et une méthodologie.
RITA : Alors dans ton travail tu utilises quel terme ?
Camille Boutron : Moi, ça m’est égal. Dans mon parcours, ce que je voulais, surtout après mes études d’Histoire, c’était retourner au Pérou, je voulais retourner sur le terrain. Je me suis donc dit que j’allais quand même continuer à travailler sur les femmes pour rester cohérente avec mon parcours universitaire initial, donc j’ai déposé mon dossier de candidature à l’IHEAL pour le DEA en proposant un sujet sur le genre. Ce qui m’intéressait, c’était de voir les femmes dans des métiers d’hommes, mais il fallait aussi comprendre l’univers masculin. C’est à ce moment que j’ai travaillé véritablement sur le genre, parce que le genre c’est de voir comment les différentes identités sexuées et genrées se construisent et se répondent, se reproduisent l’une l’autre, entrent en conflit, etc. Puis, en travaillant sur le conflit armé je me suis penchée plus particulièrement sur la participation des femmes dans des activités impliquant un certain usage de la violence traditionnellement associé à la masculinité, et maintenant en fin de thèse j’ai l’impression de pouvoir proposer une nouvelle perspective du conflit armé péruvien. C’est-à-dire dans à partir de la « vie privée » des gens, dans la façon dont le conflit est raconté dans ses versions « extra officielles », dans une espèce de construction narrative du conflit qui s’élabore à partir de l’espace privé, en marge du discours dominant. Donc ceci est devenu petit à petit plutôt une méthodologie, un angle d’approche, que j’applique finalement systématiquement, mais qui n’amène pas nécessairement aux mêmes conclusions et aux mêmes observations.
Carolina Vergel : Merci de répondre aussi spontanément... Ce n’est pas facile de répondre à cette question car je l’appréhende de deux manières. Tout d’abord je me pose la question de façon plus personnelle et c’est ensuite que je rationalise cette question, qui m’amène à des réflexions qui rejoignent ce que tu as dit tout à l’heure. Donc au niveau personnel, je crois que l’on peut être une juriste, chercheuse, intéressée à la question des femmes sans jamais aborder la question du genre. Il existe beaucoup de matériel et de documentation à propos de la violation des droits de l’homme qui ne problématisent jamais la question du genre ; qui ne s’intéressent jamais aux représentations de genre à partir d’un sexe. En ce qui concerne le droit, si on adopte le point du féministe radical, le genre sert à signaler que le droit est au service de la domination masculine et qui n’a fait qu’aider à perpétuer ce rapport de force.
Lorsque j’ai fait mon mémoire sur les victimes en Colombie, déplacées par la force, j’avais lu presque toute la jurisprudence sur la question et à aucun moment la question des femmes n’est apparue. Ce n’est peut-être pas une question de l’objet en soi, c’est plutôt une question de « lunettes » que tu portes; je n’étais justement pas sensible à cette question et je n’avais pas les outils. C’est pour cela que je pense que si on veut étudier la question des femmes avec une perspective de genre, cela implique toujours une méthodologie particulière. Je ne pense pas que ce soit un choix, car on peut voir qu’il est possible d’étudier les femmes sans problématiser la catégorie féminine, c’est-à-dire les concepts de masculin et féminin. De plus je vois des personnes tantôt dans le milieu de la recherche, tantôt dans le milieu militant, des milieux qui s’entrecroisent parfois, qui s’intéressent à la condition des femmes mais qui ne font que renforcer des idées, des jugements et des préjugés liés aux questions qu’une perspective de genre tente de problématiser.
Bref, travailler sur ces problématiques de genre, ça n’interpelle pas seulement ton objet mais ça interpelle aussi ta vie, tu commences à avoir un tout autre regard : Tu es une femme, chercheuse, a quel point ceci oriente ton objet et ton regard? C’est une question épistémologique énorme ; cette neutralité prétendue du chercheur, que les sciences sociales ont problématisé à maintes reprises.
En ce qui concerne le droit, sans faire tout l’échantillon des théories féministes sur le droit ou l’analyse de la relation des femmes au droit, la perspective de genre problématise le droit en tant que tel, parce qu’une loi n’est jamais naturelle même si elle le prétend.
RITA : Le genre s’est donc focalisé essentiellement sur la condition féminine. En même temps, on voit fleurir de plus en plus d’études sur les masculinités ou sur l’homosexualité. Qu’en pensez-vous ? Constatez-vous un certain changement de ce point de vue dans vos disciplines respectives ?
Carolina Vergel : Catharine McKinnon est la femme qui a introduit la démarche féministe dans les facultés de droit aux Etats Unis. Le féminisme radical (son courant de pensée) considère le droit tout entier comme une construction masculine et la tâche de la recherche féministe selon cette perspective doit être de déconstruire complètement le droit car il n’a jamais pensé à la femme. Ce concept a donc été construit en laissant de côté la femme et donc à partir de cela une catégorie fondatrice de la pensée juridique comme par exemple le concept de « sujet de droits » ou de « personne » n’est plus valable pour elle. Ce n’est pas simplement le fait de dénoncer certaines lois comme sexistes, ce sont les concepts à partir desquels a été conçu le droit en tant que tel qui sont remis en question. C’est tout un défi mais en même temps c’est une perspective que je trouve parfois très paralysante parce que le droit est bien là, déjà existant et les femmes se servent du droit…
Camille Boutron : Moi j’utilise dans ma thèse la perspective de genre, la méthodologie de genre pour étudier un sujet qui normalement était étudié avec une perspective peut être juridique ou Sciences Politiques.
Je pense cependant que lorsque tu t’intéresses aux identités sexuelles, tu ne peux pas « ne pas faire de genre », c’est un sujet en soi ; parce que tu questionnes les fondamentaux de la construction des identités de genre et ça va très loin. Tu questionnes éventuellement l’idée qu’il n’y ait que deux sexes, tu questionnes qu’il y ait vraiment une différence biologique entre les hommes et les femmes, etc. Là, tu es fondamentalement dans le genre et dans une problématique de genre. Cependant, tu ne peux pas utiliser le thème des identités sexuelles, des transsexuels ou de l’homosexualité etc. comme des variables dans une analyse, je pense que c’est vraiment un objet de réflexion en soi.
Pour ce qui de la masculinité, c’est la même chose. Lorsque tu t’intéresses aux femmes tu ne peux pas ne pas t’intéresser à la masculinité, je veux dire, c’est terminé les études de genre centrées exclusivement sur les femmes. On ne peut pas faire une thèse sur les femmes et ne pas s’intéresser aux hommes ou bien à la masculinité, comme tu le dis Carolina, en tant que telle. En effet les femmes évoluent dans un monde régi par des lois patriarcales, etc.
C’est pour cela que dire j’étudie « la participation des femmes dans », et c’est frustrant parce que les gens te classent tout de suite dans la catégorie « spécialiste des femmes », alors que tu ne peux pas travailler sur les femmes comme si c’était un objet cloisonné.
En fait, étudier le genre, c’est de refuser le neutre universel. A chaque fois que tu regardes des phénomènes sociaux, ou des relations sociales, à chaque fois que tu vois une scène dans la rue, essaie de te demander en quoi le fait que ce soit un homme qui ait dit ça ou le fait que ce soit une femme qui ait parlé de telle manière, a une incidence vis-à-vis de la scène à laquelle tu viens d’assister. Donc tu t’interroges forcément sur ces concepts-là.
3. GENRE et FEMINISME
RITA : Les études de genre aujourd’hui, ne sont elles pas vues comme un engagement de femmes, de féministes ? Est-ce vue comme une lutte contre la victimisation de la femme, contre le patriarcat et la domination masculine ? Ou les études de genre prennent un autre tournant et se tournent plus vers les hommes ?
Camille Boutron : Je pense que le genre ça n’a jamais été d’étudier les femmes en tant que victimes. C’est ce que les gens qui ne connaissent pas bien le genre disent. Il y a une certaine logique derrière tout cela. Pour moi le féminisme c’est une des révolutions les plus importantes qu’a connu notre planète. Pour ce qui est du genre, chaque chose en son temps, le genre, ça a commencé dans les années soixante-dix, c’est très récent ; on commence à rendre visible des acteurs qui ne l’étaient pas auparavant, donc ça met déjà un certain temps. Donc que les études de genre se soient focalisées sur les femmes et sur les rapports de domination des femmes c’est assez compréhensible, parce qu’il fallait quand même mettre cela à jour.
Ensuite, que les études de genre soient automatiquement liées au féminisme, alors pas du tout. Maintenant, je pense que c’est quand même très difficile de réaliser une recherche sans une part d’implication personnelle ! Quand tu passes cinq ans de ta vie à te poser des questions sur les relations entre les hommes et les femmes, tu ne peux pas à un moment ne pas être réflexive. Je me souviens qu’en Licence, Gabrielle Houbre avait commencé son cours comme ça : elle avait demandé à la salle de classe qui pouvait se réclamer d’être féministe (il y avait plus de filles mais quand même pas mal de garçon dans ce séminaire), personne n’avait levé la main. Mais ensuite elle avait demandé, qui, dans cette même salle de classe irait manifester dans la rue si jamais on interdisait la pilule et l’avortement, tout le monde avait levé la main. En fait, cette réaction-là démontre assez bien l’état des choses dans lequel on est aujourd’hui. C'est-à-dire une espèce de méconnaissance du féminisme. Moi je pense que le féminisme a développé un discours sur le statut des femmes, ce discours a cherché à déconstruire les relations de genre. Il était adressé à l’Etat mais moins aux hommes qui, de fait, ne se sont pas impliqués, à part quelques uns !
RITA : Mais aujourd’hui tu as aussi des hommes dans les mouvements féministes. Ce n’est pas très courant mais ça arrive.
Camille Boutron : Oui, tout à fait. Les femmes ne sont pas les seules à souffrir du patriarcat les hommes aussi…! Mais je pense que le genre, même si ça devient à la mode, est encore très ghettoïsé. Il faudrait que ce soit mieux enseigné, mais surtout mieux valorisé, ou justement enseigné séparément du militantisme. Donc ce que je veux dire, c’est qu’il y a une espèce de « mauvaise réputation » du genre et du féminisme. Mais le jour où ce sera aussi légitime que d’être un spécialiste de la Sociologie du Travail, il y aura plus d’hommes qui vont s’intéresser à ce type de sujet. Peut-être qu’il existe aussi un gros a priori sur les hommes qui travaillent sur le genre, « tu travailles sur le genre, tu es homosexuel ? ». Le jour où ces a priori et stéréotypes seront déconstruits, de nombreux hommes travailleront sur les masculinités, sur le genre en général. Mais je crois qu’ils se sentent exclus, ou que l’on pense encore que c’est une « affaire de femmes », on est encore dans la grande tradition patriarcale qui marque nos sociétés occidentales.
Carolina Vergel : Je pense qu’il est important de faire la distinction entre deux choses. Ce n’est pas la même chose de parler du féminisme que du genre. L’histoire du mot « genre » a un parcours qui est complètement différent dans les milieux militants féministes et dans la recherche. Je crois que c’est grâce au concept de genre que dans la recherche, dans ses objets d’études, on a intégré d’autres sexualités. Votre question me fait penser qu’il serait intéressant d’étudier à quel moment les recherches arrêtent de s’appeler, de s’intituler ou de se présenter comme des recherches sur les femmes pour passer au genre.
C’est en parlant du genre qu’on parle de masculinité, de transsexualité, etc. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions ou de l’histoire du mot « genre ». Je me consacre plutôt à la manière dont les gens le mobilisent. Mais je pense que dans le monde de la recherche, il était important d’ouvrir un espace pour ne pas parler que des femmes et élargir les recherches sur le genre. Mais on peut toujours s’intéresser à la situation des femmes bien évidement, pendant le Moyen Age par exemple, on peut dire aussi que faire une recherche sur la situation des femmes au Moyen Age c’est en soit une critique de l’historiographie faite jusqu’à présent. Tu le disais plus au moins, Camille, les femmes n’étaient pas là, n’apparaissaient nulle part et à un moment donné elles sont apparues. C’est intéressant et on peut se demander pourquoi on s’est intéressé à rendre visibles les études des femmes, au lieu des homosexuels ou des peuples autochtones… mais c’est l’évolution des traditions disciplinaires, d’une vision eurocentriste, occidentale du monde, androcentriste pour le cas des femmes. Donc je crois que c’est intéressant.
Par contre la question de la masculinité m’interpelle autrement car peut-on vraiment voyager dans le temps avec le concept de genre et le concept de masculinité comme on le présente de nos jours ? De la même manière que l’on déciderait d’étudier les femmes en Mésopotamie qui n’ont jamais été montrées ou qui ont été étudiées à partir d’une perspective historiographique complètement androcentrique ou neutre. Mais est-ce qu’on peut voyager dans le temps avec la masculinité de la même manière ? Je ne saurais pas vous dire, mais c’est une réflexion qui me vient à l’esprit à propos de ce qu’on discute.
Camille Boutron : Les rôles de genre, et par conséquent, d’une certaine manière, les identités, ont toujours été en perpétuelle transformation et négociation. Enfin, il n’est pas question d’étudier le rôle des femmes et des hommes aujourd’hui comme si c’était des identités figées qu’on ne découvrait qu’aujourd’hui. C’est pour cela que je pense qu’il est possible d’étudier la masculinité dans le temps. C’est très difficile, en effet, mais justement ça ne pourrait pas être fait si on n’étudie pas les rôles des femmes dans la même époque. C’est pour cela que si on décide d’étudier par exemple, la masculinité dans la Grèce ancienne, on sera obligé de s’intéresser au fait que la masculinité dans la Grèce ancienne est liée à la citoyenneté, à la conscription, à la guerre, etc… Tu peux décider de faire une loupe sur les hommes plutôt que sur les femmes, mais tu es obligé de comprendre et d’étudier tout de même le cas des femmes.
A propos des sexualités, ce qui est important, c’est de déconstruire l’hétérosexualité comme quelque chose de naturel, et de ne pas envisager l’homosexualité, la transsexualité comme une déviance. Or, ce qui change avec les études transgenre c’est de dire : « Mais pourquoi c’est une déviance alors que de telles pratiques ont toujours existé ? L’hétérosexualité est le reflet d’une certaine façon de penser, d’une relation de pouvoir déterminée dans un contexte défini. S’en rendre compte est absolument révolutionnaire car ça permet de remettre complètement en question de nombreux sujets et des situations incroyables. S’intéresser aux transsexualités, c’est remettre en question l’hétérosexualité et toutes les relations de pouvoir et de domination qui vont avec.
4. GENRE et INÉGALITÉS
RITA : Intégrer la dimension de genre dans une étude implique-t-il de travailler sur les inégalités ?
Carolina Vergel : Avant de parler de genre ; parler des femmes en droit implique de parler d’inégalité. Le droit a fixé un traitement différent pour les hommes et les femmes, pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que le droit se sert de la catégorie « sexe » pour édifier des institutions, pour définir des choses. Tout d’abord, c’est un élément indispensable de l’état civil des gens ou pour définir des institutions comme le mariage ; les compétences possibles ou non des personnes, la filiation etc. Il y a toute une série de catégories, d’institutions et de concepts qui s’édifient à partir de la notion de sexe.
L’une des critiques fortes du féminisme contre le droit par rapport à cette question est celle qui est encadrée dans la lutte contre les discriminations, ce qui nous ramène à la question : Est-ce que le droit en soi est sexiste et machiste ? Faut-il construire un autre droit pour lui échapper ? Comment le faire ? Existe t-il des dispositifs de discriminations positives à l’égard des femmes ? Cela remet en question le principe d’égalité. Peut-on toujours prétendre que le principe d’égalité est valable ou est-ce qu’il a toujours été une prétention? Tous les principes sont des prétentions, mais cela implique d’introduire des différences comme celle qui se fait à partir du sexe. Mais, il faut faire attention car on problématise le sexe à partir des critères de genre et de cette manière on vise à déconstruire une chose que, peut-être, on ne fait que renforcer au final. Le système juridique selon les pays est très différent et la réponse sera donc aussi différente selon le pays en question. En France, par exemple, on a beaucoup de mal à admettre certaines discriminations positives, à remettre en question justement ce principe d’égalité, mais on a admis la parité. Par contre, aux Etats-Unis on n’admet pas cela, mais la discrimination positive s’adopte comme une solution pragmatique, assez casuistique. On pourrait même dire que c’est grâce aux mesures de discriminations positives qu’on a aujourd’hui un président noir.
Mais est-ce qu’il faut s’en tenir à cela ? Quelle serait la liste des différences à prendre en compte pour établir des principes de distinction dans le droit ? Des critères « naturalisants » des personnes ? Des critères sociaux ? Des critères politiques ? Donc on glisse des problèmes d’inégalités à des problèmes d’exclusion et de marginalisation. Notre vieux principe si cher d’égalité qui paraît tellement évident pour le sens commun, tombe un peu à l’eau. Donc dans l’univers juridique, forcément le genre est lié à la question de l’inégalité.
Camille Boutron: Je pense que lorsque tu fais une recherche en Sociologie, que tu « fasses du genre » ou pas, tu t’interroges sur les inégalités. C’est exactement ce que tu dis Carolina, on prendra souvent les inégalités comme un terme général, universel, qui serait compris de la même façon par tous. Donc je pense qu’il s’agit de s’interroger sur ce qu’est l’inégalité. Si l’on part du postulat que les femmes sont dominées par les hommes, ça ne mène pas très loin parce que finalement on est tous d’accord. L’intérêt est de voir comment elles s’en sortent vis-à-vis de cette situation. Par exemple, on prend souvent les femmes comme une catégorie générique, alors qu’il y a les femmes pauvres, les riches, les noires, les blanches, les françaises, les boliviennes, etc.
RITA : Cela nous amène à cette question : Comment fait-on pour croiser les inégalités ? Parce que le genre s’accumule avec d’autres catégories. Toi, Carolina tu travailles sur les femmes déplacées, dans le cas de Camille elles ont participé à la guerre et éventuellement elles sont indigènes. Enfin, il y a plusieurs strates qui se mêlent pour définir leur identité. Donc finalement comment fait-on méthodologiquement pour intégrer tout cela ?
Carolina Vergel : Je suis d’accord avec ce que disait Camille tout à l’heure, c'est-à-dire au lieu de partir de concepts préalables sur ce qu’est l’inégalité, la domination ou l’exclusion, il faut observer et comprendre les situations et les discours. Car dans mon étude par exemple, je suis obligée de faire face à un concept assez flou, celui de « justice ». Quand les personnes victimes de la guerre sont traitées en justice, cela peut être très différent de ce qu’un militant va te dire, une femme d’une association, une volontaire, etc. Je crois que c’est ça le plus intéressant, la démarche initiale de ma recherche n’était pas sociologique. Aujourd’hui je présente ma thèse comme de la Sociologie du droit car la théorisation du droit que j’étudiais expliquait très peu de choses par rapport à ce que j’observais, à ce que les gens pensent et décident. C’est plutôt en essayant d’extraire les concepts de genre, de justice et leurs représentations et leurs pratiques que j’ai trouvé des éléments d’analyse.
Camille Boutron : Lorsque tu fais un terrain, tu ne t’intéresses pas qu’aux femmes, mais aussi à comment fonctionne la société. Pour le Pérou, les différents systèmes de relations de pouvoir entre les individus sont marqués par l’organisation coloniale qui établissait une hiérarchie sociale par rapport à l’origine ethnique, les capacités économiques etc. Finalement je ne saurais pas mieux l’expliquer que de dire : c’est évident d’intégrer le croisement de ces diverses facteurs, (je n’ai pas envie de dire inégalités), mais dans l’observation des rapports de pouvoir qui s’établissent entre les individus. Dans une société, les rapports de domination par rapport à l’appartenance ethnique, la catégorie sociale, etc. vont cependant varier selon les rapports de domination hommes - femmes, on retrouve souvent des schémas qui se répètent. Ce qui est intéressant dans le genre, c’est de se rendre compte que les rapports de domination qui se créent entre les identités de genre, servent de patron de référence. C’est un référent pour l’élaboration des relations de pouvoir à d’autres niveaux, entre les identités ethniques, par exemple. C’est pourquoi il est intéressant de voir que les relations de genre, les rôles masculins et féminins, peuvent se retrouver dans une population, soit essentiellement féminine, soit essentiellement masculine. Les relations de genre et les relations de domination, de pouvoir et d’échanges d’influences que cela implique, tu ne le retrouves pas que dans des milieux mixtes. Donc aborder le genre comme un objet est applicable à tous les milieux. A mes yeux le genre est un patron-référent à partir duquel il est possible d’envisager d’autres schémas d’inégalités. Ceci a déjà été beaucoup étudié. On peut trouver beaucoup de textes expliquant comment, par exemple au Pérou, le vaincu est féminisé. Et les es femmes elles-mêmes reproduisent ces inégalités. Par exemple, les femmes de Sentier Lumineux qui faisaient partie de la haute hiérarchie du parti venaient de la ville, elles étaient blanches ou métisses, étaient allées à l’université, alors que celles qui formaient ce que les militants sentiéristes appelaient « la force de base », le plus bas dans la hiérarchie du parti, étaient majoritairement recrutées en zones rurales, le plus souvent de force. Donc tu dois t’interroger sur ces questions d’accumulation des inégalités.
5. PÉROU, COLOMBIE ET MILITANTISME DES FEMMES
Rita : Carolina tu travailles sur la Colombie et toi Camille sur le Pérou. Quelles sont les similitudes et/ou les différences entre vos aires géographiques concernant les femmes militantes ?
Carolina Vergel : Je ne connais pas vraiment le Pérou. Il n y avait pas beaucoup de rapport institutionnel, académique entre la Colombie et le Pérou avant. Mais en Colombie on est plutôt dans une logique d’apprendre et de suivre des cas similaires, cela va de l’ex-Yougoslavie à l’Amérique Centrale, du conflit africain à l’Amérique du Sud et à donc aussi à la Commission de Vérité du Pérou. C’est à partir de l’apparition de cette figure que le lien apparaît. Sur mon terrain j’ai rencontré des cas intéressants à mettre en comparaison avec l’expérience du Pérou mais justement cela me renvoie au fait que c’est un peu un problème car je ne fais pas un travail comparatiste. Faire du comparatisme c’est un défi énorme car il faut maitriser des aires culturelles et géographiques très diverses. Le conflit colombien est très différent de celui du Pérou.
Rita : Alors quelles sont les spécificités colombiennes dans le milieu du militantisme des femmes ?
Carolina Vergel : Je te le dirais quand je rédigerais ma conclusion je ne veux pas faire de conclusion prématurée. Pour l’instant, ce que je peux te dire, c’est que la spécificité du cas Colombien est liée au conflit armé en tant que tel. C’est un conflit armé des plus anciens du monde et pas que de l’Amérique Latine. Il a connu plusieurs étapes qui touchent les femmes de différentes façons. Il n’est pas terminé, il existe toujours et coexiste avec des processus de paix et de démobilisation partiels. Des efforts semblables à ceux du Pérou et de l’Afrique du Sud sont en cours en Colombie mais on n’aboutit toujours pas à la paix.
Rita : Et où en est l’engagement des femmes dans ce conflit ?
Carolina Vergel : Une des particularités de ce cas est que le militantisme se fait en même temps que le conflit. Ce n’est pas un militantisme pour éclaircir les violations aux droits des femmes qui ont eut lieu dans le passé. Je ne préfère pas anticiper des conclusions par rapport à cela ; ça serait trop prématuré car pour trouver une spécificité il faudrait vraiment prendre du recul et faire une comparaison.
Rita : Camille, y a t-il des similitudes avec la Colombie ou bien une spécificité Péruvienne, concernant le féminisme?
Camille Boutron : Je n’ai pas évolué dans le milieu féministe péruvien, il existe, mais je ne le connais pas bien. Cependant la similitude que l’on peut évoquer et qui est partagée par toute l’Amérique Latine, est le fait que le féminisme tel qu’on le connaît en France ou aux Etats-Unis dans les années 70, et tel qu’il arrive en Amérique Latine, est surtout l’apanage de femmes des classes moyennes voire aisées. Il existe des vastes et importants mouvement de femmes issus des quartiers populaires de Lima au Pérou depuis la fin des annés 60, mais qui émergent comme une réponse à une précarité économique et sociale très forte et qui ne sont pas directement inspirés de l’exploration des théories féministes venues d’Europe ou d’Amérique du Nord, même si des liens existent, bien évidemment. Donc quand il s’agit de pays, de sociétés, qui sont marquées par des fractures importantes, ça n’a pas les mêmes conséquences qu’en France ou qu’aux Etats Unis. C’est un féminisme qui a ignoré, et qui continue, je pense, d’ignorer au Pérou, la problématique des indigènes, des femmes en milieu rural, des femmes dont la cosmogonie, la culture est différente. Tu as d’un côté un féminisme urbain militant, des associations de lesbiennes, etc. enfin ça bouge quand même pas mal au Pérou maintenant, et puis de l’autre tu as les campagnes, les zones rurales, qui sont plus marquées par un féminisme avec des énormes guillemets. Des ONGs qui se spécialisent dans le “Droit des femmes”, les “femmes dans les développement”, l’”égalité, la promotion de projets de femmes”, le “microcrédit pour les femmes”, etc.
Rita : Plutôt économique alors ?
Camille Boutron : Oui, mais ce n’est même pas un féminisme, c’est une belle reproduction d’une forme de patriarcat international. Personnellement dans mon cas, j’ai étudié les femmes dans le Sentier Lumineux. Les ennemis, les terroristes, ce n’est pas très populaire, et donc il n’y a pas grand monde qui t’embête lorsque tu effectues ce genre de recherche. Mais en lorsque je me suis intéressée aux femmes dans les campagnes dans les comités d’autodéfense, les personnes travaillant dans certaines ONGs en zones rurales réagissaient comme si je venais “voler” leur public, donc ils n’avaient pas très envie de collaborer, surtout certaines ONGs péruviennes. Ce qui m’a finalement permis de faire mon terrain de manière très autonome!
6. CONFLIT ARMÉ
Rita : Nous allons revenir sur la sémantique. Pourquoi choisir “conflit armé” ou “guerre civile” ? Qu’est ce que ça implique d’un point de vue juridique ? Et quelle est la différence ?
Carolina Vergel : Au niveau juridique, les termes dans le droit international sont plutôt guerre et conflit armé. La différence est que la guerre est le conflit interétatique et le conflit armé est toujours interne, c’est la guerre “fratricide”.
Pour sortir du cadre juridique, la guerre civile est un terme très fort et très consistant en soi. La guerre civile décrite dans la tradition historiographique, comme par exemple la guerre civile espagnole qui est un cas emblématique, montre une société polarisée où le phénomène partisan illustre, définit cette société. Il existe une véritable confrontation qui permet d’identifier le rôle des personnes et leur engagement par rapport à ce conflit.
Tous les conflits armés ne sont pas des guerres civiles, ceci est lié à la transformation des confrontations armées contemporaines surtout après les deux grandes guerres. Le droit international classique de la guerre a été construit en pensant à un modèle de guerre interétatique. Les protocoles de Genève ont essayé d’élargir le concept de droit au conflit interne, qui n’était pas vraiment le modèle « idéal » auquel on avait pensé. Comment essayer de mettre du droit dans « l’absence de droit »? C’est une pure rhétorique de dire cela, le droit est une autre forme de rapport de forces que l’on mobilise et qui à toujours essayé de réguler les conflits. C’est une question passionnante: comment normaliser quelque chose qui est en principe l’espace de la barbarie, de la cruauté, du non droit, un peu l’antithèse du droit? Je pense qu’il est de plus en plus difficile d’appliquer les catégories classiques du droit du conflit armé aux conflits contemporains.
Dans le cas colombien il existe une difficulté au niveau historiographique: comment identifier le début du conflit armé contemporain ? Afin de faire la distinction avec ce qu’on appelle la guerre partisane jusqu’aux années 1950 ? Cette guerre partisane a traversé toutes les couches sociales. Il n’y avait pas une famille qui était épargnée par la guerre et par le phénomène partisan opposant libéraux et conservateurs.
Camille Boutron : Nous pouvons ajouter qu’on assiste à une militarisation générale de la société. Ceci se traduit sous divers facteurs: d’une part la multiplication des armes lourdes, des armes légères, des couteaux, et d’autre, le fait que les Etats tendent à partager l’exercice du pouvoir légitime avec d’autres types d’institutions. Il y a donc une privatisation de la sécurité et une division de l’usage légitime de la violence. Tout cela est typique du néolibéralisme; la privatisation de la société, pas seulement en ce qui concerne les entreprises privées mais aussi le fait qu’on a de plus en plus de groupes sociaux qui vont se charger de leur propre sécurité. Dans un conflit, tu n’as pas que deux acteurs, deux groupes qui s’affrontent l’un l’autre, tu en a trois, quatre, et les alliances évoluent dans le temps. C’est pour cela qu’aujourd’hui il faut plutôt parler de conflit armé pour définir une situation de crise sociale et politique dans laquelle la violence a un rôle central.
Rita : Comment faire pour borner la sortie de conflit ? Nous nous adressons plutôt à toi Camille, dans le cas du Pérou comment cela s’est il borné à 1997 ?
Camille Boutron : 1997, date de la dernière action significative du MRTA, avec la prise d’otage de la résidence de l’ambassadeur du Japon, après il ne se passe presque plus rien. Le chef du Sentier Lumineux est arrêté en 1992, entre 1992 et 1995 on arrête énormément de gens, et le parti s’étiole de plus en plus, le Sentier Lumineux, déjà en crise, passe en crise aigüe. En 1993, le chef suprême (un peu similaire au Sri Lanka d’ailleurs, une fois que la tête tombe il n’y a plus vraiment de parti) réclame les accords de paix au bout de quelques mois de prison. Il les signe avec Montesinos, le bras droit du président Fujimori, et ce dernier. C’est donc la défaite significative des deux groupes en 93 et en 97. En général, on arrête le conflit péruvien en 2000, mais parallèlement à cela, M. Fujimori a répondu au conflit armé par une criminalisation intensive de la protestation sociale. Il a complètement changé le Droit de façon que l’on puisse facilement arrêter quelqu’un, le garder quinze jours en préventive avant de voir un avocat etc. Lorsque qu’il démissionne en 2000, il y a un rétablissement de la démocratie, l’institution d’une Commission de Vérité. Enfin, en ce qui concerne la stabilité politique ou les affrontements armés qui continuent d’exister aujourd’hui au Pérou, on se rend compte que c’est un groupuscule d’acteurs qui sont surtout main dans la main avec les narcotrafiquants dont ils protègent les routes et assurent le passage. On a des affrontements très violents qui perdurent et ça devient d’ailleurs ces derniers temps un scandale, il y a tout un phénomène de recrutement de mineurs dans l’armée. Quant aux comités d’autodéfense, ils n’ont jamais vraiment été démobilisés. Donc on a eu l’installation d’une culture militaire, et de pratiques militaires très fortes. Malgré cela, les violences ne concernent que des régions très ciblées et répondent aux problèmes plus politiques et transnationaux posés par la cocaïne. Donc on est complètement dans autre chose, et je considère le conflit armé comme terminé pour ces raisons.
Carolina Vergel : En Colombie, en ce qui concerne les discours et les usages des mots, c’est interéssant, car le gouvernement actuel nie l’emploi du terme guerre ou conflit armé par rapport à ce qu’il se passe. Des fonctionnaires sont contrôlés dans leur emploi de ces mots dans les documents publics, les discours, les opinions exprimées à la presse. C’est incroyable, nous sommes déjà à la moitié du deuxième mandat d’Alvaro Uribe et la nouvelle dénomination est la violence narcoterroriste. C’est une requalification qui a un intérêt politique, c’était le langage de la campagne présidentielle, elle s’inscrit dans la politique du gouvernement Bush et des luttes antiterroristes.
Je ne peux pas dire qu’on a adapté ces termes par rapport au discours des Etats-Unis mais on peut au minimum constater la coïncidence. A partir des faits on peut voir qu’une opération militaire controversée à l’OEA (l’Organisation des Etats Américains) a fini par se résoudre par la voie diplomatique. En effet le gouvernement colombien a mené une opération militaire, il a bombardé le territoire équatorien sans la permission préalable du gouvernement équatorien, afin de tuer un des commandants des FARCs, Raúl Reyes, qui est mort pendant cette opération. L’argumentation juridique exprimée et mobilisée par le gouvernement colombien pour justifier cette violation du droit international, du sol équatorien et de la souveraineté équatorienne, était la lutte contre le terrorisme. Ce sont pratiquement les mêmes arguments mobilisés par le gouvernement des Etats-Unis pour légitimer la guerre préventive, c’est-à-dire le terrorisme en tant que menace, en tant que problème d’ordre public qui justifie la remise en question des pratiques de légalité selon le droit international. Ceci montre l’affinité du discours politique colombien avec celui des Etats-Unis.
L’OEA a condamné cet acte commis par la Colombie comme une violation de la charte américaine, et seul le gouvernement des Etats-Unis a soutenu la Colombie, les autres membres s’accordant pour qualifier l’opération de violation territoriale.
Aujourd’hui nous sommes dans une nouvelle étape, que l’on peut décrire comme une étape de « narcoterrorisation » et de dépolitisation, c’est un long débat et c’est loin d’être un consensus.
Rita : Quel rôle viennent jouer les mesures de réparation, et la désignation des coupables et des victimes? Est-ce qu’on parle de pacification? Y a-t-il une affirmation de la position dominante des vainqueurs ?
Camille Boutron : Au Pérou, c’est compliqué car ça bouge beaucoup en ce moment. Officiellement, le retour sur les années du conflit comprend seulement trois années après la dernière action armée importante. La Commission de Vérité s’intéresse autant à tout ce qu’il c’est passé pendant le conflit que pendant de l’administration de M. Fujimori. C’est un retour sur une période de vingt années de violence politique. C’est pour cela que le terme de violence politique est intéressant pour le conflit armé péruvien, car il ne s’intéresse pas qu’au conflit en tant que tel mais à la période dans lauquelle il s’insère. A sa parution, la Commission de Vérité annonce qu’il y a eu à peu près 70 000 morts et non pas 25 000 comme on le pensait au préalable, c’est un vrai choc pour le pays. Elle affirme que ces morts sont en général des monolingues Quechuas, pauvres, issus de secteurs sociaux plutôt exclus. Il existe donc une dénonciation publique d’une discrimination qui est traditionnellement à l’oeuvre dans la société péruvienne. On nous apprend que l’armée est responsable de 30% des morts et que le Sentier Lumineux de 51%. Ceci fait scandale et on en reparle encore régulièrement, notamment dans les forces armées, car cela a entrainé la mise en jugement de militaires. M. Fujimori a fait voter des lois d’amnistie dans les années 90, pour tous ceux qui seraient poursuivis pour violation des Droits de l’Homme dans le cadre de la lutte contre subversive civile, militaire ou policière.
Cette loi a été déclarée comme inconstitutionnelle en 2002. Ensuite un retour a été éffectué sur ces lois et même sur toute cette période politique où l’on avait les terroristes d’un coté et le Sentier Lumineux de l’autre, et vaguement le MRTA. Mais finalement les émertéistes sont assimilés au sentiéristes : c’est le “terrorisme”. L’Etat se positionne comme le “sauveur de la patrie”. Le Pérou est en pleine crise economique à cette periode: il n’y a pas que le conflit, c’est tout un ensemble d’évènements et de phénomènes qui bouleversent complètement sa société. La Commission de Vérité tente plus ou moins diplomatiquement de montrer que c’était une vraie guerre civile. Tous les secteurs du pays étaient impliqués à différents niveaux. Pour l’instant personne à part les militants rebelles et M. Fujimori il y a peu n’a été jugé. Initialement, il y avait en effet aussi la volonté de poursuivre les responsables militaires et pas les seuls terroristes. En fait pour l’instant, il y a quelques militaires qui sont sous jugement militaire, mais il ne se presque passe rien du point de vue des procès et du Droit Pénal. Du côté des réparations, ce fut très compliqué. Un conseil des réparations s’est mis en place, mais qui dépend du Conseil des Ministres. Ce dernier a plus ou moins d’autonomie vis-à-vis du gouvernement en place à présent qu’Alan Garcia est revenu au pouvoir (il a l’ un des Présidents du conflit armé entre 1985 et 1990, et a été réelu en 2006). Alan Garcia est aussi chargé de gérer les réparations. On établit depuis deux ou trois ans un registre unique des victimes. Il y a des milliers de personnes qui seront indemnisées individuellement, mais il faut savoir que c’est compliqué car il existe treize voire quinze façons d’être “victime”. Et pour se faire reconnaitre comme “victime”, il faut d’abord savoir lire et savoir comment déposer une plainte, ce qui complique encore le processus. Être victime devient presque une identité performative.
Il existe une séparation complète entre les gens qui font parti du Sentier Lumineux ou du MRTA et le reste de la société civile. Ceci peut se comprendre, cependant les actions de violence sont différentes: le MRTA est jugé responsable de moins de 2% des morts. Sentier Lumineux et le MRTA, du point de vue des pratiques violentes, ce n’est pas la même chose. Mais ils sont apréhendés de la même façon socialement : en prison. Au cours de leur incarcération, détention, interrogation, les hommes et les femmes subissent des violences, les femmes plus que les hommes. Ce sont des vraies pratiques de tortures, universelles, transnationales: des brûlures de cigarettes sur les têtons, des viols, des déshabillements forcés, la baignoire dans laquelle tu es plongé jusqu’à la limite de la noyade. Au moins 80% des personnes arrêtées ont subi à des degrés plus ou moins fort ce type de violence et ils n’ont pas le droit de recevoir le statut de victimes. Il y a un an Sofia Macher, une des personnes importantes de la Commission de Vérité, a déclaré que si le Pérou est une vraie démocratie, il faut reconnaitre ces abus. La violation les Droits de l’Homme ne prend pas en compte l’engagement politique des personnes. (On revient dans le débat de ce qu’est le droit concernant la portée symbolique des actes). Ceci a fait scandale et on n’en reparle plus mais c’est quand même encore latent, s’il n’y a plus beaucoup de prisonniers politiques encore incarcérés aujourd’hui, il y a les familles derrières.
Au Pérou on a un système de justice transitionnelle de réparation et d’indemnistation qui se met en place depuis 2003, depuis le rapport public de la Commission de Vérité. Cela à commencé par des réparations individuelles puis collectives mais qui ne prend pas encore réellement en compte la partie réconciliation : Comment réhabilite t-on ceux qui ont été jugés “ennemis de la patrie” ? Qu’est-ce qu’on fait de cette “culture” alternative qui s’est élaborée au sein des groupes rebelles basées sur les histoires et les expériences qui se reproduisent dans les familles et dans l’imaginaire populaire. Il existe une polarisation, encore aujourd’hui, entre les “méchants et les gentils”. Bien que la plupart des intellectuels et des professionnels sont bien conscients que ça ne fonctionne pas de cette façon, il existe une opinion publique et une manipulation d’informations tellement rodée et forte que ces barrières-là ne sont pas depassées. Il y a aussi le passé de violence extrême, ce n’est donc pas que de la manipulation politique, ça vient aussi d’un vécu de la violence en particulier qui traumatise l’ensemble d’une nation et dont les séquelles ne sont pas prises en charge.
Carolina Vergel : En Colombie, la situation est complexe. Nous avons connu différents processus de négociations caractérisés par une réconciliation et des réparations apportées aux victimes très différentes. Ils obéissent à des rapports de force très différents et à des moments et des contextes très différents. Ce langage qui nous paraît aujourd’hui être un langage commun: “verité”, “justice”, “réparation”, est un langage à la fois très récent et très mobilisé aujourd’hui. Ceci est devenu un phénomène de mode avec la création et l’apparition de toute une série de centres comme les think tanks de résolution de conflits armés, de transitional justice. Il y a deux courants, un allemand et un nord américain, qui ont commencé a théoriser ce sujet. La plupart des centres et des ONGs spécialistes de la question sont plutôt d’origine anglosaxonne, des Etats Unis surtout, parfois très liées à une philosophie des églises protestantes. Ils sont très impliqués dans la médiation des conflits depuis un moment et cela surtout en Amérique Centrale. Il y a une véritable recherche à faire: A partir de quel moment ces termes s’installent dans l’espace public d’opinion en Colombie? Qui les utilise?
A ce sujet, le conflit colombien étant si long, il a connu plusieurs étapes. Les rapports de forces n’étaient pas les mêmes au moment de la démobilisation des premières guérillas dans les années 1980. Personne ne s’est posé la question concernant la réparation des victimes. Certains militants des guérillas sont devenus des élites politiques du pays aujourd’hui: sénateurs de la république, fondateurs de partis politiques au niveau régional, maires, gouverneurs, etc. D’autres cependant ont dû se réfugier à l’étranger.
Il y a eu un autre moment encore plus politisé: la rédaction de la réforme constitutionnelle de 1991: pacte politique inoui qui a permis de créer une juridiction indigène et la représentation obligatoire des communautés indigènes et noires au sein du Parlement. Il y eut une diversité énorme de partis politiques et une autre guérilla qui s’est demobilisée, le M19, dont les leaders étaient des universitaires de classe moyenne assez aisée. Un des dirigeants de cette guerilla (Antonio Navarro Wolf) a été un des présidents de l’Assemblée Constituante, un ancien guérillero qui a été par la suite élu au sénat.
Le M19 est l’acteur de la prise en otage du Palais de Justice qui a fini par une réponse disproportionnée de la part de l’armée gouvernementale: un incendie et une massacre énorme. Ce qui provoqua un scandale et d’ailleurs beaucoup de personnes ont disparu: elles sont sorties vivantes du Palais mais elles ont été torturées par l’armée. A partir de cela on tire des conclusions, on dit que les pires excès venaient de l’armée et non de la guérilla. Tout cela pour dire que les actes violents du M19 n’ont pas empêché la réintégration de ses membres surtout au niveau politique, ils ont d’ailleurs créé des partis politiques.
Ces processus de négociation sont caractérisés par une paix partielle mais ils étaient revêtus d’une légitimité assez large. Au moment de la mise en place de la nouvelle loi et des processus de démobilisations des groupes paramilitaires par le gouvernement d’Alvaro Uribe, tous ces concepts de “réparations des victimes”, “verité”, “justice”, viennent d’une influence internationale. Mais aussi d’un type de violence différent venu des paramilitaires et des FARCs, c’est une transformation de la guerre et du type de violence.
L’actuel processus de négociation consiste à démobiliser des paramilitaires. C’est un processus très contesté car il exclut les FARCs. Il ne concerne que les paramilitaires. La loi qui a légalisé ce processus était très contestée au Parlement, par rapport au milieu militant et au mouvement de défenseurs des Droits de l’Homme et aussi des Femmes. Ceci a polarisé et divisé le mouvement en deux. Les organisations de femmes ont des opinions partagées. Un premier groupe affirme que c’est un processus très contestable qui limite les droits des victimes (notamment pour porter plainte) et conduisant à légaliser des criminels. Mais malgré tout cela elles estiment que c’est une opportunité, car si elles laissent passer cette occasion, elles ne seront pas entendues. D’un autre coté, il y a des organisations qui estiment que participer revient à légitimer un processus qui ne mérite aucune légitimité, donc elles contestent, critiquent cette loi et n’encouragent pas les hommes et femmes à porter plainte. Nous sommes au centre d’un dispositif appelé “justice transitionnelle” qui est mobilisé dans le discours des acteurs. Mais ce concept de “justice transitionnelle” est critiquable car, à partir de quel moment peut-on parler de transition? C’est un concept flou. On peut évoquer à ce sujet les travaux d’un historien appelée Guillaume Mouralis qui a travaillé sur le procès de l’épuration allemande, et qui démontre que ces procès dites “alternatifs”, “différents” et qui proposent une justice différente s’effondre d’une certiane manière car ils se font par les juges qui font déjà parti de l’ancien système judiciaire. Ce n’est qu’une hypothèse à explorer…
7. LE TERRAIN
Rita: Vous avez travaillé sur des terrains sensibles car conflictuels et vous êtes des femmes qui travaillent sur des femmes, en quoi ça peut être un avantage ou un inconvénient?
Camille Boutron : Je ne considère pas mon terrain plus sensible qu’un autre, car un terrain sensible pour moi c’est quand tu risques vraiment ta vie. Alors oui, évidemment, il est sensible “émotionnellement”, mais il n’y a pas un terrain qui ne le soit pas. Je ne pense pas qu’il y ait de terrain plus sensible qu’un autre, ça dépend tellement de la personne qui effectue son terrain, on a tous des degrés de tolérance différents. Il n’y a pas de règle, ceci dépend de tout un chacun. Dans mon terrain j’allais interroger des personnes considérées comme des monstres, et du coup, elles sont plutôt contentes que tu ailles les voir ça leur donne l’impression d’une certaine manière d’être réhabilitées dans leur histoire, et ça se passe généralement très très bien.
Rita: Et de femme à femme?
Camille Boutron : Je ne pense pas qu’un homme aurait pu réaliser ma thèse, enfin non, je ne pense pas qu’il aurait fait la même thèse. Un homme peut visiter les prisons de femmes, mais il n’a pas du tout les mêmes droits, il ne peut rendre visite que dans le patio et est surveillé de beaucoup plus près par le personnel pénitentiaire. Alors qu’une femme peut aller partout. Le fait d’être une femme a plutôt joué en ma faveur, mais aussi celui d’être consciente de mes limites émtionnelles, intellectuelles etc... Le terrain n’est pas qu’une question de genre, il faut se connaître soi.
Rita: As-tu rencontré ces femmes lorsqu’elles sont sorties de prison, est-ce que ça a changé vos rapports?
Camille Boutron : Les relations n’ont pas tellement changé car j’ai interrogé des femmes du MRTA qui étaient sorties, mais la prison tu n’en sors jamais et moi je faisais partie pour ces femmes du monde de la prison et du monde militant. Les règles de mise en rapport sont donc restées sensiblement les mêmes.
Carolina Vergel : Mon terrain n’est pas un terrain risqué et j’ai choisi de ne pas faire un terrain risqué. Ce statut de femme qui part en France et revient me permet de me détacher de ce milieu militant. Avoir fait partie à un moment donné de ce monde et y revenir m’a permis d’avoir de vraies connexions, d’avoir des rapports riches, variés et intimes.
Ma recherche vient de la question: Pourquoi les gens font confiance à la justice en Colombie? Et de la volonté de rendre la compréhension du droit plus humain. Être femme m’a beaucoup aidée car j’ai pu intégrer le milieu féministe activiste qui, au moins dans mon terrain, est exclusivement féminin.
Camille Boutron : Tu n’as pas de bonnes informations si tu n’as pas d’intimité avec les gens, et être un homme et créer une intimité avec une femme dans un tel contexte, ce n’est pas évident. Mais un homme peut avoir accès à d’autres choses très complémentaires.
Boutron Camille et Vergel Carolina, « Inégalités, Subjectivités et Genre », RITA, N°2 : août 2009, (en ligne), Mis en ligne le 01 août 2009. Disponible en ligne http://www.revue-rita.com/content/view/62/116/
et retranscrit par Luisa Sanchez et Julie Liard.



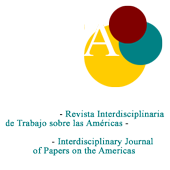








 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8