Raquettes antifascistes et maillots rouges. Le dilemme italien face à la finale de la Coupe Davis de 1976 à Santiago du Chili
Résumé
En décembre 1976, à Santiago du Chili, l'équipe italienne de tennis remporte une victoire historique et controversée en finale de la Coupe Davis. Ce match se déroule à l'Estadio Nacional, un lieu tristement célèbre pour avoir été le théâtre de répression sanglante contre les opposants politiques sous la dictature. La participation de l'équipe italienne suscite une vive controverse. Une grande partie de l'opinion publique en Italie, ainsi que les partis de gauche comme le PCI et le PSI, voient ce déplacement comme un acte de légitimation du régime chilien. Les critiques s'intensifient à travers des manifestations, des interventions syndicales, et des prises de position de personnalités publiques relayées dans la presse. Selon les détracteurs, un boycott aurait renforcé la position italienne contre le régime, surtout que la Péninsule se distinguait au sein de l'OTAN par sa ferme opposition à la Junte militaire, étant le seul pays à ne jamais reconnaître le gouvernement issu du coup d’État, et ce, jusqu'au retour à la démocratie. Cette finale devient ainsi un point focal des tensions, comme le montrent les articles de presse, les documents gouvernementaux et les archives des ministères des Affaires étrangères consultés jusqu’à ce jour.
Mots-clés : Diplomatie ; Tennis ; Dictature ; Relations italo-chiliennes ; Guerre froide.
Raquetas antifascistas y camisetas rojas. El dilema italiano ante la final de la Copa Davis de 1976 en Santiago de Chile
Resumen
En diciembre de 1976, en Santiago de Chile, el equipo italiano de tenis consiguió una histórica y controvertida victoria en la final de la Copa Davis. Este partido se celebró en el Estadio Nacional, un lugar tristemente célebre por haber sido escenario de la represión sangrienta contra los opositores políticos bajo la dictadura. La participación del equipo italiano generó una gran controversia. Gran parte de la opinión pública en Italia, así como los partidos de izquierda como el PCI y el PSI, vieron este viaje como un acto de legitimación del régimen chileno. Las críticas se intensificaron a través de manifestaciones, intervenciones sindicales y declaraciones de personalidades públicas difundidas en la prensa. Según los detractores, un boicot habría reforzado la postura italiana contra el régimen, especialmente porque Italia se distinguía dentro de la OTAN por su firme oposición a la Junta militar, siendo el único país que nunca reconoció al gobierno surgido del golpe de Estado, hasta el retorno a la democracia. Esta final se convirtió así en un punto focal de tensiones, como lo demuestran los artículos de prensa, los documentos gubernamentales y los archivos de los ministerios de Relaciones Exteriores consultados hasta el día de hoy.
Palabras clave: Diplomacia; Tenis; Dictadura; Relaciones italo-chilenas; Guerra Fría).
------------------------------
Elisa Santalena
Maîtresse de conférences HDR
Université Grenoble Alpes
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Raquettes antifascistes et maillots rouges. Le dilemme italien face à la finale de la Coupe Davis de 1976 à Santiago du Chili
Je suis toujours stupéfait d’entendre des gens déclarer que le sport favorise l’amitié entre les peuples.
George Orwell
Introduction
Depuis des millénaires, le sport représente l'un des critères par lesquels chaque pays démontre sa force, sa richesse et sa vigueur face à l'adversaire. Mais où s'arrête le sport et où commence la politique ?
Il est indéniable que le sport occupe une place centrale au XXème siècle, lors duquel il est devenu un lieu privilégié pour véhiculer des messages politiques. L’écrivain George Orwell affirmait même que « le sport, c'est la guerre sans les coups de feu »[1]. Le romancier britannique en savait quelque chose, lui qui fut d'ailleurs parmi les premiers à utiliser l'expression « Guerre froide »[2]. Pendant la guerre froide, le sport est devenu un terrain de confrontation symbolique entre les blocs de l’Est et l’Ouest, afin de montrer la supériorité idéologique et politique de chaque camp.
Dans ce contexte, la participation à un événement international devint de plus en plus un gage de légitimité et de reconnaissance internationale, et l'exclusion d’une compétition, un signe de faiblesse, voire de culpabilité. C'est à ce moment que l’utilisation du boycott s’intensifia, devenant l’instrument privilégié pour exprimer une position politique tranchée. La compétition athlétique fut souvent reléguée au second plan, et l’organisation des négociations ou la transmission des informations entre les délégations des États prit parfois le dessus. Pour ne citer qu’un exemple emblématique parmi tant d’autres, il est intéressant de mentionner les Jeux olympiques de Moscou en 1980, où les États de l'OTAN retirèrent leurs délégations en raison de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS. Quatre ans plus tard, à Los Angeles, ce fut aux membres du Pacte de Varsovie de ne pas se présenter, en représailles contre le sentiment antisoviétique occidental (Vonnard, 2018).
Parmi les effets les plus recherchés par le boycott, il y a donc la volonté de pousser l'ennemi à assouplir sa position politique dans le but d’entamer un dialogue ou, faute de mieux, de couper toute communication par une démonstration de force qui explicite l'hostilité à son égard, faisant preuve de supériorité morale.
Mais pourquoi la diplomatie devrait-elle s'appuyer sur des événements sportifs pour parvenir à ses fins ?
L'une des raisons réside dans la grande visibilité des compétitions, souvent mise en relation avec le rôle joué par les sportifs eux-mêmes, qui servent d’amplificateurs d’un affrontement lorsqu’ils véhiculent des messages politiques. Cependant, il ne faut pas oublier l'imprévisibilité des manifestations sportives, surtout celles de grande envergure, qui échappent souvent au contrôle des fédérations et des pays hôtes. Cette imprévisibilité réside dans la liberté d'action des athlètes eux-mêmes, dont la volonté peut devenir une variable décisive dans la diffusion de messages parfois contraires à ceux de l'État qu'ils représentent en compétition. Évoquons à ce propos les Jeux olympiques de Mexico en 1968 : lors de la cérémonie de remise des prix de l'épreuve masculine du 200 mètres, les athlètes étasuniens Tommie Smith et John Carlos baissent la tête en signe de protestation contre leur propre pays et lèvent leurs poings gantés de noir, symbole des Black Panthers, le parti d'action pour les droits des afro-américains. Ce geste, qui eut des répercussions considérables tant au niveau national qu’international, n'avait été ni orchestré par le mouvement des droits civiques afro-américains ni prévu par la délégation américaine. Comme nous le savons, les athlètes subirent de lourdes conséquences pour leur acte de militantisme, étant déchus de leurs médailles.
Un dernier facteur que nous voulons évoquer avant de rentrer dans le mérite de cette recherche, et qui contribue à son tour à faire du sport un outil diplomatique, est sa nature hautement combative.
Délimité par des règles précises, l’objectif principal du sport, n’en déplaise à Pierre de Coubertin, est celui de gagner une compétition. Il s’agit alors d’une véritable transposition d’un rituel guerrier, une bataille où la seule chose qui compte est de réussir à disqualifier, sportivement et politiquement, l'adversaire. Bien que l'on tente de le présenter comme neutre, le sport demeure encore de nos jours un outil puissant pour afficher la supériorité d'une idéologie politique sur une autre, ou pour dénoncer les violations des droits humains perpétrées par un gouvernement. Les récents débats autour de l'exclusion des athlètes russes des compétitions internationales en sont une preuve éclatante.
Analysons à présent les événements qui jettent un éclairage sur notre sujet et enrichissent notre compréhension des relations entre l'Italie et le Chili durant la période de la dictature chilienne. Dans ce puzzle complexe et multiforme, comme nous allons le voir, nous souhaitons ajouter une nouvelle pièce en retraçant l'histoire d'une finale de Coupe Davis qui a marqué durablement l'histoire sportive et diplomatique italo-latino-américaine. Ce match s'est déroulé à Santiago du Chili le 19 décembre 1976, trois ans après le coup d'État civil-militaire. Les protagonistes principaux de cet événement ne sont pas, comme on pourrait le penser, uniquement les joueurs. La Junte militaire, la Démocratie chrétienne chilienne et italienne, tout le spectre politique de la gauche italienne, sans oublier Moscou et le Parti communiste chilien (PCCH) clandestin, ont été les acteurs les plus représentatifs de cette histoire.
Cette finale, contre toute attente, devint un indicateur de la sensibilité sociale et politique de la Péninsule, mettant en lumière les tensions liées aux droits de l'homme et aux relations diplomatiques avec le Chili, ces dernières ayant été suspendues depuis le 11 septembre 1973. Dans les heures qui suivirent le coup d'État, en effet, le gouvernement italien, dirigé depuis l'après-guerre par la Démocratie chrétienne (DC) et soutenu à l'époque par le Parti socialiste (PSI), dut avancer avec une grande prudence sur plusieurs fronts[3]. Il ne s'agissait pas seulement de gérer les tensions avec ses alliés, mais aussi, et peut-être plus encore, de répondre aux pressions exercées par le Parti communiste italien (PCI) et la gauche extra-parlementaire – notamment Lotta Continua – qui exhortaient le Premier ministre Mariano Rumor et le ministre des Affaires étrangères Aldo Moro à refuser de reconnaître le gouvernement issu du putsch. Il était également crucial de maintenir des relations avec le Partido Demócrata Cristiano (PDC) chilien, un parti que la Démocratie chrétienne italienne avait toujours soutenu, aussi bien moralement que financièrement, malgré les prises de position embarrassantes qu'il avait adoptées durant son opposition farouche au gouvernement de l'Unidad Popular (Giorgi Luigi, 2018 : 28-31)[4].
Avant d'entrer dans le vif de cette situation inédite, et plus précisément de cette finale, il convient de mentionner un dernier événement qui ferma la porte à toute reconnaissance du nouveau régime. L'ambassadeur Norberto Behmann Dell'Elmo, socialiste convaincu et fervent soutien d'Allende, avait quitté l'ambassade d’Italie à Santiago le 7 septembre 1973 pour des raisons familiales urgentes. Son retour n’eut jamais lieu, car un tel geste aurait pu être interprété par la Junte comme une reconnaissance politique et diplomatique, une situation que Rome voulait à tout prix éviter. Dès lors, seules des diplomates de rang inférieur étaient restés sur place, chargés de la gestion des affaires courantes, puis de l’arrivée massive des chiliens et chiliennes fuyant la répression et se cachant dans les différentes ambassades (De Masi, 2013).
En décembre 1976, les rapports bilatéraux étaient donc paralysés depuis trois ans. Un déplacement de l'équipe de tennis à Santiago paraissait difficilement envisageable.
I. Sport ou diplomatie ? Le spectre de la dictature chilienne s’avance sur la finale
En 1976, la Coupe Davis, la plus prestigieuse compétition de tennis par équipe masculine, a représenté un tournant décisif pour l'équipe italienne, qui a enchaîné une série de victoires historiques, gravant son parcours dans les annales du sport. Cependant, dès les premiers matchs, le spectre d’une finale dans l’Estadio Nacional de Santiago du Chili se dessine, le plus grand centre de détention clandestine et de torture mis en place par la dictature dès les premières heures qui suivent le coup d’État[5].
Dès le 9 août 1976, après la victoire à Wimbledon qui laisse entrevoir une participation à la finale, Il Corriere della Sera, alerte ses lecteurs sur un éventuel problème qui, à première vue, a peu à voir avec le sport. D'après le journal, le secrétaire de la fédération italienne de tennis, Gianfranco Cameli, ne doit pas seulement s'inquiéter du résultat du match opposant son équipe à l'Australie mais aussi, voire surtout, en cas de qualification, du fait que l'Italie n’a pas de représentation diplomatique au Chili. Selon le journaliste Daniele Parolini, le tennis italien doit donc se préparer « à affronter une histoire politique peu réjouissante » en soulignant que, dans ce genre de situation, « le sport est généralement condamné »[6]. Cette déclaration pourrait sembler incongrue si l'on ignore les tensions diplomatiques et politiques sous-jacentes depuis septembre 1973. Depuis trois ans, la Junte chilienne se heurte à l'absence de reconnaissance officielle de la part de l'Italie, une situation qui se révèle être une épine dans le pied sans solution apparente. Cependant, selon l'article, qui ne fournit pas davantage de détails, la rigidité de la position italienne commencerait à montrer des signes de faiblesse.
Une éventuelle finale Italie-Chili pourrait-elle permettre de sortir de l'impasse et de rétablir les relations bilatérales entre les deux pays ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais il est certain que la presse italienne, ainsi que, comme nous le verrons, tous les partis politiques, s'interrogent sur cette situation diplomatique – et désormais sportive - sans précédent. Si, comme le suggère le journaliste du Corriere, le sport est la première victime dans ce genre de situation, une possible finale ne pourrait pas-t-elle, au contraire, se transformer en une opportunité à exploiter pour changer cette situation ? Après tout, si diplomatie est bloquée, les relations commerciales avec le Chili, notamment l’importation du cuivre, n’ont jamais été totalement interrompues[7].
Le second spectre qui plane sur cette finale est la possible défection de l'Union soviétique, qui, en cas de victoire contre la Hongrie, pourrait refuser d'affronter le Chili.
Les Soviétiques avaient déjà boycotté l'équipe andine lors des éliminatoires de la Coupe du monde de football en 1974. À cette occasion, il était prévu que les deux formations jouent un match de barrage le 26 septembre 1973, peu de jours après le golpe qui avait, par ailleurs, provoqué la rupture des relations diplomatiques avec le Kremlin. Le nouveau régime, qui avait décrété l'interdiction pour tous les Chiliens de quitter le territoire, autorisa l’équipe à se rendre à Moscou avec l'intention de donner une image de normalité, mais à une condition ferme : aucun commentaire politique (Vilches, 2017 : 133). Le match aller, qui se termina sur le score de 0-0, se joua dans un stade Lénine vide, les autorités soviétiques ayant interdit aux journalistes et aux caméras d'entrer dans l’enceinte. Quant au retour, la fédération chilienne avait initialement envisagé la possibilité de déplacer le match à Viña del Mar, pour vaincre la résistance de l'URSS à jouer dans un stade taché du sang des Chiliens torturés et tués par la dictature[8]. Cependant par décision d’Augusto Pinochet, le match se déroula à Santiago[9]. L’équipe soviétique ou, plutôt, sa fédération, décida de ne pas faire le déplacement, invoquant des raisons éthiques. Le match, qui prendra le nom de partido fanstasma, eut tout de même lieu le 21 novembre : l’équipe chilienne joua contre un adversaire inexistant en marquant un but dans une cage vide, en se qualifiant pour la Coupe du monde en Allemagne de 1974. Par cette même occasion, le Chili décrocha le triste record du match de football le plus court de l'histoire de la FIFA (Pickett Lazo, 2003)[10].
Pour revenir à la Coupe Davis, les règles concernant le boycott, pour ceux qui renonçaient à jouer, y compris pour des raisons humanitaires, étaient sans appel. Si l'URSS décidait de ne pas disputer le match à Santiago, elle risquait d'être suspendue comme l'avait déjà été le Mexique, qui préalablement avait refusé de rencontrer l'Afrique du Sud pour manifester son opposition à l'Apartheid. En vue des Jeux olympiques que Moscou allait accueillir en 1980, Brežnev semblait, dans un premier temps, favorable à un match sur terrain neutre contre l’équipe andine, annonçant que son pays accueillerait tout le monde, le moment venu. Mais le 1er septembre, l'URSS annonça son retrait du match contre le Chili : la tant attendue détente sportive n’allait pas avoir lieu. Ce ne fut que le début des péripéties : les Sud-Américains, désormais finalistes par défaut, allaient devoir affronter, et qui plus est à domicile, l’équipe gagnante entre l'Italie et l'Australie. La menace d’une possible victoire du saladier d’argent par forfait, comme en 1974 quand l’Inde s’était refusée de jouer contre l'Afrique du Sud, refaisait surface, avec le risque de dénaturer de façon permanente le tournois[11].
L’Italie, pouvait-elle adopter la même position que l’URSS qui, entre temps, avait été évincée par le comité de direction de la Coupe Davis de l’année suivante ?[12] Cette mesure constituait une menace d'exclusion à peine voilée à l'encontre de l'Italie en cas de refus de se rendre à Santiago pour disputer la finale.
Quant à la communauté italienne vivant au Chili, elle réclamait une normalisation des rapports entre les deux pays depuis la première heure, et ses représentants ne cessaient d’envoyer des réclamations aux institutions italiennes. Lettres dans lesquelles, justement, on accusait le gouvernement italien – alors qu’il était dirigé par la DC – de sympathies marxistes[13].
En décembre 1973, une quarantaine d’italiens menés par Luigi Di Castri, ancien fasciste et président du « Comitato Tricolore », étaient passé à l’acte après les menaces, et avaient occupé les bureaux de l’ambassade à Santiago en prétendant assumer le contrôle des activités diplomatiques. Piero De Masi, chargé d’affaires qui assurait la gestion des asilados cachés dans la Résidence dans l’attente des sauf-conduits qui les amène en Italie, fut accueilli par des crachats, au cri de « servo di Mosca, tornatene in Russia ! »[14].
Trois ans après ces événements, était-il vraiment judicieux de risquer de nouveaux incidents de ce genre, alors que le monde du sport et les gouvernements internationaux observaient de près la décision de l'Italie de participer ou non ?
Bien que l’équipe péninsulaire ne soit pas encore qualifiée pour la finale, les relations italo-chiliennes occupaient désormais toutes les pages sportives des grands journaux italiens, d’autant que la Péninsule était liée au sous-continent par des liens d'amitié traditionnels découlant des origines culturelles communes, de l'absence d'héritage colonial, de la présence de nombreuses communautés d'origine italienne bien intégrées, des investissements importants réalisés au fil du temps par les grandes entreprises italiennes et des initiatives de coopération culturelle, universitaire et technologique (Serafín, 2010).
Le « nouveau monde » était apparu à l’horizon de la politique étrangère et culturelle nationale avec la visite officielle du ministre des Affaires étrangères Giuseppe Pella à Montevideo, en novembre 1957[15]. Depuis ce moment, les rapports n’avaient cessé de croître et de se structurer, touchant également le Chili, notamment lors de la naissance du Partido Democrata Cristiano. Ce dernier était rapidement devenu un allié de taille pour la DC en Amérique latine (Nocera, 2015). Toutefois ce rapport privilégié avait risqué de voler en éclats le 13 septembre 1973, quand Patricio Aylwin, président du PDC et futur premier Président chilien après la fin de la dictature, avait publié un communiqué. Dans celui-ci, il attribuait les événements qui secouaient le Chili aux désastres économiques, au chaos institutionnel, à la violence armée et à la crise morale engendrés par le gouvernement d’Allende[16]. Ce document assurait le nouveau gouvernement de la pleine coopération du parti, dans l’indispensable effort de reconstruction nationale, tout en ambitionnant que les militaires ne tardent pas à laisser la place à un gouvernement reflétant la volonté du peuple par le biais de élections libres. Amintore Fanfani avait immédiatement fait savoir – haut et fort – que la réaction du parti-frère « n’était pas appropriée à la gravité des événements »[17]. Quant aux socialistes et aux communistes italiens, ils définissaient le communiqué du PDC de « honteux »[18].
Cette non-reconnaissance, véritable la toile de fond de la vie à l’ambassade d’Italie à Santiago, qui sera privée de son ambassadeur jusqu’au retour de la démocratie, en 1989, avait fini par provoquer une réaction explosive au fil du temps, en raison des actions humanitaires menées par les diplomates italiens en faveur des asilados cachés dans la légation. La légitimité de la mission italienne avait été à plusieurs reprises remise en question par le gouvernement militaire. La politique intérieure de la Péninsule était également discutée en profondeur dans la presse andine, notamment concernant les grèves, les manifestations et la violence politique montante[19], dans le but de montrer à la population chilienne que l’Italie ne reconnaissait toujours pas la Junte, ce n'était pas à cause d'un désaccord avec les actions de cette dernière, mais à cause du marxisme qui dominait la sphère politique péninsulaire.
Cette situation hors du commun, bien loin d’être résolue en 1976, ne pouvait qu’envenimer le tournoi international en cas de finale entre les deux pays.
II. Une défaite sportive équivaut-elle à une victoire ?
En Italie, la nouvelle du forfait soviétique entraîna la demande de disputer le match sur terrain neutre, alors qu’Adriano Panatta, le joueur le plus représentatif de l’équipe ainsi que ses coéquipiers, n’avaient toujours pas disputé le match contre l’Australie. L’éventualité de ne pas jouer, et donc d’un boycott, semblait toutefois exclue, tant par la direction de la Fédération italienne (Federtennis) que par Nicola Pietrangeli, capitaine non joueur. Adopter une attitude similaire à celle de l'URSS aurait nui au tennis italien en le privant d'une victoire prestigieuse, la première de son histoire. En revanche, les opposants à la participation estimaient qu'un boycott aurait renforcé la position de l'Italie en réaffirmant son rejet de la Junte militaire.
Dans les colonnes du quotidien Repubblica, Pietrangeli balaya la controverse en qualifiant de « bouffons » ceux qui mêlaient politique et sport, ajoutant que l'Italie devait laver son linge sale chez elle, notamment au sein du ministère des Affaires étrangères. Il maintint cette position jusqu'à la fin du tournoi, ce qui lui valut des accusations de filo-fascisme et même des menaces de mort[20]. Ce « linge sale », à savoir la non-reconnaissance du gouvernement chilien, ne cessait de refaire surface dans la presse et, surtout, dans les coulisses du Parlement. Le gouvernement se trouvait ainsi pris en otage par les partis communiste et socialiste, qui prônaient le boycott et continuaient à faire pression pour empêcher le déplacement de l'équipe à Santiago. Cette pression était particulièrement forte du côté du PCI, qui avait obtenu 34,4 % des voix lors des élections législatives de juin 1976, un score en hausse de 5 points par rapport aux élections précédentes et le plus élevé de son histoire. Un Italien sur trois votait donc pour le parti communiste, et pour la première fois dans l'histoire de la République, un membre du PCI, Pietro Ingrao, avait été élu à la présidence de la Chambre des députés. Le gouvernement formé à l'été 1976, dirigé par Giulio Andreotti, un démocrate-chrétien de centre-droite, était ainsi le fruit de ce que l'on appelait la non-sfiducia. Cette « non-défiance » émanait des socialistes, des communistes, des sociaux-démocrates, des républicains et des libéraux, qui s'étaient abstenus de voter pour le nouveau gouvernement, sans pour autant vouloir provoquer une crise institutionnelle en cette période politiquement et économiquement délicate[21]. Cette démarche s'expliquait par le fait que le PCI n'était pas seulement le principal parti d'opposition, mais représentait également une menace croissante pour le pouvoir démocrate-chrétien et pour l'équilibre du pacte atlantique. En pleine guerre froide il était inconcevable que l'Italie soit dirigée par des communistes, dont l'influence ne cessait pourtant pas de croître. Il était primordial que l'Italie ne devienne pas un deuxième Chili, comme l'avaient compris dès le début Enrico Berlinguer et Aldo Moro. Ces deux figures ont incarné le pivot autour duquel se construirait cette alliance « contre-nature » entre la DC et le PCI, connu sous le nom de « compromis historique »[22].
On comprend alors pourquoi le gouvernement italien se montrait extrêmement prudant par rapport à la participation ou non de l'Italie à la finale de Santiago, tiraillé par des considérations politiques internes, humanitaires, ainsi que par des enjeux de politique étrangère.
Quant à la Fédération chilienne, ou plutôt la Junte, elle était pleinement consciente que les règles du jeu lui étaient favorables et qu’ils allait s’en servir pour faire pression sur l’Italie en vue d’accélérer une possible reconnaissance. Elle déclara donc, dès le départ, son intention d'accueillir la finale. De plus, c’était la première fois qu’une finale de Coupe Davis se jouait en Amérique latine, une opportunité que le régime ne pouvait laisser passer, avec les projecteurs du tennis international, et pas seulement, braqués sur lui.
Pour revenir aux questions purement sportives, le Chili disposait d'une équipe solide, avec des joueurs tels que Jaime Fillol, Patricio Cornejo, Jaime Pinto et Hans Gildemeister. Sur le papier, elle avait donc le potentiel d'aller loin, d'autant plus qu'elle avait bénéficié d'un match en moins en raison du boycott de l'URSS. De plus, la finale, prévue pour décembre en plein été austral, risquait de désavantager les adversaires en raison des fortes chaleurs. Quant à l’équipe italienne, elle se trouvait au meilleur de sa forme. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli et Paolo Bertolucci formaient une team redoutable ayant déjà battu la Pologne, la Yougoslavie, la Suède et l'Angleterre. Pour Panatta en particulier, qui avait avoué à la presse de voter socialiste, il s’agissait une année extraordinaire : il avait gagné les Internationaux de Rome ainsi que Roland Garros. Il était donc impensable que l'équipe renonce volontairement à la conquête du Saladier d'argent. Seul le gouvernement pouvait empêcher ce voyage, qui pourrait la consacrer au sommet du tennis mondial.
La demi-finale contre l'Australie se jouait à Rome du 24 au 27 septembre et, comme prévu, l'Italie l'emporta 3-2, entraînant des polémiques de plus en plus vives. Le monde sportif et politique se partageait désormais entre ceux qui éprouvaient un « malaise moral »[23] à l’idée du déplacement à Santiago, et ceux qui ne voulaient pas renoncer à la possibilité d'arracher la finale au Chili, tant sportivement que politiquement.
Sous l'impulsion des mouvements extra-parlementaires et des forces d'opposition, le mouvement « anti’Italie » prit de l'ampleur et se propagea à travers toute l'Italie. Les dirigeants des partis, le CONI (Comité national olympique italien), les fédérations sportives nationales, ainsi que les forces sociales, syndicales, la télévision et la presse ne pouvaient plus se permettre de rester dans l'attente sans prendre position.
La CGIL, l'UIL, la Fédération unie de la métallurgie, ainsi que des journaux comme Tuttosport, Il Messaggero, L'Unità et L'Avanti rejoignirent le mouvement d’opposition au déplacement. Des personnalités telles que Giuseppe Fiori, journaliste à TG2, l'acteur Ugo Tognazzi, ainsi que les réalisateurs Gillo Pontecorvo – ancien tennisman de haut niveau – et le futur prix Nobel Dario Fo, apportèrent également leur soutien à la cause. Quant à La Gazzetta dello Sport et La Repubblica, elles demeuraient indécises. Sous la direction de son fondateur Eugenio Scalfari, cette dernière s'interrogeait sur l'opportunité de poser la question des droits de l'homme non seulement à Santiago du Chili, mais également en République démocratique allemande (RDA), allant même jusqu'à proposer une position d'équidistance : « Ni au Chili, ni à Berlin-Est ». Continuer à affirmer que le sport et la politique devaient être nettement séparés, comme le faisait l’équipe italienne et sa fédération, devenait désormais peu défendable.
Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que le monde sportif italien se trouvait confronté à la question d'un boycott. Pendant la saison 1975/76 l'équipe de football de la Lazio avait déjà refusé de jouer contre le FC Barcelone lors de la coupe UEFA, à la suite de l'exécution – par le régime franquiste - de cinq jeunes opposants[24]. La même année, au niveau international, outre le refus de l’URSS de se rendre au Chili, vingt-sept pays africains ainsi que l’Iraq avaient quitté les Jeux olympiques de Montréal pour protester contre la Nouvelle-Zélande, coupable d'entretenir des relations politiques et commerciales avec l'Afrique du Sud.
Les organes de propagande sportive liés aux partis communiste et socialiste, tel que l'ARCI (Association Récréative et Culturelle Italienne) et l'AICS (Association Italienne de la Culture du Sport), plaidaient en faveur de l'annulation du voyage. À leurs yeux, une éventuelle défaite sur le terrain se traduirait forcément par une victoire symbolique pour la dictature, renforçant ainsi sa légitimité aux yeux de la communauté internationale. Le quotidien socialiste L'Avanti dénonçait la proposition de disputer le match sur terrain neutre, la qualifiant d'hypocrite. Il appelait à une intervention directe du gouvernement pour interdire la rencontre, dans l'éventualité où le CONI (Comité National Olympique Italien) et la Federtennis ne prendraient pas une décision en ce sens. De son côté, le journal communiste L'Unità considérait le refus de se rendre au Chili comme un acte d’honneur que les sportifs et la fédération auraient dû être fiers d’adopter, en affirmant une position de principe contre la dictature. Selon le spectre de la gauche italienne, une délégation sportive ne pouvait pas se contenter d'une approche strictement compétitive, en ignorant les impératifs humains, moraux, sociaux et politiques. Représenter une nation démocratique impliquait de condamner fermement la dictature chilienne, et ne pas participer à la compétition était perçu comme un devoir éthique.
Pour toutes ces raisons, la question de la finale de la Coupe Davis était devenue une véritable affaire l'État.
Le Premier ministre, Giulio Andreotti, devait désormais s'en occuper, du moins selon le PCI et le PSI. De plus, si le gouvernement avait interdit le déplacement à Santiago, la Federtennis aurait ainsi évité la lourde sanction d'exclusion, qui menaçait les équipes renonçant à disputer un match[25]. Le secrétaire national de l’ « Association Italia Chile - Salvador Allende »[26], en soulignant que l'Italie persistait dans son refus de normaliser ses relations diplomatiques avec le Chili. Il insista sur la nécessité de dénoncer le fait que, trois ans après le coup d'État, le Chili continuait de plonger dans la misère, la terreur et la répression. Delogu exprima également ses craintes concernant le traitement que l’équipe italienne pourrait recevoir, en particulier dans un stade marqué par la violence, et il redoutait que des événements regrettables se surviennent[27].
Il est vrai que l'ambassade d'Italie, ainsi que son chargé d'affaires Tomaso de Vergottini, avaient déjà été au cœur d'une véritable campagne de dénigrement en 1974, en raison précisément de la ’on-reconnaissance de la junte militaire et, pire encore, pour avoir accordé l'asile à des membres du MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), dont Humberto Sotomayor[28].
Mais ce risque était-il encore réel en 1976, alors que toutes les ambassades à Santiago avaient cessé d'accueillir des réfugiés, la Junte refusant désormais de délivrer des sauf-conduits ? Ou bien était-ce le moment opportun pour normaliser les relations diplomatiques, en saisissant l'occasion offerte par la finale ? Cette interrogation se posait à un moment charnière, où la décision de participer ou de boycotter la compétition pouvait symboliser bien plus qu’un simple enjeu sportif.
Même le groupe musical Inti-Illimani, en exil en Italie depuis le coup d'État et qui depuis était devenu le porte-drapeau de la résistance chilienne dans la Péninsule, décida à son tour de rompre le silence en exprimant son opposition à la participation italienne à la finale du tournoi, au nom de tous les asilados présents sur le sol italien[29].
Mais alors que la polémique faisait rage, l'ancien sénateur démocrate-chrétien chilien Juan Hamilton Depassier, qui se trouvait en Europe, annonça que la Junte était sur le point de mettre hors la loi son parti, le PDC. De plus, Jaime Castillo Velasco, ancien président du parti et ancien ministre de la Justice se trouvait à Rome où il avait été interrogé par la rédaction du Corriere della Sera sur la question de la Coupe Davis. Il avait répondu : « Si des questions politiques entraient en jeu dans le sport international, il n'y aurait plus de compétitions. Je pense que les sportifs doivent pouvoir se rendre en tout lieux et témoigner des réalités qu'ils voient »[30]. Le PDC se positionnait donc en faveur de la participation italienne, estimant que celle-ci pourrait servir de plateforme pour dénoncer le régime chilien. Giulio Andreotti ne pouvait pas mieux demander pour se tirer de l’embarras.
De façon plutôt surprenante, si on évoquait toujours l'absence de réactions diplomatiques officielles avec Santiago, on ne mentionnait jamais le fait qu'il existait une ambassade chilienne à Rome, d'où l'on observait attentivement la diatribe en cours, en rapportant fidèlement les moindres détails au ministre des Affaires étrangères andin, Patricio Carvajal Prado, l'un des principaux instigateurs du coup d'État. Le 7 octobre 1976, le chargé d'affaires Carlos Mardones[31] rapporta qu’au cours d’une discussion informelle avec des fonctionnaires de la Farnesina, l’équivalent du Quai d'Orsay, on lui avait confirmé qu'il n'y aurait aucune opposition officielle de la part du gouvernement italien concernant le déplacement au Chili pour disputer la finale de la Coupe Davis[32].
Le 20 novembre, une quarantaine de militants de la gauche extraparlementaire appartenant au parti de l'Unité Prolétarienne pour le Communisme (PdUP) et de l'Avant-garde Ouvrière (AO) occupèrent symboliquement le siège de la Federtennis pour exhorter le gouvernement à ne pas demeurer sournoisement silencieux face à la mobilisation populaire de toutes les forces démocratiques décidées à empêcher le déplacement de l'équipe italienne à Santiago[33].
Malgré les protestations et la rupture des relations diplomatiques, l'Italie maintenait ses intérêts économiques en continuant à entretenir des relations fructueuses avec le Chili, notamment en poursuivant l'importation de cuivre. Et ce, envers et contre tout, car la presse nationale rapportait constamment les sabotages des navires chiliens par les dockers des principaux ports italiens, des informations systématiquement corroborées par les documents que Mardones transmettait à sa hiérarchie à Santiago[34]. L'Italie n'était certainement pas la seule à adopter ce comportement de Janus Bifrons. Cependant, ce qui la distinguait des autres pays occidentaux, et ce n'est pas un détail dans ce cas spécifique, c'était son obstination à ne pas reconnaître le gouvernement chilien ni à normaliser les relations diplomatiques, créant ainsi une situation encore plus embarrassante.
Est-il cohérent de refuser d'envoyer l'équipe italienne jouer à Santiago, tout en finançant la dictature par l'achat systématique de cuivre ?
III. Un dénouement heureux ?
À quatre semaines de la finale, prévue du 17 au 19 décembre, la situation était chaotique. Le 21 novembre, la chaîne publique TG2 annonçait une décision sans précédent : elle renonçait à acheter les droits de retransmission en direct de la finale. Son directeur, Andrea Barbato, expliquait que les images qui arriveraient du Chili seraient celles sélectionnées par un réalisateur choisi par le régime. Des drapeaux brandis à tout va et des spectateurs enthousiastes véhiculeraient une fausse image du pays andin, à savoir celle d'un pays joyeux et festif, ce qu’il fallait à tout prix éviter. Mais les rédacteurs en chef des principaux journaux sportifs avaient néanmoins décidé d'envoyer leurs journalistes à Santiago[35]. Quant aux principaux quotidiens, ils étaient loin de prendre une décision univoque. Arrigo Levi, par exemple, directeur de La Stampa et premier journaliste italien à avoir interviewé Salvador Allende après sa victoire aux élections présidentielles[36], prit résolument position contre l'envoi de joueurs au Chili. Indro Montanelli, directeur de Il Giornale, lié à la droite, ne cessait d’inciter au départ.
L'intervention directe du secrétaire communiste Enrico Berlinguer, en coordination avec son homologue socialiste Bettino Craxi, qui avait déposé une interpellation parlementaire pour empêcher le départ de l'équipe nationale de tennis, ainsi que les protestations populaires et la pression des syndicats, représentaient, une fois de plus, des signaux clairs que le gouvernement devait prendre position.
Le ministre des Affaires étrangères, M. Forlani, déclara que les compétitions sportives devaient se dérouler sans être influencées par des considérations politiques. Son opinion sur le régime chilien était celle d'un « démocrate » soutenant les forces engagées dans la reconquête de la liberté dans ce pays andin. Cependant, il estimait que le retrait des joueurs de tennis du Chili n'aurait pas renforcé la résistance au régime. Tout en comprenant l'indignation suscitée par la participation italienne, il croyait que cette approche aurait eu des conséquences plus nuisibles que bénéfiques, surtout compte tenu du grand nombre de régimes anti-démocratiques dans le monde. Pour conclure son intervention lors de l’interrogation parlementaire, le ministre affirmait que le maintien des compétitions sportives était, en fin de compte, bénéfique, pouvant servir « la cause de la démocratie plutôt que celle de la répression et de la tyrannie »[37].
Toutefois, au sein même de la Farnesina, et de la DC, un courant dissident continuer à s’opposer au départ. Carlo Fracanzani, secrétaire de la commission des Affaires étrangères de la Chambre, s'était opposé à la position de son propre ministre et camarade de parti. Il avait demandé au Premier ministre de se prononcer contre le départ de l'équipe italienne pour le Chili, soulignant ainsi les divisions internes au sein du gouvernement sur cette question épineuse. Selon lui, une telle prise de position était indispensable par solidarité avec les victimes de la dictature chilienne et aurait été cohérente avec l'attitude que le pays avait adoptée jusqu'à présent à l'égard du régime de Pinochet. Le gouvernement devait intervenir conformément au caractère antifasciste de la Constitution, censé inspirer également la politique étrangère du pays[38]. Le même Fracanzani s’était par ailleurs battu, dès le 12 septembre 1973, pour que le gouvernement maintienne un refus diplomatique-politique des intransigeants face à toute approbation du coup d'État[39]. Pourquoi une petite fraction de l'Italie sportive irait-elle au cœur d'une dictature liberticide, tortionnaire et sanguinaire, alors que l'Italie politique avait maintenu une position ferme dès le début ? Cette question résumait l'essence du dilemme auquel le pays était confronté. Tandis que le gouvernement avait refusé de normaliser ses relations diplomatiques avec le Chili de Pinochet, certains politiciens et les milieux sportifs, au nom de l'autonomie du sport par rapport à la politique, envisageaient d'envoyer l'équipe à Santiago. La dissonance entre ces deux réalités, reflétait les tensions internes d'une nation tiraillée entre ses principes moraux et la tentation d'une victoire historique.
Fin novembre, la seule solution acceptable semblait être, une fois encore, de jouer sur terrain neutre. Cependant, la Junte chilienne ne l’entendait pas ainsi. Les réactions à cette proposition furent immédiates : les autorités chiliennes s'y opposèrent fermement, considérant que, si l'équipe italienne déclarait forfait, le trophée leur reviendrait automatiquement. Pour elles, il n'était pas question de céder sur ce point, d'autant plus que cela aurait représenté une victoire symbolique pour le régime de Pinochet. Quant aux protagonistes du tournoi, selon Nicola Pietrangeli c’était inacceptable que l’équipe continue à être exposée à un risque d'impopularité et à une agression morale qu'elle ne méritait pas[40]. Plus la finale approchait, plus le nœud devenait inextricable.
Il est néanmoins crucial de souligner qu'aucun des partisans du voyage à Santiago, à l'exception des néofascistes du MSI (Mouvement Social Italien), ne se montrait solidaire de la Junte, ni ne lui reconnaissait la moindre légitimité, et encore moins ne troquaient la mémoire d'Allende contre un trophée. Cependant, le gouvernement continuait à tergiverser, ce qui poussa le célèbre journaliste Enzo Biagi à s'exprimer de manière cinglante : « si les Italiens, pour mépriser une dictature, doivent recourir à Panatta, c'est qu'ils ont gâché trente ans »[41]. Par cette déclaration, il faisait référence à l'héritage de la résistance italienne et aux trois décennies écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, soulignant ainsi l'ironie et l'inefficacité d'une telle situation, où des athlètes étaient érigés en symboles politiques face à une dictature.
Lassée des polémiques stériles et impatiente de remporter son premier Saladier d'argent, l'équipe italienne, soutenue par la Federtennis, prit la décision de se rendre à Santiago début décembre, escortée par une protection militaire et sans attendre une prise de position officielle de la part du gouvernement. Bien que le capitaine Nicola Pietrangeli continuât de défendre l'idée que le sport devait rester indépendant de la politique, le simple fait de prendre l'avion pour la capitale chilienne, en pleine tempête médiatique et diplomatique, constituait en soi une prise de position évidente. Le 7 décembre, sans trop de surprises, le gouvernement accepta que les joueurs italiens participent à la finale, en soulignant que la politique devait à tout prix se tenir à l'écart du sport. Un communiqué de presse réitérait la ferme condamnation du régime militaire, ainsi que sa sympathie pour le peuple chilien mais également pour la communauté italienne résidant au Chili, en difficulté suite à l’absence de rapports bilatéraux[42].
La réaction la plus véhémente arriva du secrétaire du PSI, Bettino Craxi, qui s'étonnait que le gouvernement veuille « soutenir les Italiens de Santiago »[43], alors que les représentants de la communauté, dans les jours suivant le coup d'État, avaient fait paraître une annonce payante dans les journaux locaux pour proclamer leur joie face à la « libération » réalisée par Pinochet, en l’assurant de leur entière solidarité.
Dans une dépêche de l'ambassade du Chili à Rome datée du 9 décembre, il était indiqué, non sans une certaine satisfaction, que le gouvernement italien maintenait la position qu'il avait adoptée depuis le début. Cependant, comme le soulignait Carlos Mardones, on aurait pu penser que la campagne qu'il qualifiait d’« anti-chilienne » menée par la gauche « marxiste » se serait essoufflée plus rapidement[44].
À ce stade, les décisions étant prises, il ne restait plus qu’à jouer — et surtout remporter — la finale. Du moins en théorie, car un nouveau dilemme surgissait dans la pratique. Les joueurs eux-mêmes se demandaient comment réagir en cas de victoire, notamment si c'était Pinochet qui devait leur remettre le trophée. Comment imaginer serrer la main du dictateur devant les caméras du monde entier, en tant que représentants d’un pays qui n'avait pas de relations diplomatiques avec son régime ? Fort heureusement, et avec toute probabilité pour éviter d’empirer la situation, les Italiens furent tirés d'affaire par le dictateur lui-même : Pinochet n'assisterait pas à la finale au Estadio Nacional, et la Junte serait officiellement représentée par le général de l’Armée de l’Air Gustavo Leigh Guzman[45]. De plus, dans un effort d'apaisement, il fut décidé que la remise du trophée serait confiée au président de la Fédération internationale de tennis, Derek Hardwick. Le chargé d'affaires du ministère italien des Affaires étrangères lui-même, Tomaso De Vergottini, évita à son tour de prendre place dans la tribune d'honneur, afin de contourner tout contact avec les membres du régime[46].
À Santiago et à Rome, les projecteurs se tournèrent ainsi sur le terrain de terre battue plutôt que dans les coulisses diplomatiques.
Le 17 décembre 1976, l'équipe italienne fit son entrée dans l'Estadio Nacional : deux jours plus tard, elle en ressortirait remportant sa première Coupe Davis sous les applaudissements enthousiastes des six mille spectateurs[47].
Sur le plan sportif, la finale se déroula dans une atmosphère de grande civilité. Sur le terrain, il n'y avait pas eu la moindre instrumentalisation de l'événement. Aucun’ soldat - à l'exception du service de sécurité - ne se trouvait sur les lieux. Le général Leigh lui-même, s'était contenté d'assister aux matchs habillé en civil. Álvaro Fillol et Patricio Cornejo furent des exemples d'équité et de courtoisie à leur tour : rarement une finale de Coupe Davis n'avait connu un tel cadre harmonieux.
Toutefois, il est crucial de rappeler que la tranquillité apparente qui régnait à Santiago, dans ses stades et ses rues, n’était que le résultat d’un régime ayant éradiqué toute forme de résistance et d’opposition politique par une répression implacable, foulant aux pieds les principes les plus fondamentaux des droits humains.
Qu'en était-il des réactions de la gauche italienne ? Comme on le saura trente ans plus tard, vers la mi-novembre 1976, Enrico Berlinguer fut contacté par la direction clandestine du parti communiste chilien, qui lui suggéra de ne pas insister sur la campagne de boycott. Elle avait eu écho des signes d'une réaction populaire et, par conséquent, d'une possible exploitation de la situation en faveur de Pinochet, vers lequel un consensus nationaliste de défense contre l'ennemi étranger inattendu était en train de se créer. Le risque que cette campagne finisse par renforcer Pinochet imposa un changement de cap rapide, éliminant tous les obstacles au départ de l'équipe italienne pour le Chili. Le chef du PCI contacta donc Giulio Andreotti pour lui faire part de son accord[48]. Concernant l’ambassade d’Italie à Santiago, selon le journaliste Lorenzo Fabiano c'est à Tomaso De Vergottini que revient le mérite d'avoir démêlé la situation. En échange de demandes d’asile politique pour 5 membres du PCCH d’origine italienne, il conseilla à son Ministère de ne pas s’opposer à l’envoi de l’équipe de tennis (Fabiano, 2016)[49].
Mais sommes-nous vraiment sûrs que l'équipe italienne était totalement apolitique ? Au cours du deuxième jour de la finale, Adriano Panatta entra sur le court vêtu d'un T-shirt rouge et demanda à son partenaire de double, Paolo Bertolucci, de faire de même. Les deux joueurs, lors des deux premiers sets, portèrent cette tenue à la signification profonde, car elle était un symbole de protestation et de solidarité avec la population chilienne. Bien qu'ils aient affirmé que ce choix ne visait pas à représenter le Parti communiste[49]mais plutôt à exprimer leur solidarité avec les femmes chiliennes en lutte contre la répression, il est indéniable que leur choix vestimentaire avait une signification politique et sociale profonde. Ce geste a marqué une déclaration silencieuse mais puissante, témoignant de la manière dont le sport, même sous des apparences de neutralité, peut devenir un terrain de protestation et de solidarité dans des contextes de crise politique.
Conclusion
En conclusion, la finale de la Coupe Davis de 1976 entre l'Italie et le Chili n’avait pas été un simple affrontement sportif, mais un épisode où le sport, la politique et la diplomatie s’étaient entremêlés de manière significative. Ce match avait révélé les tensions profondes de l’époque, dans une Italie marquée par la Guerre froide, les luttes idéologiques et la répression des régimes autoritaires. La décision de l’Italie de participer, malgré la dictature chilienne d’Augusto Pinochet, symbolisait le dilemme auquel de nombreux pays démocratiques faisaient face : comment maintenir des engagements sportifs tout en respectant les valeurs humanitaires ?
Au-delà du tournoi, cet épisode s’inscrivait dans une période où les relations italo-chiliennes étaient fragilisées par les événements tragiques au Chili. Après le coup d’État de 1973, qui avait renversé Salvador Allende, l’Italie, sous la direction de figures politiques comme Aldo Moro et Mariano Rumor, joua un rôle diplomatique crucial. Refusant de reconnaître la Junte militaire de Pinochet, elle s’était engagée du côté des Chiliens persécutés.
Cet engagement ne s’était pas limité aux institutions politiques italiennes. L’accueil des exilés chiliens, les asilados, était un acte de fraternité nationale, où plus de 700 réfugiés avaient été hébergés, intégrés et soutenus dans leur nouvelle vie. L’Italie des années 1970, portée par les idéaux post-soixante-huitards, apparaissait pour de nombreux Chiliens comme une terre de liberté et de justice sociale, semblable à celle rêvée par Allende. C’est aussi pour cette raison que les réactions furent fortes, face à au dilemme de se rendre, ou pas, à Santiago.
Ce soutien, porté par la gauche italienne et les démocrates-chrétiens, démontrait que l'engagement moral pouvait surpasser les intérêts stratégiques immédiats et transcender les clivages politiques.
Ainsi, la finale de la Coupe Davis de 1976 reste, encore aujourd'hui, un exemple puissant de la manière dont le sport et la diplomatie peuvent influer sur le cours de l'histoire. Elle montre que des événements sportifs peuvent devenir des symboles d'enjeux politiques profonds, capables de redéfinir les relations internationales et de laisser une empreinte durable sur la mémoire collective.
Bibliographie
Dufraisse Sylvain (2023). Une histoire sportive de la guerre froide. Paris : Nouveau Monde éditions.
De Masi Piero (2013–. Santiago. 1 febbraio 1973-27 gennaio 1974. Rome : Bonanno Editore.
De Vergottini Tomaso (2000). Cile : diario di un diplomatico (1973 - 1975). Rome : Koinè Nuove Edizioni.
Fabiano Lorenzo (2016). Coppa Davis 1976. Una storia italiana. Vicenza : Edizioni Mare Verticale.
Giorgi Luigi (2018). La Dc e la politica italiana nei giorni del golpe cileno. Bologne : Zikkaron, p. 28-31.
Nocera Raffaele (2015). Acuerdos y desacuerdos. La DC italiana y el PDC chileno, 1962-73. Santiago de Chile : Fondo de Cultura Económica.
Pickett Lazo Axel (2003). El partido de los valientes. Mosc , 26 de septiembre de 1973. URSS 0 Chile 0. Santiago de Chile : Aguilar.
Scorsetti Gregorio (2023). La gara di ritorno, Cile 1973. Rome : 66th and 2nd.
Serafín Silvana (2010). Historias de emigración. Italia y Latinoamérica. Venise : La Toletta Edizioni.
Vilches Diego (2017). De los triunfos morales al país ganador. Historia de la selección chilena durante la dictadura militar (1973). Santiago : Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Vonnard Philippe (2018). Beyond boycotts : sport during the Cold War in Europe. Berlin : De Gruyter Oldenbourg.
Notes de fin:
[1] Orwell George (1945). « The Sporting Spirit », Tribune, 14 décembre.
[2] L'expression a été utilisée pour la première fois par l'écrivain anglais George Orwell dans un article publié en 1945 pour désigner ce qu'il prévoyait être une impasse nucléaire entre « deux ou trois super-États monstrueux, chacun possédant une arme permettant d'anéantir des millions de personnes en quelques secondes ». Par la suite, l'expression a été utilisée aux États-Unis par le financier américain et conseiller présidentiel Bernard Baruch dans un discours prononcé à la State House de Columbia, en Caroline du Sud, en 1947. Voir, entre autres : Dufraisse Sylvain (2023). Une histoire sportive de la guerre froide. Paris : Nouveau Monde éditions.
[3] « Il governo italiano condanna il golpe », Il Popolo, 13 septembre 1973. Les différentes réactions peuvent être lues également dans : « Il governo italiano ha condannato la violenza compiutasi a Santiago», La Stampa, 13 septembre 1973.
[4] « Carta de Radomiro Tomic a Patricio Aylwin, Presidente Nacional del Partido Demócrata Cristiano, sobre posición del Partido Demócrata Cristiano frente a la crítica situación política del país », 7 juillet 1973. Voir, à ce propos : http://www.archivopatricioaylwin.cl/xmlui/handle/123456789/6470.
[5] Dans le rapport de 1991 de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, connu sous le nom de « rapport Rettig », on estimait à 7 000 le nombre de personnes ayant été détenues dans le stade et à au moins 200 à 300 le nombre d'étrangers de diverses nationalités dans ce stade. Des enquêtes ultérieures ont révélé que le nombre total était beaucoup plus élevé et qu'au moins 600 étaient des étrangers, pour la plupart originaires de pays d'Amérique latine. Parmi les 1200 prisons secrètes par lesquelles sont passées les victimes du coup d'État du 11 septembre 1973, on compte onze stades.
[6] « La Davis è a portata di mano », Il Corriere della Sera, 9 août 1976.
[7] Senato della Repubblica, 275° seduta pubblica, resoconto stenografico. 13 février 1974.
[8] En octobre 1973, le stade comptait au moins 7 000 détenus. Face à une vague de plaintes venues du monde entier, la FIFA décida de procéder à une inspection pour autoriser le match contre l'Union soviétique. Finalement, la commission d'enquête de la fédération dirigée par le Brésilien Abilio D'Almeida et le Suisse Helmuth Kaeser ne visita que le terrain, évitant les vestiaires où les militaires avaient entassé les prisonniers. La majorité des détenus furent transférés vers un autre site de détention dans le désert d'Atacama. Voir : Scorsetti Gregorio (2023). La gara di ritorno, Cile 1973. Rome : 66thand2nd.
[9] « La FIFA informó al mundo que la vida en Chile es normal », El Mercurio, 4 noviembre 1973.
[10] La phase de qualification pour la Coupe du monde de 1974 était très différente de celle d'aujourd'hui : les équipes latino-américaines n'avaient droit qu'à 3,5 places. En d'autres termes, trois équipes se qualifiaient directement et la quatrième devait disputer un match éliminatoire contre une équipe européenne. Le Brésil, qui avait remporté la précédente Coupe du monde, avait une place attitrée. Les matches pour attribuer les deux places et demie restantes se déroulent en trois tours : le premier est remporté par l'Uruguay, le deuxième par l'Argentine et le Chili remporta le troisième après avoir disputé un match éliminatoire contre l'Union soviétique. Voir : Pickett Lazo Axel (2003). El partido de los valientes. Moscú, 26 de septiembre de 1973. URSS 0 Chile 0. Santiago de Chile : Aguilar.
[11] La lutte contre l'Afrique du Sud remontait en effet aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, lorsque le Comité international olympique avait décidé de retirer l'invitation au pays africain après avoir appris que le gouvernement de Pretoria n'autoriserait pas les athlètes noirs à participer aux Jeux. L'Afrique du Sud avait également été exclue des Jeux olympiques de 1968 et du CIO en 1970.
[12] « L'U.R.S.S. est exclue de la Coupe Davis », Le Monde, 09 novembre 1976.
[13] Atti parlamentari, Camera dei Deputati, VI Legislatura, 1973, Session du 26 septembre, p. 9149-9189. « L’Italia e il “golpe” cileno. Dibattito alla Camera dei Deputati. Moro illustra la posizione del governo», Relazioni Internazionali, n. 40, 6 octobre 1973, p. 1025-1032.
[14] (Serviteur de Moscou, rentre en Russie). ASMAE - Direzione Generale degli Affari Politici – Uff. XII - Cile b. 4 (1973), f. « Cile, settembre - dicembre1973, Politica Interna », Occupazione degli uffici dell’ambasciata d’Italia in Santiago, sans date, décembre 1973.
[15] « Pella esalta l’amicizia con l’America latina », Relazioni Internazionali, n. 27, 6 juillet 1957, p. 825.
[16] « Un comunicato dei democristiani cileni », Il Popolo, 14 septembre 1973.
[17] « Polemica risposta di Fanfani a un documento dei dc cileni », La Stampa, 14 septembre 1973.
[18] « Un comunicato dei democristiani cileni », Il Popolo, 14 septembre 1973.
[19] Pour ne citer que quelques exemples : « Senado italiano : explosiva sesión », La Segunda, 22 octobre 1973 ; « Violencia y huelgas estremecen a Italia », La Tercera, 30 mai 1974.
[20] « Se battiamo l’Australia giocheremo in Cile?”, Il Corriere della Sera, 2 septembre 1976.
[21] Outre la montée de la violence politique, tant d'extrême gauche que d'extrême droite, l'économie italienne se trouvait dans une situation précaire après la crise pétrolière qui avait touché l'ensemble de l'Occident. En 1975, le produit intérieur brut (PIB) avait chuté de 2,1 %, aggravant encore la crise économique du pays.
[22] Suite aux événements chiliens et au débat parlementaire concernant la responsabilité du PDC dans le coup d'État et la pertinence de reconnaître ou non la junte militaire, Enrico Berlinguer, secrétaire du PCI, avait publié une série d’articles sur la revue communiste Rinascita, qui entrèrent dans l'histoire comme le fondement de la proposition du célèbre « compromesso storico ». Voir, à ce propos : Berlinguer Enrico (1973). « Imperialismo e Coesistenza alla luce dei fatti cileni ». Rinascita, n° 38 ; Berlinguer Enrico (1973). « Via democratica e violenza reazionaria ». Rinascita, n° 39 et Berlinguer Enrico (1973). « Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile ». Rinascita, n° 40.
[23] « Le racchette azzurre si allungano sulla Coppa Davis », Il Corriere della Sera, 28 septembre 1976.
[24] Il s’agissait de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz (militants du FRAP), Juan Paredes Manot (Txiki) et Ángel Otaegui (ETA). Les appels en faveur de la grâce venant du monde entier, y compris du pape Paul VI, ne sont pas entendus. Une très forte réaction antifranquiste se déclenche, tant en Espagne, où 200 000 personnes descendent dans la rue pour une grève générale, que dans le reste de l'Europe, en particulier en Italie, où les dockers de Gênes vont jusqu'à boycotter les navires espagnols. Le sentiment général est de vouloir isoler l'Espagne franquiste par tous les moyens. Voir : « El Barça, ‘non grato’ en Roma por culpa de Franco », El País, 1er novembre 2015.
[25] « Il caso Cile nelle mani di Andreotti », Il Corriere della Sera, 1er octobre 1976.
[26] L'association avait été fondée à Rome dans les jours suivant le coup d'État et regroupait des exilés chiliens, soutenus à la fois idéologiquement et financièrement par des groupes de la gauche traditionnelle italienne, ainsi que par des représentants de l'aile progressiste de la Démocratie chrétienne (DC) et de l'ACLI. De nombreux journalistes, des personnalités du catholicisme progressiste, ainsi que des figures du monde de l'art et de la culture s'étaient également ralliés à ce groupe. L'association, active dans de nombreuses villes, était responsable au niveau provincial des activités de sensibilisation et de propagande en faveur de la résistance chilienne.
[27] « Coppa Davis in Cile: adesso si teme per l’incolumità dei nostri tennisti », Il Corriere della Sera, 29 octobre 1976.
[28] De Vergottini Tomaso (2000). Cile : diario di un diplomatico (1973 - 1975). Rome : Koinè Nuove Edizioni.
[29] « Dai cileni in esilio invito agli azzurri : non alla Coppa Davis », Il Corriere della Sera, 30 octobre 1976.
[30] « Castillo Velasco : Spero che Carter punti sulla democrazia dell’America Latina », Il Corriere della Sera, 15 novembre 1976.
[31] Selon le principe de réciprocité des Conventions de Genève, il ne pouvait pas y avoir un ambassadeur chilien à Rome.
[32] « Debate político y deportivo por final tenis Copa Davis en Chile », 7 octubre 1976.
[33] « Occupata la sede della Federtennis per sollecitare un “no” a Cile-Italia”, Il Corriere della Sera, 20 novembre 1976.
[34] « Il profitto non bada al golpe », L’Avanti, 25 novembre 1976.
[35] « Anche in tv un "no" al Cile », La Stampa, 21 novembre 1976.
[36] « Com'è questo Allende », La Stampa, 14 octobre 1970.
[37] La totalité des échanges peut être lue dans : Ministero Degli Affari Esteri Servizio Storico e Documentazione, 1976 : Testi documenti sulla politica estera dell’Italia, Uffici studi Roma, p. 171 et suivants.
[38] Ibidem.
[39] « Il governo italiano condanna il golpe », Il Popolo, 13 septembre 1973.
[40] « Davis, il Cile contrario ad una sede neutrale », La Stampa, 25 novembre 1976.
[41] « Ci sono armi migliori della racchetta”, Il Corriere della Sera, 25 novembre 1976.
[42] « Il governo acconsente che si giochi in Cile », Il Corriere della Sera, 7 décembre 1976.
[43] « Il governo ha detto sì al Cile », L’Avanti, 7 décembre 1976 ; « Ancora reazioni su Cile-Italia di tennis”, Il Corriere della Sera, 8 décembre 1976.
[44] « Final Copa Davis », 9 décembre 1976.
[45] « Chi andrà a ritirare la Coppa Davis se a consegnarla sarà Pinochet? », Il Corriere della Sera, 14 décembre 1976.
[46] « Pinochet non ci sarà », La Stampa, 16 décembre 1976.
[47] « Davis tinta d’azzurro », La Stampa, 20 décembre 1976.
[48] AA.VV., (1996). Coppa Davis : la vittoria. Club Racchetta d'Oro, 1976-1996. Roma : Edizioni Parnaso.
[49] Les témoignages peuvent être écoutés dans le film documentaire La Maglietta Rossa. Calopresti Mimmo (réalisateur) (2009). La Maglietta Rossa. Ambra Group, 50 minutes.
Pour citer cet article:
Elisa Santalena, « Raquettes antifascistes et maillots rouges. Le dilemme italien face à la finale de la Coupe Davis de 1976 à Santiago du Chili », RITA [en ligne], n°17 : septembre 2024, mis en ligne le 30 septembre 2024. Disponible sur: http://www.revue-rita.com/dossier-thematique-n-17-articles/raquettes-antifascistes-et-maillots-rouges-le-dilemme-italien-face-a-la-finale-de-la-coupe-davis-de-1976-a-santiago-du-chili-elisa-santalena.html



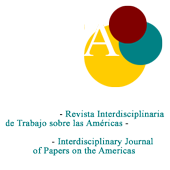







 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8