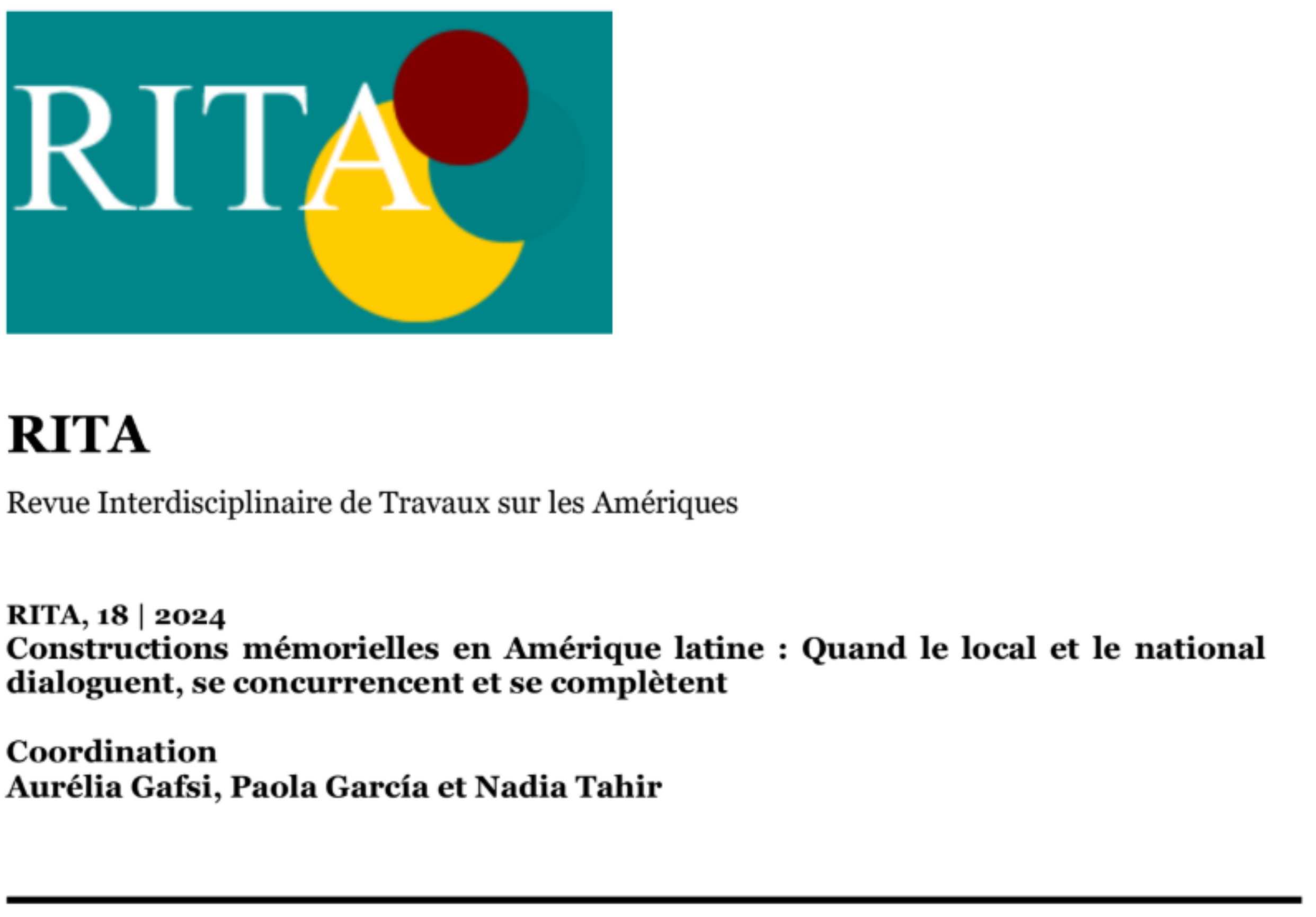
À nos corps célestes. Figurer la disparition forcée en Colombie : le témoignage comme enjeu de mémoire et politique de réparation
Résumé
Cet article propose de questionner les liens qu’entretiennent mémoire et oubli dans l’expérience des processus de justice transitionnelle amorcés en Colombie au milieu des années 2000. Il discute du cas des victimes de disparition forcée qui, rattachés à la catégorie juridique de victime, ont fait l’objet d’un important travail de divulgation, de recherche et de reconnaissance depuis la signature des Accords de Paix de 2016. Les analyses mobilisent des enquêtes de terrain réalisées entre 2019 et 2022 dans le cadre du projet REVECO, tout en s’arrimant à une expérience de recherche plus large débutée en 2008. Elles discutent de l’enjeu du témoignage dans les politiques de mémoire et de réparations actuellement à l’œuvre dans la société colombienne qui, en l’espace de vingt, est passé d’une temporalité de guerre à une temporalité « post-conflictuelle ».
Mots-clés : Sortie de guerre, victimes, justice transitionnelle, mémoire, oubli.
A nuestros cuerpos celestes. Representar la desaparición forzada en Colombia: el testimonio como desafío de la memoria y política de reparación
Resumen
Este artículo estudia los vínculos entre memoria y olvido en la experiencia de los procesos de justicia transicional iniciados en Colombia a mediados de la década de 2000. Aborda el caso de las víctimas de desaparición forzada las cuales, adheridas a la categoría jurídica de víctima, han sido objeto de un importante esfuerzo de divulgación, investigación y reconocimiento desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016. Los análisis se basan en estudios de campo realizados entre 2019 y 2022 en el marco del proyecto REVECO, al tiempo que se apoyan en una experiencia de investigación más amplia iniciada en 2008. En ellos se discute la importancia del testimonio en las políticas de memoria y reparación de la sociedad colombiana, que ha pasado en tan solo veinte años de una temporalidad de guerra a una de posconflicto.
Palabras clave: Posguerra, víctimas, justicia transicional, memoria, olvido.
To Our Celestial Bodies. Depicting Forced Disappearance in Colombia: Testimony as a Site of Memory and a Politics of Reparation
Abstract
This article aims to question the relationship between memory and forgetting within the experience of transitional justice processes initiated in Colombia in the mid-2000s. It discusses the case of victims of enforced disappearance who, once included under the legal category of “victim,” have become the focus of extensive efforts in terms of dissemination, investigation, and recognition since the signing of the 2016 Peace Accords. The analysis draws on fieldwork conducted between 2019 and 2022 as part of the REVECO project, while also building on a broader research experience that began in 2008. It examines the role of testimony within the current politics of memory and reparation in Colombian society, which, over the course of twenty years, has transitioned from a time of war to a “post-conflict” temporality.
Keywords: Post-war transition, victims, transitional justice, memory, forgetting.
Aos nossos corpos celestes. Representar o desaparecimento forçado na Colômbia: o testemunho como questão de memória e política de reparação
Resumo
Este artigo propõe uma reflexão sobre as relações entre memória e esquecimento na experiência dos processos de justiça de transição iniciados na Colômbia em meados dos anos 2000. Discute o caso das vítimas de desaparecimento forçado que, ao serem incluídas na categoria jurídica de “vítima”, tornaram-se objeto de um importante trabalho de divulgação, investigação e reconhecimento desde a assinatura dos Acordos de Paz de 2016. As análises baseiam-se em pesquisas de campo realizadas entre 2019 e 2022 no âmbito do projeto REVECO, articulando-se também a uma experiência de pesquisa mais ampla iniciada em 2008. O texto examina o papel do testemunho nas políticas de memória e de reparação atualmente em curso na sociedade colombiana, que, ao longo de vinte anos, passou de uma temporalidade de guerra a uma temporalidade “pós-conflito”.
Palavras-chave: saída da guerra, vítimas, justiça de transição, memória, esquecimento.
---------------------------------------
Tiphaine Duriez
Maîtresse de conférences
Université Lumière Lyon 2/ LADEC
À nos corps célestes. Figurer la disparition forcée en Colombie : le témoignage comme enjeu de mémoire et politique de réparation
INTRODUCTION
« Ce qui est advenu décide donc de ce qui sera exhumé ou au contraire abandonné aux ténèbres de l’oubli »
(Emmanuel Terray, « L’histoire et ses possibles », in Le Genre humain, Paris, Le Seuil, n°35, février 2000, p.182)
En juin 2011, alors que je me trouvais à Bogota, le Congrès de la République de Colombie adopta la loi 1448, connue sous le nom de « Loi des victimes et de restitution des terres ». À cette époque, je menais une recherche doctorale sur les reconfigurations urbaines du desplazamiento forzado por la violencia dans les périphéries sud de la capitale colombienne. L’adoption de cette loi eut un impact direct sur mon sujet de recherche. En effet, la loi prévoyait une refonte du cadre normatif pour les citoyens reconnus comme desplazados. Aussi, sa ratification entraîna une double transformation sur mon terrain d’étude. D’une part, les desplazados devinrent des victimes parmi d’autres, eux qui, jusqu’alors, incarnaient l’existence d’un conflit armé interne sans nom (Gutiérrez Sanín, Wills Obregón & Sánchez Gómez, 2006). D’autre part, l’élargissement de la catégorie des victimes à d’autres violations des droits humains renforça la nécessité de reconnaître un conflit armé interne en Colombie. La réception de cette loi marqua donc un tournant dans la compréhension de la situation armée du pays et, par extension, dans les modalités de sa résolution. Cependant, que ce soit parmi les acteurs avec lesquels je réalisais mon enquête ethnographique ou au sein de l’opinion publique, l’adoption de la loi 1448 suscita un débat au sein de la société colombienne. Certains y voyaient un risque, tandis que d’autres y voyaient un espoir. Pour les premiers, l’application de la loi, en prévoyant de dédommager les victimes, notamment par la restitution de terres, risquait de conduire la Colombie à la ruine. Pour les seconds, la ratification de cette loi représentait une avancée démocratique majeure pour la justice sociale d’un pays qui se niait à nommer la guerre. Entre ces deux positions, certains n’en attendaient rien, considérant la mesure comme une simple figure de style.
À l’échelle de mon terrain, personne ne savait comment cette loi serait appliquée et tout le monde craignait sa mise en œuvre opérationnelle. Pour autant, une chose était certaine : avec sa ratification, le gouvernement venait de reconnaître officiellement, bien qu’indirectement, l’existence d’un conflit armé interne en Colombie. À l’échelle nationale, cette reconnaissance légitima le déploiement et le soutien institutionnel d’un important travail de mémoire, initié dans le cadre de la loi de Justice et Paix de 2005. Centré sur les victimes, ce travail renforça la légitimité de l’organisation politique de la sortie de guerre négociée entre le gouvernement colombien et la guérilla FARC, de 2012 à 2016. Ces dialogues aboutirent à la signature des Accords de Paix de 2016, permettant la démobilisation, le désarmement et la réinsertion de l’une des plus anciennes guérillas actives d’Amérique latine et du pays[1] Néanmoins, la ratification des Accords ne fit pas consensus. Le référendum organisé suite à la présentation du texte par l’exécutif donna une majorité de « Non » à la paix par rapport au « Oui » (Rodríguez Cuadros, 2016). Ce résultat m’incita à retourner sur le terrain en 2018 pour observer cette transition politique, qui faisait progressivement basculer la Colombie d’une temporalité de guerre à une temporalité de paix.
Ces observations ont conduit au dépôt d’un projet de recherche axé sur la transformation des représentations sociales et culturelles de la violence armée depuis la signature des Accords de Paix de 2016. Dans ce cadre, j’ai mené des observations ethnographiques dans des musées, des expositions photographiques et des pièces de théâtre. Par la suite, je me suis entretenue avec celles et ceux qui les avait construites pour en connaître l’histoire, mais aussi l’expérience. En parallèle, j’ai confronté mes analyses à celles d’agents institutionnels dont le champ d’action recoupait les thèmes du conflit armé, du processus de justice transitionnelle et de la prise en charge des victimes. Enfin, j’ai enrichi mes réflexions par des lectures et des échanges avec celles et ceux avec qui j’avais noué des liens lors de mes précédents travaux de recherche, qu’ils soient ou non victimes du conflit armé interne.
Ces échanges et expériences m’ont amenée à interroger le rôle de la mémoire dans un contexte de transition particulier : celui de l’organisation politique d’une sortie de guerre au demeurant active. En effet, que ce soit en tant que dispositif ou pratique narrative, la mémoire était érigée en symbole de réussite. Porteuse de promesses de réconciliation, sa fragilité était pourtant souvent soulignée. Car comment faire mémoire de quelque chose qui n’est pas révolu ? Comment marquer l’avant et l’après-guerre alors que les affrontements armés persistent et que la suspicion demeure ? Comment garantir un traitement équitable du souvenir ? Et comment s’assurer que le travail et la diffusion de cette mémoire soient bien ceux d’une mémoire pour la paix, et non pour la guerre (Wills Obregón, 2022) ? Ainsi, le maintien de la violence armée sur les territoires entravait l’exercice de narration du conflit. Pourtant, tous s’accordaient à dire que la reconnaissance des victimes était indispensable et qu’elle ne pouvait se faire sans diffuser leur mémoire. Mais qui sont les victimes, et de quoi sont-elles victimes ?
Éliciter la violence : la voie des victimes
En Colombie, la catégorie (Quéré, 1995) de victime[2] s’applique à plus de neuf millions huit cent mille personnes[3]. Compilée dans le Registre Unique aux Victimes (RUV), ces chiffres recoupent seize types d’infractions aux occurrences variables[4]. Dans ce pays comme ailleurs, il n’y a donc pas une, mais des victimes (Lefranc, 2022, p. 252). Leur pluralité nous invite donc à penser la multiplicité des violences, des conflits et des processus de paix colombiens (Tous, 2020) engagés dans le conflit interne.
Bien que le conflit armé contemporain remonte au milieu du XXe siècle, l’histoire de ce pays a été marquée par l’exercice de la guerre et les négociations politiques qui leur ont succédées, et ce, depuis son accession à l’indépendance. Aussi, l’élicitation (Dousset, 2018) de la violence armée qui le traverse n’est pas chose facile. La Colombie semble rester « prisonnière d’un mouvement pendulaire entre la guerre et la paix » (Sánchez Gómez, 2006, p. 27), ce qui complexifie tout exercice de périodisation du conflit. Malgré les traités de paix, les violences n’ont jamais pris fin et ont accompagné le déplacement des centres d’intérêts qu’ils ont entériné. Inscrit dans la longue durée (Braudel, 1958), les affrontements armés alimentent ainsi « des interprétations contradictoires concernant l’histoire, l’inclusion et la justice sociale » (Salcedo, 2015, p.14), au point que « la violence est perçue comme faisant partie de la vie » (Corten, Côté, 2008, p. 375).
Cette « guerre sans nom » (Gutiérrez Sanín, Wills Obregón & Sánchez Gómez, 2006) a impliqué plusieurs acteurs armés : guérillas, groupes paramilitaires, cartels et forces armées étatiques. Leur cohabitation n’a pas été linéaire. Pendant plus d’un demi-siècle, deux ou plusieurs d’entre eux se sont livrés à des combats asymétriques. Nombre de ces acteurs armés se sont démobilisées au cours des dernières décennies, mais les espaces libérés n’ont jamais été totalement exempts de combats. Le retrait d’un groupe se solde souvent par l’arrivée d’un autre (Grajales, 2016), conférant à la guerre un caractère permanent. Ce « caractère permanent de la guerre révèle qu’il n’y a jamais eu de victoires décisives, mais des parenthèses au cours desquelles les hostilités se sont prolongées par d’autres moyens » (Sánchez Gómez, 2021, p. 111).
Parmi ces moyens, les affrontements armés par population civile interposée occupent une place particulière. Ils constituent à la fois une cause et un effet du maintien de ces dynamiques. En effet, la situation de violation généralisée des droits humains qu’ils provoquent engage la responsabilité de l’État dans le maintien de l’ordre (Rodriguez-Daviaud, 2010, pp. 40-41). Mais dans sa contre-offensive, il s’est appuyé sur le déploiement de la doctrine militaire contre-insurrectionnelle, laquelle repose sur la figure de l’« ennemi intérieur »[5]. Aussi, depuis les années 1970, cette situation tend à présenter les sujets des exactions armées comme des dommages collatéraux de la guerre, influençant la construction de la mémoire sociale du conflit armé interne pour deux raisons.
Premièrement, en légitimant ces violences contre l’insurrection, elle a hiérarchisé les vies (Butler, 2010). Certaines ont été jugées plus dignes de compassion que d’autres, suspectées d’être responsables de leurs malheurs. Dans ce contexte, on retrouve la figure du militant politique et du détenu-disparu. Deuxièmement, ce déchaînement de violence, dirigé contre tous sans distinction, a fragmenté les milieux de mémoire (Nora, 1984). En faisant de la rumeur une arme de destruction massive, l’usage de cette doctrine a isolé le récit sur la violence. Or, c’est à cet isolement que tentent de répondre les politiques de mémoire. Ces dernières se sont multipliées à l’occasion de l’instauration de processus de justice transitionnelle dans les années 2000. Mais qu’entend-on par processus de justice transitionnelle ? Et quels furent-ils en Colombie ?
- Sortir du conflit : un processus en trois temps
Les processus de justice transitionnelle peuvent être définis comme « l’ensemble des processus visant à remédier aux violations des droits de l’homme commises dans le passé à la suite de périodes de troubles politiques, de répression étatique ou de conflits armés » (Lefranc, 2022, p. 15 – citant T. Olsen, L. Payne et A. Reiner, 2010, p. 11). Engagés pour mettre fin aux violences qui rythment le quotidien des civils en temps de guerre, de conflit ou de régimes autoritaires, ils apparaissent comme des sortes de « guide[s] de sortie du conflit » (Lefranc, 2022, p. 13) destinés à des « gouvernements ni vaincus, ni vainqueurs, mais tenus de s’entendre avec leurs prédécesseurs » (Ibid., p. 51). Cette approche repose sur deux impératifs. Premièrement, l’application d’une justice transitionnelle implique que les parties prenantes identifient des intérêts communs à sortir du combat. En effet, c’est la défense de ces intérêts qui fera des ennemis d’hier les alliés de demain. Deuxièmement, ces intérêts doivent œuvrer pour le bien commun. En cela, la médiatisation de la valeur morale du processus est essentielle. Elle doit permettre aux « Nous indivisés » (Clastres, 1977, p. 163) de se fédérer autour de ces nouvelles règles de l’échange afin de garantir « la sécurité ontologique fondamentale de toute société […] Le soi et l’identité étant les victimes collatérales de la guerre » (Lefranc, 2022, p. 65 – citant C. Nordstrom, 1998, pp. 107-108).
Atteindre ces deux objectifs suppose de s’accorder sur les conditions matérielles qui succéderont à l’arrêt des combats, mais pas seulement. Pour instaurer une « paix positive », il faut aussi construire les conditions idéelles nécessaires à la pleine applicabilité de cette transition sociale et culturelle. L’articulation de ces paramètres matériels et idéels a conduit le gouvernement colombien à soutenir le développement de politiques mémorielles. En effet, pour s’entendre, il fallait parler de la même chose ou, tout du moins, partager une même version de ce dont on voulait sortir. Cette nécessité s’est exprimée dans un objectif : saisir la vérité de ce qu’a été, pour les parties prenantes et les non-partisans, le conflit armé interne.
Ainsi, à partir des années 2000, la mémoire est devenue un paramètre politique majeur en Colombie. Deux processus de justice transitionnelle illustrent bien cet enjeu : la Loi 975 de 2005, dite « Loi de Justice et Paix », ainsi que les « Accords de Paix » de 2016. Le premier a permis la démobilisation des groupes paramilitaires, tandis que le second a abouti à celle des FARC. Ces deux processus ont permis d’éliciter la violence armée du conflit interne. Cependant, ils ne furent pas reçus de la même façon, car là où le second a d’emblée identifié la mémoire comme mécanisme de réparation, le premier a été amené à s’en saisir « malgré lui » suite à la création d’un Groupe de Mémoire Historique (GMH)[6]. Ce qui a changé, entre les deux, c’est l’adoption de la loi 1448 dite « Loi des victimes et des restitutions des terres ». Son adoption a conduit à l’institutionnalisation d’un travail de mémoire qui a permis d’éliciter les tenants et aboutissants du conflit armé interne. En rendant manifeste la situation d’impunité vécue par les victimes, elle a permis d’en faire l’unité narrative justifiant une « transition vers « plus » de démocratie » (Lefranc, 2022, p. 232).
Du post-conflit aux post-accords : la mémoire comme champs de bataille
Reconnaître le conflit armé interne suppose d’en faire la mémoire. Cependant, les modalités de narration et la construction sociale de cette mémoire doivent éviter de devenir hégémoniques, car une question demeure sensible : quels seront les usages de ces récits ? S’agit-il de mémoire pour la paix, ou de mémoire pour la guerre (Wills O., 2022) ? À l’instar des autres membres du GMH, cette chercheuse a toujours défendu la nécessité de prendre en compte la pluralité des voix citoyennes ayant vécu le conflit armé interne. En cela, la mémoire historique ne cherche pas seulement à faire éclater la vérité, mais prend en compte son aspect multidimensionnel. Aussi, elle s’avère précieuse pour adapter les réparations promises aux besoins exprimés par les victimes. Malgré tout, des dissonances émergent lorsqu’il faut faire correspondre le volet matériel des réparations aux dimensions symboliques qu’elles sous-entendent. Mais à quoi cela tient-il ?
Dans les faits, la mémoire nationale a souvent tendance à se matérialiser dans des lieux lorsque le milieu qui la transmettait disparaît (Nora, 1984). En Colombie comme ailleurs, les lieux de mémoire apparaissent dès lors comme des « bastions sur lesquels on s’arc-boute » (Sánchez Gómez, 2020, p. 321), participant ainsi à la construction d’une représentation temporelle de la Nation se voulant unitaire. Or, la Nation colombienne est à la fois pluriethnique, multiculturelle (Agudelo, 2006) et spatialement fragmentée. Plusieurs approches du temps y coexistent sans forcément se côtoyer. L’expérience du conflit n’implique donc pas les mêmes incertitudes existentielles ou systémiques (Dousset, 2018) selon les groupes observés. Dès lors, la difficulté que pose l’écriture de ce passé commun est liée à la fois au format proposé et à sa réception par les sujets de cette histoire. Ces protagonistes ont été victimes de violations de leurs droits. Ce qu’ils demandent, c’est le rétablissement effectif de ces droits, dans le temps et dans l’espace. Or, ce rétablissement peut comporter un volet matériel, mais pas toujours. Il est des pertes qui ne peuvent pas être monétairement compensées, à l’instar de celles d’un écoumène ou d’une langue. Par ailleurs, ces situations de violence ont souvent conduit à la marginalisation de celles et ceux qui en ont été victimes. C’est là qu’intervient la réparation symbolique. On entend par ce terme « toute action mise en œuvre en faveur des victimes ou de la communauté en général et dont le propos vise à garantir la préservation de la mémoire historique, la non-répétition des faits préjudiciables, la reconnaissance publique des préjudices subis, les demandes d’excuses publiques et la restauration de la dignité des victimes » (Article 141, Loi 1448, 2011). Parfois, matérialité et symbolisation se télescopent, comme me l’a témoigné l’ancien directeur du CNMH à l’occasion d’un entretien, alors qu’il évoquait l’un de ses souvenirs sur le terrain :
« Je me souviens d’une visite à Tumaco. Quelqu’un s’est levé et m’a dit "Profe, c’est qu’ici, on sait que la mémoire est importante, avec tout ce qui s’est passé et tout. Mais nous, on voudrait un musée spécial ici. Parce qu’ici, on a beaucoup d’inondation, alors on voudrait que le musée puisse aussi servir de lieu d’hébergement d’urgence". Alors tu vois, il y a ce débat ici, entre le symbolique et le matériel. […] "On ne veut pas de monument, on veut une école, un pont… " […] C’est à cela que la doctrine de la Justice différentielle tâche de répondre. Elle essaie de différencier les responsabilités propres à l’État, en tant qu’État, et celle propre à l’État vis-à-vis de son engagement à réparer les victimes du conflit armé interne. Ici, tout se mélange ». (Gonzalo Sanchez, mai 2022)
Cet extrait d’entretien illustre bien cet enchevêtrement entre matérialité et symbolisation. Lorsque cet habitant de Tumaco se lève pour exprimer son adhésion au travail de mémoire, il ne le fait pas parce qu’il estime que cette mémoire va se perdre. Ici, « on sait […] tout ce qui s’est passé ». Ce que l’on ne sait pas, c’est qu’il va se passer, parce qu’ici « il y a beaucoup d’inondation ». L’urgence n’est pas à la préservation du récit, qui se transmet, mais à celle de son milieu, qui le préserve. A l’inverse, il est des cas où on ne sait pas ce qu’il s’est passé, comme ce fut le cas avec les disparus :
« La disparition forcée en Colombie, c’est plus de 80 000 personnes […] on ne sait pas de quoi il en retourne. Il y a beaucoup de cas où on ne sait pas si elles sont encore vivantes, ou si elles sont mortes. […] On ne sait pas où elles sont. » (Camilo Delgado, mai 2022)
Ne pas savoir « de quoi il en retourne » impose de composer avec une mémoire tissée d’oubli, comme un « texte à trous » avec lequel il faut composer selon un principe de concordance des temps. Dans ce contexte, le travail de mémoire devient tout autre. Certes, il s’inscrit dans un devoir, mais aussi dans une lutte visant à « faire apparaître les disparus » en rendant audible le silence qui caractérise ce crime de lèse-humanité. Des recherches sont menées pour retracer l’histoire des personnes disparues, mission confiée à l’Unité de Recherche des Personnes Portées Disparues (UBPD) par le Système Intégral pour la Paix, créé suite aux Accords de Paix de 2016. La matérialité de la disparition réside donc dans cette recherche et dans sa médiatisation. Cependant, la répétition du phénomène laisse planer des doutes quant à l’avenir de ces histoires. Les organisations des proches de disparus ne sont pas forcément à l’aise à l’idée de laisser le travail de mémoire de ce crime de lèse-humanité à l’État, car « on ne sait pas quel sera le gouvernement de demain. Rien ne garantit que les monuments restent, ou que les souvenirs qu’ils défendent soient perpétués » (Extraits d’entretien, mai 2022).
Cette incertitude conduit à opposer aux lieux de mémoire l’édification de dispositifs contre-monumentaux. Ces contre-monuments n’ont pas vocation à livrer d’eux-mêmes le message qu’ils figurent. Ils matérialisent l’empreinte des effets du conflit sur le quotidien de leurs victimes et, en cela, invitent à exercer un devoir de mémoire qui dépasse le lieu et le temps qui leur sont assignés. Ils se présentent comme des supports au travail de mémoire qu’implique la mise en récit des événements et, dans le contexte colombien, ils sont particulièrement employés dans la narration des crimes de guerre perpétrés durant le conflit armé interne, toujours présents.
- Remédier à l’oubli : de l’isolement au rassemblement des milieux de mémoires
Au cours des terrains réalisés dans le cadre du projet REVECO, un dispositif contre-monumental a particulièrement attiré mon attention : le projet « Ausentes, Estrellas Presentes ». La première fois que j’en ai entendu parler, c’était lors d’un entretien avec le directeur du Centre Mémoire, Paix et Réconciliation (CMPR). Le CMPR se présente et est présenté comme un outil au service de la construction de la paix. Cet espace accueille des projets portés par des organisations citoyennes qui œuvrent en ce sens. Ainsi, les expositions qui y sont diffusées impliquent une participation directe des milieux qui les soutiennent. Plus qu’un lieu de mémoire du conflit armé, c’est donc un lieu qui permet un travail de cette mémoire à portée sociale.
Alors qu’il me présentait les missions globales du Centre, le directeur du centre a rapidement évoqué le projet « Ausentes, Estrellas Presentes ». Son aboutissement, impliquant une performance mémorielle, avait eu lieu le 4 novembre 2021 et constituait pour lui un temps fort dans l’évaluation des missions du Centre. Il m’a raconté qu’il avait voulu réaliser ce projet après avoir vu Nostalgie de la lumière, du réalisateur chilien Patricio Guzmán, car il partageait avec lui une interrogation sur les traces et leurs fonctions mémorielles : que reste-t-il lorsque les réponses aux questions que l’on se pose se formulent dans le néant ? Il m’a raconté que :
« L’idée de départ, c’était de mettre à profit les connaissances en astronomie du Planétarium pour permettre aux familles des personnes disparues de nommer les étoiles du nom de leurs disparues. […]. Dès le départ, ce projet souhaitait donc réunir les familles des personnes détenues-disparues […] On voulait construire une espèce de dispositif, on ne savait pas vraiment lequel, mais on voulait qu’il puisse s’inscrire dans la ville et qu’il s’arrime à une activité reposant sur des étoiles qui, visibles dans le ciel, seraient liées aux personnes disparues. C’était notre idée initiale. » (José Antequera, mai 2022)
Cet extrait d’entretien souligne l’importance du lien dans la recherche de réponses. Il s’agit de reconnaître ce que la disparition forcée implique pour celles et ceux qui y sont confrontés. Le projet visait ainsi à réunir des associations en leur proposant de co-construire un milieu commun à leur expérience de la disparition forcée, milieu qui devait refléter la certitude que l’issue de ces histoires restait incertaine. En délégant ce témoignage aux étoiles, il s’agissait de concevoir un dispositif permettant de répondre à l’incertitude existentielle générée par la disparition forcée, mais aussi à son incertitude systémique, « car une étoile morte brille encore ». Ainsi, il me raconta :
« […] avec les familles des organisations de personnes disparues, nous nous sommes entretenus avec le Planétarium pour construire le projet et, au final, plutôt que de nommer des étoiles, nous avons choisi de construire des constellations. Ces constellations ont été travaillées à partir de cartes du ciel et de leurs astérismes. La disposition des étoiles sur ces cartes devait correspondre au jour et à l’heure où la disparition a eu lieu, avec comme idée que ces cartes permettaient de refléter cette situation. Ces cartes du ciel ont été remises aux familles des disparues. Elles ont aussi été versées aux Archives de Bogotá, et elles ont servies de support pour l’évènement que nous avons organisé. Mais ces cartes, elles ont aussi été imaginées pour permettre à d’autre personnes, à d’autres familles de disparus, de pouvoir faire cet exercice […] Avec ce projet, on voulait vraiment articuler les familles des organisations de personnes disparues vivant à Bogotá. C’est un projet qui voulait renforcer ces organisations. […] » (José Antequera, mai 2022).
La dimension participative de l’exposition fut régulièrement soulignée au cours de cet échange. Au-delà de l’événement, il s’agissait d’une démarche visant à « articuler les familles des organisations de personnes disparues présentent à Bogota » et à co-construire des témoins capables de diffuser leur expérience au-delà de l’espace et du temps de leur avènement. Cette dimension collective fut également abordée lorsque je me suis entretenue avec Carolina, l’une des deux chargées de projets du CMPR ayant accompagné le processus de co-construction de cette action publique mémorielle. Pour elle, ce fut « l’une des plus grandes réussites » du projet, car « pour la première fois, ces organisations […] se sont réunies autour d’un projet commun […] tel que celui d’« Ausentes, Estrellas Presentes ».
Selon elle, la difficulté à mobiliser ces associations autour d’un projet commun découlait de deux facteurs. Le premier était relatif à leur répartition sur le territoire. Les associations de disparus du District Capital sont nombreuses et les regrouper représentait un véritable défi logistique, aussi bien en termes de temporalité qu’en terme de mobilité. Le second facteur était relatif à la méfiance des associations vis-à-vis des institutions qui, jusqu’en 2011, ne reconnaissait pas les proches des personnes victimes de disparition forcée comme victimes elles-mêmes. Pendant des décennies, les crimes perpétrés envers leurs proches ont été « isolés » de la narration du conflit armé interne. Cette mise à l’écart a participé d’un repli de ces milieux de mémoire sur eux-mêmes. Certes, ces associations avaient comme point commun d’expérimenter l’incertitude de la disparition, mais c’est précisément cette incertitude qui les a conduites à ne pas se regrouper et à se préserver en tant que milieux de mémoire. Alors que Carolina m’expliquait cela, elle insista sur la dimension pérenne de l’incertitude générée par ce crime de lèse-humanité :
« Parce que l’idée des étoiles, c’était aussi de dire que, comme les personnes disparues, elles allaient toujours rester ici. Beaucoup de personnes disparues n’ont pas été retrouvées en Colombie. Pour autant, comme les étoiles, on ne les effacera jamais, même si on ne les voit pas. On ne pourra jamais nous les enlever, au même titre qu’on ne pourra jamais nous retirer le ciel, parce qu’il est public, jusqu’à maintenant en tout cas… […] Donc on a travaillé avec le Planétarium de Bogotá pour permettre aux familles de personnes disparues d’accéder à ce savoir, disons, scientifique […] mais aussi parce que l’espace du Planétarium accueille un public qui ne va pas forcément venir voir nos expositions. […] Pour qu’une action symbolique puisse acquérir une dimension réparatrice, il faut aussi que le message porté puisse atteindre des personnes qui ne se sentent pas directement concernées par le sujet de l’action. Et puis il ne faut pas oublier que ce projet est né dans un contexte particulier. Parce qu’avec tout ce qu’il s’est passé l’année dernière, avec les mobilisations sociales d’ici, en Colombie, on ne peut pas faire comme si cette pratique n’existe plus. Elle n’a pas disparue. On ne peut pas dire que c’est derrière nous et que ça n’arrivera plus jamais. C’étaient des choses qui avaient lieu, au moment où nous avons fait ça. Donc on voulait le visibiliser, on voulait faire savoir que c’est une pratique qui a été utilisée, mais qui continue d’être utilisée, et les gens ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de le savoir, et de comprendre que c’est un fait extrêmement douloureux pour les familles qu’il touche. » (Extraits d’entretien, mai 2022)
À mi-chemin entre devoir de mémoire, réparation symbolique et prévention des abus de mémoire, le projet « Ausentes, Estrellas Presentes » entend remédier à l’oubli entourant la pratique des disparitions forcées en revenant sur ce qu’il s’est passé, tout en le conjuguant au présent. En effet, « c’étaient des choses qui avaient lieu » au moment de la réalisation du projet, raison pour laquelle « en Colombie, on ne peut pas faire comme si cette pratique n’existe plus. Elle n’a pas disparu. On ne peut pas dire que c’est derrière nous et que ça n’arrivera plus jamais. ». Dès lors, si ce projet se présente comme un acte mémoriel, il va au-delà de cette seule définition. Il est aussi un témoignage de ce qui doit être mémorable, à savoir la lutte engagée par les familles des disparus pour faire reconnaître ce crime de lèse-humanité dont la pratique demeure active. Cette mémoire est portée par un milieu qui, pendant longtemps, a souffert d’un stigmate de déviance (Goffman, 1975), à l’instar de l’ensemble des citoyens victimes du conflit armé interne. En cela, pour l’astrophysicien responsable du projet pour le planétarium :
« […] appuyer ce projet, c’était aussi une forme de reconnaissance pour les victimes. Elles nous l’ont dit […] C’était une forme de soutien, de reconnaissance de leurs luttes, de leur engagement pour une cause juste. […] Et ça a été une expérience très… très… Lier l’astronomie à une cause sociale, ça a été très fort pour moi. […] Je ne connaissais pas ce thème […] et c’est un thème difficile, parce que même si tu ne connais pas la personne, tu te rends compte que ça a détruit leur vie. Tu te rends compte qu’on a détruit leur vie. » (Camilo Delgado, mai 2022)
En effet, les gens ne disparaissent pas « comme ça » : on les « fait disparaître », ou bien ils décident de disparaître d’eux-mêmes. L’absence, si elle est certaine, n’est jamais rationnelle, car les modalités de son avènement restent inconnues, tout comme l’issue de la recherche des personnes disparues. C’est en cela que « ça a détruit leur vie ». « Faire disparaître quelqu’un » met à l’épreuve les systèmes d’intelligibilité. L’impossibilité du deuil empêche la construction d’un récit de l’événement, car le « disparu est moins un mort qu’un absent susceptible de revenir à tout moment » (Garcia Castro, 2002, p. 56). Or, « ce récit demande à être fait, pour soi-même et pour les autres » (Ibid., p. 63), mais puisqu’il n’y a pas de corps, pas de tombe, ni de lieu où se recueillir, son dénouement reste incertain. Aussi, pour les victimes de ce crime, figurer la disparition en ayant recours aux étoiles leur assure une forme de stabilité dans leur travail de deuil, car « les étoiles représentent le dernier lieu de mémoire qu’on pourra nous enlever » (Espinosa Moreno, 2022, p. 157). Le choix des étoiles répond donc à une problématique de lieu, mais aussi de temps.
Car si « Ausentes, Estrellas Presentes » se présente comme un contre-monument, c’est d’abord parce que le récit n’est pas clos. J’ai ainsi pu observer d’autres dispositifs mémoriels au cours des missions du projet REVECO qui, empruntant aux étoiles leur pouvoir de figuration, se situaient dans des lieux de mémoire bien identifiés. Ainsi, au Museo Casa Memoria de Medellín, la dernière salle du parcours d’exposition s’appelle la « salle du souvenir » et propose une immersion dans un lieu étoilé. Plongée dans le noir, les corps célestes sont artificiellement représentés par de la lumière qui ne s’éteint jamais. Là défilent des photographies de personnes disparues, leur déroulé complet représentant plus de 24 heures de projection, avec un algorithme veillant à ce que ces assemblages de photographies soient projetés de manière aléatoire et non répétitive. Ce lieu de mémoire, comme ce contre-monument, atteste de ce qu’Henry Rousso a établi concernant les modalités communes de la construction du souvenir à savoir que :
« Partout où des peuples, des nations, des groupes sociaux se trouvent confrontés au legs d’un évènement traumatique – guerre, dictature, génocide –, s’impose l’idée qu’il faut lutter contre l’oubli qui menace et faire le plus rapidement possible la lumière sur les évènements passés. […] » (Rousso, 2016 : 276). Or, force est de constater que « Partout où l’emporte cette « volonté de mémoire », on trouve des aspirations et des formes d’action comparables. […] Les associations de disparus en Argentine et au Chili en sont des exemples les plus connus : elles ont permis de passer d’une politique du « faire disparaître » à une politique du « faire apparaître ». » (Rousso, 2016, p. 279). ».
Dans ce contexte, le choix d’arrimer cette mémoire à un élément de l’environnement témoigne d’une volonté de remédier à l’incertitude générée par la disparition en opérant par analogie. Pour leurs familles, les disparus sont « comme » des étoiles. Même si on ne les voit pas, on sait que, comme « les étoiles, [ils] sont là, [ils] restent là […] » (José Antequera, mars 2022) et que même si, comme les étoiles, ils peuvent être morts sans qu’on le sache, ils n’en demeurent pas moins « vivants, à travers notre mémoire et de nombreuses autres façons. Pour nous, ce qu’ils ont fait, c’est donner leur vie pour semer davantage de vie. Ce qu’ils voulaient, c’était les faire disparaître, mais ils n’y parviendront jamais ; c’est notre mission. » (Espinosa Moreno, 2022 : 157). Mais qu’en est-il de celles et ceux qui, portés disparus par leurs proches, sont toujours en vie et ne souhaitent pas qu’ils le sachent ?
- Face aux absents : l’enjeu du témoignage
Dans les conflits armés, qu’ils soient ouverts ou latents, les incertitudes entourant les pratiques de disparitions forcées sont nombreuses. Si l’on comprend aisément leurs dimensions existentielles, elles sont aussi productrices d’incertitudes systémiques (Dousset, 2018). Cela tient à deux raisons : leur caractère massif et leur pérennité. Dans ce double régime d’incertitude, le témoin occupe un rôle clé : il est celui par qui l’élicitation peut advenir. Ce n’est pas un « passeur de mémoire » : c’est un porteur de sens. Ses souvenirs ont un potentiel heuristique essentiel : ils peuvent dénouer la catastrophe, qu’elle soit heureuse ou malheureuse, et réhabiliter la mémoire du disparu dont le sort reste incertain. Pour les familles victimes de ces disparitions, cette réhabilitation est essentielle pour leur travail de deuil, mais aussi pour leur vie quotidienne. Car si on a besoin des autres pour se souvenir, on a aussi besoin des autres pour oublier la douleur de la perte (Rousso, 2016, p. 16) et pour investir le quotidien. Dans ce travail de réminiscence, les souvenirs s’articulent en récits mémorables pour attester aux vivants la dignité de ces morts incertains et restaurer leur place dans le contemporain. C’est en cela que « le témoin est une figure centrale des communautés humaines. Par son entremise, on peut relier le passé et le présent : le passé de ce qui a eu lieu et le présent de son attestation » (Hartog, 2017, p. 169).
Pour autant, le témoin ne peut à lui seul être un porteur de vérité. Il en est le médiateur et bien qu’il occupe « une place reconnue dans la procédure, elle n’est pas centrale : il n’est qu’un élément de preuve que l’orateur peut mettre en valeur, s’il lui est favorable ou, au contraire, minimiser, s’il lui est contraire » (Hartog, 2017, p. 170). En cela, le témoin témoigne toujours au nom de tiers : il partage ce qu’il a vu afin de faire la lumière sur ce qui fut, mais parfois aussi, il partage ce qu’il a fait, afin d’établir ce qu’il en est.
Cette ambivalence du témoin délégué (Hartog, 2017) est au cœur des activités réalisées par l’Unité de recherche des personnes portées disparues (UBPD). Créée en 2016 dans le cadre des Accords de Paix, l’UBPD instruit des enquêtes à la demande des familles victimes de ces disparitions. Elle est sollicitée par les « témoins délégués » des victimes, en l’occurrence leurs proches qui, dans le contexte colombien, sont considérés comme des victimes à part entière. Cette démarche conduit les enquêteurs à dialoguer avec d’autres témoins délégués ayant un lien direct ou non avec la disparition. Dans les deux cas, ces témoins sont appelés afin d’établir des actes de transgression. Pour cette raison, amorcer une recherche avec l’UBPD ne peut se faire qu’à la demande des familles. La recherche qui s’engage est un processus volontaire dont l’issue reste incertaine et qui, par ailleurs, doit tenir compte de la volonté des victimes, certaines d’entre elles ne souhaitant pas retrouver de corps, mais connaître l’histoire de la disparition :
« Ce que tu dois bien comprendre, c’est que nous, on ne cherche pas des corps. On cherche des personnes. On ne va pas commencer à creuser sur tout le territoire. Ce qu’on fait, c’est une enquête avec pour objectif de découvrir ce qu’il s’est passé. Pour nous, l’objectif, c’est d’apporter des réponses aux familles, pour qu’elles puissent faire leur deuil. Les victimes ont le droit à la vérité. Et des fois, c’est arrivé, on retrouve les gens vivant. […] Dans ces situations, on se doit de respecter un « droit à l’oubli ». Si la personne ne souhaite pas être retrouvé, alors on dit à la famille qu’on est remonté jusque-là et que la piste s’arrête là. […] Le droit à l’oubli, c’est essentiel, car sans ce droit, personne ne nous parlerait. Nos enquêtes reposent sur un principe extrajudiciaire. Sans ce principe, les gens ne nous parleraient pas. On agit sous couvert du droit humanitaire international. Et c’est parce qu’ils savent qu’on ne pourra pas utiliser nos enquêtes dans le cadre d’un procès qu’ils nous racontent ce qu’il s’est passé. […] Comme, par exemple, découvrir qu’une personne portée disparue depuis plus de dix ans, et bien en fait, son corps se trouvait dans un terrain à côté du village, et que le voisin le savait parce qu’il a été réveillé par les acteurs armés en plein milieu de la nuit pour utiliser sa tractopelle et que s’il n’a rien dit, c’est parce qu’alors, il aurait été considéré comme complice, même sous la menace ». (Extraits d’entretiens, mai 2022).
Ces processus volontaires n’ont pas pour finalité d’exhumer des corps, mais de reconstruire la série d’événements qui a conduit cette personne, en particulier, à disparaître. Il s’agit donc de « faire apparaître » les logiques sous-jacentes au déploiement d’une violence ayant conduit à « faire disparaître » des civils, mais aussi des combattants. Pour exhumer un corps, il faut être en mesure d’avancer des preuves attestant de sa potentielle présence sur un lieu. Ce n’est qu’à cette condition que la fouille est autorisée, et si « l’exhumation révèle la présence d’autres dépouilles, par exemple dans une fosse commune, on n’a pas le droit de les toucher. On peut les enregistrer, mais pas les manipuler. Nous, on cherche des personnes, pas des corps, simplement parce qu’il n’y a pas toujours de corps. Des fois, on trouve des fours crématoires. Alors comment on fait ? On ne peut pas ne rien faire. » (Extraits d’entretien, avril 2022)[7].
La mission de la UBPD a pour principal objectif de rétablir la dignité de la vie humaine. Cela vaut pour les personnes portées disparues, mais aussi pour les personnes buscadoras[8]. C’est en ce sens que la UBPD « cherche des personnes ». Son travail consiste à garantir aux « victimes […] le droit à la vérité », ce pour quoi il cherche à lever le voile sur l’histoire des personnes qu’elles recherchent. Parfois, ces histoires conduisent à retrouver la personne dont la disparition avait été signalée. Et parfois, ces personnes sont en vie. Dans ce contexte, c’est toujours parce que prévaut la dignité de la personne que la mission opère selon le principe du « droit à l’oubli ». Ce droit établit que si « on retrouve les gens, [et que la personne] ne souhaite pas être retrouvée, alors on dit à [ses proches] qu’on est remonté jusque-là et que la piste s’arrête là ». En cela, c’est bel et bien le processus de recherche qui entend rétablir la dignité des vivants, pas son issue.
En effet, en mobilisant l’UBPD, les familles des victimes savent qu’elles ne pourront pas poursuivre les responsables de la disparition. Alors quel est l’intérêt pour elles ? Comment justice leur est-elle rendue dans ces processus ? Pour répondre à ces questions, il faut regarder du côté des politiques de reconnaissance permises par ces dispositifs. Cette reconnaissance, parce qu’elle lie un ego (la victime) et un alter (victimaire) par l’intermédiaire d’un tiers (le disparu), offre la possibilité de comparer des incomparables et, ainsi, de les égaliser (Ricoeur, 2004, p. 238) en créant des ponts communs dans l’expérience de la guerre. Ces ponts mettent en exergue la perte qu’expérimente les acteurs pris dans un conflit armé. Aussi, la UBPD cherche tout autant à identifier et, éventuellement, à restituer les corps de civils exécutés par « erreur », que ceux ayant fait l’objet d’un règlement de compte ou ceux tués au combat.
Ces ponts sont indispensables pour penser la paix. Ils lui donnent une substance qui la situe au-delà des négociations. Centrée sur l’accompagnement du travail de deuil, cette recherche commune contractualise le fondement d’un « Nous indivisés » (Clastres, 1977). Elle fait prévaloir l’importance de maintenir vivant le souvenir des êtres chers par-delà les circonstances de leur mort tout en appuyant que le respect de la vie humaine prévaut sur le sens que l’on prête à sa perte. L’inversion de ce rapport mort-vie entérine la nécessaire prévalence de la dimension biographique des disparus du conflit armé interne sur la dimension biologique de leur existence. Avant d’être des corps, ces combattants, militants et opposants furent des personnes arrachées à leur milieu de vie et, face à cette perte, il ne peut y avoir de hiérarchisation dans la souffrance de celles et ceux qui leur ont survécu. C’est parce que ces corps comptent encore que la négociation de la paix se justifie. Cette inversion est nécessaire à l’avènement d’une paix positive, qui doit s’attacher tout autant à la défense des vivants qu’à celle du souvenir de leurs morts. En effet, pour que l’état de paix émerge, la reconnaissance doit s’exprimer de manière mutuelle, ce qui implique qu’elle soit investie d’un caractère réciproque. Or, la figure du disparu permet cette réciprocité, car son cas reste ouvert. Dans la mesure où « on ne sait pas où elles sont » ni « de quoi il en retourne », les processus de recherche menés pour retrouver ces personnes rendent manifeste l’étendue des pertes générées par l’expérience de la guerre et, en premier lieu, la perte de sens. Parce qu’elles reposent sur la libération de la parole, ces recherches ne peuvent aboutir sans les autres. Elles tendent ainsi à créer une unité situationnelle entre victimes, victimaires et concitoyens qui, invitant à penser au-delà du conflit et des acteurs qu’il a engagé, ouvre l’accès aux espaces commémoratifs et légitime la présence du témoin. Les contre-monuments font partie intégrante de ces espaces et font de nous des témoins-délégués de ces crimes contre l’humanité.
Notes de fin
[1] Plusieurs acteurs armés coexistent en Colombie. Ils ne se sont pas tous démobilisés lors de la signature des Accords de Paix de 2016. Le pays enregistre donc toujours des affrontements armés protéiformes entre l’État, d’autres guérillas (notamment l’ELN – Armée de Libération nationale), des « groupes armés résiduels » (GAR – refus de démobilisation d’anciens membres guérilleros) ou encore des « groupes armés organisés » (GAO – monétarisation de la violence), l’enjeu du narcotrafic étant lié au maintien de ces dynamiques violentes.
[2]Congrès de la République de Colombie, art. 3, Loi 1448 de 2011
[3] Ces sources sont consultables sur la plateforme internet du Registre Unique aux Victimes et en suivant ce lien : https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/.
[4] Six d’entre elles dépassent le nombre de 100 000 victimes. Il s’agit du déplacement forcé par la violence, des homicides, des persécutions, des disparitions forcées, des confinements et des pertes de propriétés. L’ensemble des statistiques officielles relatives à ces infractions sont consultables en ligne sur la plateforme du Registre Unique aux Victimes du gouvernement de la République de Colombie (https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/).
[5] Comisión de la Verdad, 2022, “La noción de «enemigo interno»”, in No Mataras. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, 650 p. – ressources consultable en ligne en suivant ce lien URL: https://www.comisiondelaverdad.co/la-nocion-del-enemigo-interno. Forgée dans les années 1970, la figure de « l’ennemi intérieur » fut clé dans la stratégie militaire contre-insurrectionnelle en Colombie. Utilisée pour démanteler les mouvements armés irréguliers, elle explique souvent les crimes de guerre. Cette doctrine, ne distinguant pas combattants et civils, brouille l’État de droit. Employée durant la guerre froide, elle faisait de chacun une cible légitime.
[6] Chargé de mener des enquêtes sur les faits reprochés aux paramilitaires, le GMH a participé à la diffusion du concept de droit à la vérité en le déclinant dans une dimension à la fois juridique et historique. Sa création a été exigée par dont la création a été entérinée par la « Commission Nationale de Réparation et de Réconciliation », rattachée à la loi 975 de 2005.
[7] Lors d’une mission réalisée en mai 2025 pour le projet REPLICA COLVEN, j’ai pu constater que cette politique avait récemment changé. Depuis fin 2024, l’UBPD analyse tous les corps dits « à l’état de squelette » retrouvés sur les sites dits de « récupération » qu’elle prospecte. Ce changement est dû à des transformations administratives (baisse des ressources), structurelles (temporalité d’action du Système intégral pour la paix) et infrastructurelles (capacités accrues d’analyses biologiques). Bien qu'il ait accéléré l'identification des personnes disparues, il a aussi causé des tensions dans les processus de recherche, tant au sein des équipes qu'avec les acteurs armés présents sur le territoire. Les buscadoras et buscadores ont ainsi été confrontés à de plus nombreux cas de menaces, et d’obstruction à la recherche, certain ayant même été victimes d’homicides.
[8] Le terme « buscadoras » désigne les acteurs qui sont à la recherche d’un proche disparu.
Bibliographie
Agudelo C. (2006). « Dilemmes du multiculturalisme et populations noires en Colombie ». L’ordinaire latino-américain, 2006, 204, pp.119-138. ffhalshs-00158904f
Braudel F. (1958). Histoire et Sciences sociales : La longue durée. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 13 (4), pp. 725-753.
Butler J. (2010). Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil. Zones.
Clastres P. (1977). « Archéologie de la violence », in Libre, Paris, Payot, pp. 137-173.
Comisión de la Verdad (2022). No Mataras. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, 650 p.
Congrès de la République de Colombie, Loi 975, 2005.
Congrès de la République de Colombie, Loi 1448, 2011.
Congrès de la République de Colombie, Décret 4803, 2011.
Corten A. & Côté A.E. (dir) (2008). La violence dans l’imaginaire latino-américain. Presses de l’Université du Québec.
Daviaud S. (2010). L’enjeu des droits de l’homme dans le conflit colombien. Sciences Po Aix.
Dousset L. (2018). Pour une anthropologie de l’incertitude. CNRS Éditions.
Espinosa Moreno F. (dir) (2022). Memorable I: Experiencias ejemplares de construcción de memoria pública democrática en un período crítico. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
García Castro A. (2002). La mort lente des disparus au Chili sous la négociation civils-militaires (1973-2002). Maisonneuve & Larose.
Goffman E. (1975). Stigmate : les usages sociaux des handicaps. Les Éditions de minuits.
Grajales Jacobo (2016). Gouverner dans la violence. Le paramilitarisme en Colombie. Paris, Karthala.
Gutiérrez Sanín F. (dir), Wills Obregón M.E. & Sánchez Gómez G. (éds) (2006). Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia. Grupo Editorial Norma.
Hartog F. (2017). La présence du témoin. L’Homme [En ligne], pp. 223-224 | mis en ligne le 01 novembre 2019.
Lefranc S. (2022). Comment sortir de la violence ? : enjeux et limites de la justice transitionnelle. CNRS Éditions.
Nora P. (1984). Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux. Dans Les Lieux de mémoire - Tome 1 – Gallimard, pp. xv-xlii.
Nordstrom C. (1998). Terror Warfare and the Medicine of Peace. Medical Anthropology Quarterly, 12 (1), pp. 103-121.
Olsen Tricia D., Payne Leigh A. & Reiter A.G. (2010). Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy. United States Institute of Peace Press.
Quéré L. (1995). La valeur opératoire des catégories. Cahiers de l’Urmis [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 15 janvier 2002. DOI : https://doi.org/10.4000/urmis.435
Ricoeur P. (2004). Parcours de la reconnaissance. Stock.
Rodríguez Cuadros J.D. (2016). Référendum pour la paix en Colombie. Problèmes d'Amérique latine, 102(3), pp. 131-134.
Rousso H. (2016). Face au Passé. Essai sur la mémoire contemporaine. Belin.
Salcedo Fidalgo A. (2015). Víctimas y trasegares: forjadores de ciudad en Colombia 2002-2005. CES.
Sánchez Gómez G. (2021). Caminos de guerra, utopías de paz Colombia: 1948-2020. Editorial Planeta Colombiana.
_____(2020). Memorias, subjectividades y politíca. Crítica Colombia.
Terray E. (2000). L’histoire et ses possibles. Le Genre humain, 35.
Tous, Carlos (2020). Encontrar la paz en Colombia: entre acuerdos, perdón y reconciliación. Quaina, 9.
Vera Lugo J.P. (2015). «Memorias emergentes: las consecuencias inesperadas de la Ley de Justicia y Paz en Colombia (2005-2011). Estudios Socio-Jurídicos, 17(2), pp. 13-44.
Doi: dx.doi.org/10.12804/esj17.02.2015.01
Wills Obregón M.E. (2022). Memorias para la paz o memorias para la guerra. Crítica Colombia.
Pour citer cet article :
Duriez, T (2025). À nos corps célestes. Figurer la disparition forcée en Colombie : le témoignage comme enjeu de mémoire et politique de réparation. Rita (18). Mise en ligne le 15 septembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/a-nos-corps-celestes-figurer-la-disparition-forcee-en-colombie-le-temoignage-comme-enjeu-de-memoire-et-politique-de-reparation-tiphaine-duriez.html
Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()



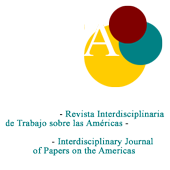





 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8