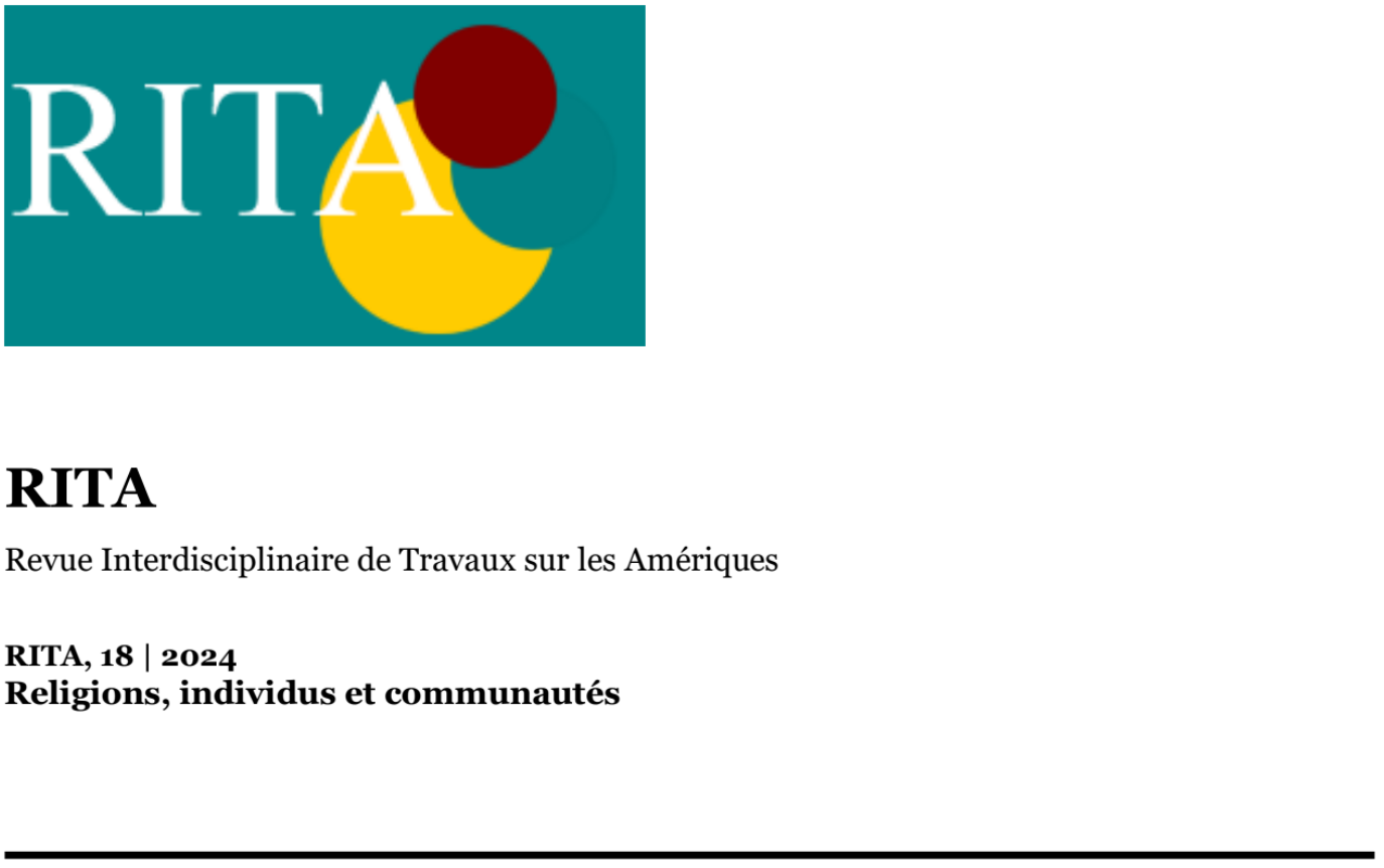
Rajneeshpuram : une communauté néolibérale dans l'Amérique de Reagan ?
Résumé
La communauté de Rajneeshpuram, fondée en 1981 dans l’Oregon, constitue l’une des plus remarquables constructions d’une société utopique au XXe siècle, tant son succès et sa chute furent foudroyants. Son fondateur, le premier vrai « gourou international », Rajneesh professait une pensée unissant illumination spirituelle et jouissance matérielle. Cet article propose de comparer le fonctionnement et l’organisation de cette communauté aux principes fondateurs du néolibéralisme, alors triomphant dans l’Amérique de Ronald Reagan. Sont mis en lumière les points communs et les divergences tant aux niveaux politiques et économiques qu’au niveau de l’éthique et de la conception anthropologique.
Mots clés : Rajneesh ; néolibéralisme ; gourou ; histoire des religions ; utopie.
Rajneeshpuram: a neoliberal community in Reagan’s America?
Abstract
The Rajneeshpuram community, founded in Oregon in 1981, is one of the most remarkable constructions of a utopian society in the twentieth century, such was its success and downfall. Its founder, the first true ‘international guru’, Rajneesh, professed a way of thinking that combined spiritual enlightenment and material enjoyment. This article compares the operation and organisation of this community with the founding principles of neoliberalism, then triumphant in Ronald Reagan's America. It highlights the similarities and differences at both political and economic levels, as well as in terms of ethics and anthropological conception.
Key words: Rajneesh; neoliberalism; guru; history of religions; utopia.
------------------------------
Anthony Keller
Docteur en histoire des religions
Université de Strasbourg
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Rajneeshpuram : une communauté néolibérale dans l'Amérique de Reagan ?
INTRODUCTION
« The only religion which has synthesized capitalism and religion together[1] » : c’est ainsi que Ma Anand Sheela, bras droit de Rajneesh (1931-1990), décrivit le mouvement du maître indien au milieu des années 1980. Derrière la provocation, cette formule résume l’ambivalence d’une communauté religieuse qui, tout en prétendant offrir une alternative à l’ordre établi, en incarna peut-être l’une des expressions les plus accomplies. Fondée en 1981 dans l’Oregon autour du Big Muddy Ranch, la cité de Rajneeshpuram fut qualifiée de « spiritual bazar[2] » dirigé par un gourou considéré comme « the spiritual counterpart of Reagan[3] ». Malgré son effondrement rapide en 1985 à la suite de scandales criminels, elle continue d’interroger quant à l’intégration des nouveaux mouvements religieux dans les dynamiques politico-économiques contemporaines.
Né en Inde dans les années 1930 au sein d’une austère famille jaïn, Rajneesh Chandra Mohan Jain devient professeur de philosophie à l’université de Jabalpur en 1960, après une formation marquée par l’héritage colonial britannique. Très vite, il délaisse l’enseignement universitaire pour se consacrer à des conférences où il expose une vision du monde singulière, mêlant rationalisme et spiritualité. Son charisme attire les foules, ses livres deviennent des best-sellers, et il se consacre entièrement à sa mission de gourou. Son enseignement, « religionless religion », rejette tout dogme, prône l’éveil spirituel autant que la jouissance matérielle, richesse et sexualité comprises. À Pune, il fonde un ashram qui devient un centre prospère, attirant des milliers d’Indiens et d’Occidentaux. Pour encadrer cet essor, Rajneesh délègue la création de « buddhafields » à travers le monde : on compte environ 300 000 disciples en 1981 et près de 500 000 en 1985[4].
À la fin des années 1970, près de 30 000 visiteurs annuels saturent l’ashram de Pune[5]. Après une tentative d’assassinat en 1980 et des conflits fiscaux avec l’État indien, Rajneesh quitte le pays pour s’installer aux États-Unis, où il fonde Rajneeshpuram, une ville surgie au cœur du désert de l’Oregon. Rapidement, la communauté devient une cité moderne de plusieurs milliers d’habitants[6], loin d’un quelconque cliché hippie, dotée d’infrastructures complètes : aéroport, université, commerces, cliniques, police, presse et services publics[7]. Selon Bob Mullan, le disciple type est « ‘middle-class’, well educated, professionally qualified, has been divorced at least once, has suffered a ‘personal crisis’, has been through mysticism, drugs, politics, feminism and is ‘thirtyish’-in short, the counter-culturalist brought up to date[8] ». D’autres études confirment cette image d’une population majoritairement blanche, féminine, jeune, diplômée et aisée[9].
Face à la nature éclectique des enseignements de Rajneesh, il est aisé de le situer dans la continuité de l’Human Potential Movement[10], des nouveaux mouvements spirituels ou du désenchantement occidental face à l’échec des cadres traditionnels. Comme le notait Christopher Lasch, les années 1970 marquent une perte de confiance dans les solutions politiques et un repli vers l’individu[11]. Toutefois, notre approche diffère : nous considérons aussi le contexte politico-économique marqué par la consécration du néolibéralisme. Les métaphores économiques entourant Rajneesh — « who has cornered the market on enlightenment[12] » — illustrent bien cette imbrication entre spiritualité et capitalisme. Si Max Weber opposait charisme religieux et rationalité économique, Urban remarque qu’« in the deterritorialized context of late capitalism, the fluid, flexible, ecstatic quality of charisma is by no means incompatible with the marketplace; on the contrary, it may even be the very epitome[13] ». Cet article approfondira cette intuition en comparant les théories et pratiques néolibérales avec celles de Rajneeshpuram.
Cette approche repose sur plusieurs constats. Bien que Rajneesh ne se soit jamais présenté comme économiste ou penseur politique, il fonda une communauté organisée, efficace et économiquement capitalistique, contrastant avec les idéaux collectivistes d’autres groupes similaires. Ses prises de position sur divers dirigeants, américains ou indiens, révèlent une pensée politique diffuse, mais réelle. Enfin, confronté à des problèmes matériels concrets, Rajneesh dut y répondre par des choix politico-économiques originaux, en résonance avec les mutations contemporaines.
En effet, les États-Unis des années 1970-1980 connaissent en effet la fin du « vieil ordre libéral », théorisé par Hayward[14], et la victoire du néolibéralisme, consacrée par Paul Volcker à la Fed et Ronald Reagan à la présidence. Cette doctrine, apparue lors du colloque Walter Lippmann en 1938, puis structurée autour de Hayek et de la Société du Mont-Pèlerin en 1947, prône la liberté individuelle et le libre-échange[15]. Comme le souligne Biebricher, « la problématique néolibérale concerne les conditions politiques et sociales de possibilité du fonctionnement des marchés[16] ». Pour Vallier, il s’agit d’« une doctrine politico-économique qui englobe le capitalisme libéral robuste, la démocratie constitutionnelle et un État-providence modeste[17] », tandis que Harvey la définit comme une « théorie des pratiques économiques […] au sein d’un cadre institutionnel caractérisé par le libre-échange, le marché libre, et de solides droits de propriété privée[18] ». L’État n’a plus qu’un rôle d’arbitre, garant de la stabilité monétaire et juridique. Michéa en retient trois traits[19] : neutralité axiologique, pessimisme anthropologique et scientisme[20]. Le néolibéralisme apparaît ainsi comme un courant polymorphe et non un bloc homogène, certaines mesures pouvant y être rattachées sans adhésion complète à ses principes[21].
Ces précisions permettent d’utiliser le néolibéralisme comme outil comparatif. Nous étudierons donc la genèse et le fonctionnement de Rajneeshpuram à travers ce prisme, afin d’en dégager convergences et divergences. Nous nous demanderons dans quelle mesure l’épopée rajneeshite s’insère dans le basculement néolibéral des années 1970-1980, en interrogeant les causes de son succès et de son effondrement. Nous examinerons d’abord la dimension politique et institutionnelle de la communauté, puis ses pratiques économiques, avant d’aborder la question anthropologique, afin de confronter les visions de l’homme chez Rajneesh et chez les penseurs néolibéraux.
I. Rajneesh, l’État et la démocratie
A. L’épineuse question des opinions politiques de Rajneesh
Questionner l’orientation politique d’une communauté dirigée par un leader charismatique comme Rajneesh implique d’examiner ses opinions personnelles. Sa jeunesse fut marquée par des positions éclectiques : proche de mouvements socialistes ou communistes, il fréquenta aussi des membres de l’Indian National Army et du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mouvement nationaliste hindou d’extrême droite[22]. Sa pensée se structura tôt et visa particulièrement Gandhi (1869-1948), critiqué pour son attention aux pauvres au détriment de la modernité[23]. De plus, Rajneesh accusa Morarji Desai (1896-1995), Premier ministre indien de 1977 à 1979, d’être un « cunning fascist[24] » lors de conflits judiciaires avec son mouvement.
Si le terme « fascist » témoigne d’une répulsion pour les régimes totalitaires, ses écrits contiennent surtout des critiques envers les hommes politiques, perçus comme incapables de libération spirituelle à cause de leur ego. Dans The True Sage, il affirma :
« Souvenez-vous toujours, la rébellion est la substance même de la religion […]. Un rebelle est en rupture. Il ne se soucie pas de cette société ou de n’importe quelle société. Il sait que toutes les sociétés seront des prisons. Au mieux, elles peuvent être tolérées – c’est tout. Il n’y a aucune possibilité de société réellement libre. La société ne peut pas être libre. Aucune révolution ne l’emportera ; toutes les révolutions ont échoué » (Rajneesh, 1975, p. 90).
Ce pessimisme social conduit au repli sur soi et sur la communauté religieuse, seul échappatoire à un monde ravagé par l’égotisme, rappelant la maxime de Margaret Thatcher (1925-2013) : « There is no society ».
Rajneesh développa également un puissant anti-communisme, en réaction à l’Inde pro-soviétique et à toute intervention américaine qu’il jugeait injustifiée. Il défendait la propriété privée et refusait qu’un système politique dominant la menace[25]. Son parcours révèle un opportunisme marqué : après avoir fréquenté divers groupes, il se posa comme défenseur des libertés individuelles contre les États indien et américain qu’il considérait comme oppressifs. Sur ce point, on note une convergence avec le néolibéralisme : méfiance envers l’État, individualisme, et protection des libertés face aux contraintes. Toutefois, Rajneesh pousse cette logique plus loin que les néolibéraux, qui considéraient l’État comme régulateur nécessaire d’une société exposée à des forces imprévisibles. Il reste à examiner la pratique politique concrète au sein de Rajneeshpuram.
B. Rajneesh face aux lois : théorie et pratique
L’un des principes le plus ancré dans les œuvres néolibérales est la puissance et le respect dû à l’État de droit[26], en particulier chez Hayek. En d’autres termes, il est nécessaire de suivre scrupuleusement les règles définies pour encadrer la société afin de conserver au mieux le cadre qui en est le garant. Au milieu des années 1980, alors que les autorités fédérales américaines s’opposent durement à la communauté de Rajneeshpuram, le gourou parsème ses discours de références à la Constitution américaine qu’il invoque pour se protéger :
« Et pour moi, l’Amérique est peut-être le seule espoir l’humanité, parce que la constitution américaine est la seule constitution authentiquement démocratique. Cela créé un problème pour les politiciens américains, parce que ces politiciens ne sont pas démocratiques […] Nous nous battrons pour la Constitution de l’Amérique contre ces Américains qui la prostituent. […] Nous sommes venus au pays légalement, et j’ai choisi cet endroit à cause de mon amour immodéré pour la Constitution Américaine. Elle est plus sainte que la Sainte Bible, parce qu’elle nous donne à tous les valeurs démocratiques de la vie : individualisme, propriété individuelle, liberté de parole, liberté d’information (Rajneesh, 1985)[27] ».
Alors qu’il frôlait l’expulsion, Rajneesh usa habilement de la Constitution américaine pour susciter la sympathie, révélant toutefois une relation particulière à la loi. À Mumbai, lui et sa communauté durent se défendre contre des locataires les accusant d’occupation illégale ou de paiements irréguliers[28]. Les journalistes soulignèrent le caractère procédurier de l’organisation naissante[29]. À Pune, le Shree Rajneesh Ashram, enregistré comme caritatif et à but non lucratif, générait pourtant d’importants flux financiers via la vente de livres ou de séances de méditation et de yoga. Face au fisc indien, qui multiplia les amendes jusqu’à cinq millions de dollars[30], Rajneesh quitta l’Inde pour les États-Unis.
Aux États-Unis, malgré ses louanges du système légal, le caractère procédurier des rajneeshites s’accentua. Rajneesh obtint son entrée sur le territoire au motif de soins particuliers, faussement invoqué malgré une santé réellement fragile. Dans les années 1980, l’INS releva de nombreuses fraudes à l’immigration et mariages blancs[31], ce qui illustre, selon Deneen, la faiblesse du néolibéralisme : sa dépendance à l’immigration et à la souplesse des lois[32].
Le problème majeur fut l’aménagement du Big Muddy Ranch. Si la municipalité fut approuvée, plusieurs installations furent jugées illégales par 1000 Friends for Oregon, qui multiplia les recours devant l’Oregon Land Conservation and Development Commission (OLCDC)[33]. En réponse, le Rajneesh Legal Services Corporation (RLSC), avec huit employés et de nombreux bénévoles, intenta des procès préventifs et surchargea administrativement ses adversaires[34]. Cette stratégie, très procédurière, reflète la culture juridique américaine mais montre aussi la volonté des rajneeshites de se présenter comme plus légalistes que la loi, malgré des pratiques contestées.
Ainsi, Rajneeshpuram se construisit en partie par cette lutte juridique, illustrant le désir d’intégration au droit américain. Cependant, de nombreuses irrégularités, présentes dès les premiers ashrams en Inde, témoignent d’une tendance à contourner la loi. Ce décalage entre théorie et pratique constitue une caractéristique essentielle du mouvement, résultant de la méfiance de Rajneesh et de ses disciples envers une société qu’ils considéraient comme dominée par la lutte égotique plutôt que par l’élévation spirituelle.
C. Rajneeshpuram: une « gouroucratie » autoritaire?
Malgré Capitalisme et liberté (1962) de Milton Friedman (1912-2006), la démocratie ne fut pas unanimement valorisée par les néolibéraux. Comme le rappelle Biebricher, « dit simplement, le dénominateur commun de toutes les opinions néolibérales sur la démocratie est la conviction qu’elle pose un problème plus ou moins sérieux[35] ». Si la démocratie apparaît, du point de vue néolibéral, comme le régime le plus apte à défendre l’individualisme et à renverser un mauvais gouvernement[36], elle n’est pas exempte de dangers : excès budgétaires, dérives bureaucratiques ou tyrannie de la majorité menaçant les droits des minorités. Plusieurs penseurs mirent ainsi en garde contre la démocratie illimitée comme contre le marché libre absolu. Hayek, notamment, développa dans La Constitution de la liberté (1960) et Droit, législation et liberté (1973) un système peu compatible avec la tradition démocratique, voire semi-autoritaire[37], allant jusqu’à envisager une dictature libérale temporaire destinée à instaurer une société libre. Hostile aux totalitarismes, il accueillit pourtant favorablement le régime d’Augusto Pinochet (1915-2006). Harvey rappelle que, de même, les États-Unis s’allièrent volontiers à des dictatures pour des raisons politiques ou économiques[38]. Ainsi, si la théorie néolibérale se réclame de la démocratie, sa mise en pratique demeure ambiguë.
Rajneesh partageait cette méfiance envers la démocratie. Bien qu’il valorisât les régimes protégeant les libertés individuelles, il voyait dans la compétition électorale une exaltation de l’ego. Aussi, les communautés rajneeshites ne présentaient-elles guère de structures démocratiques. À l’ashram de Pune, une forme « d’État-providence » existait, des services étant fournis en échange de travaux, mais le cadre restait strict : « Poona might have been considered a ‘funhouse’ and a ‘madhouse’, but it was far from being unregulated. There were numerous rules[39] ». Des gardes surveillaient les lieux, les entrées étaient contrôlées, et certaines substances, comme les drogues ou la cigarette, étaient prohibées. L’échec d’une précédente communauté à Kailash, marquée par le règne « tyrannique » de Cedric Sarkin, nommé par Rajneesh, témoigne de cette tension autoritaire[40]. À Pune, sa secrétaire Yoga Laxmi notait d’ailleurs que les gens étaient « under the discipline, the control and the orientation of Rajneesh[41] ».
Nous connaissons mieux Rajneeshpuram, dont la situation n’apparaît guère plus favorable. La ville reposait sur un réseau d’organisations étroitement imbriquées, dominées par Rajneesh et ses proches. Parmi les principales figuraient la Rajneesh International Foundation (RIF), « l’église de Rajneesh », organisation à but non lucratif aux États-Unis ; la Rajneesh Services International Ltd (RSI), basée à Londres, supervisant les opérations commerciales via la Rajneesh Financial Services Trust (RFST) ; et la Rajneesh Neo-Sannyas International Commune (RNSIC), chargée du ranch, de la sécurité et des complexes hôteliers. S’y ajoutaient la Rajneesh International Meditation University, aux droits d’inscription élevés, la Rajneeshpuram Peace Force et la Rajneesh Medical Corporation. Ce maillage formait un véritable labyrinthe administratif, déroutant les avocats adverses et concentrant le pouvoir décisionnel entre les mains de Rajneesh et de son cercle. En s’appuyant sur des professionnels qualifiés venus rejoindre la communauté, le gourou établit ainsi un ensemble d’institutions non démocratiques pouvant être qualifiées de « technocratiques », ce qu’Harvey voit comme la conséquence logique d’un régime néolibéral concret[42].
L’aspect le plus marquant fut néanmoins la dérive autoritaire du système. Les journalistes de The Oregonian rapportèrent que Rajneeshpuram disposait d’une force de sécurité privée de 150 membres et de deux agences de police — soit huit policiers pour mille habitants, contre 1,7 dans l’Oregon[43] —, ainsi qu’une forte concentration en armes dès 1983[44]. Un dispositif d’espionnage dirigé par Ma Anand Sheela, appuyé sur le département d’entretien, se mit en place : écoutes, délations, punitions[45], souvent sous prétexte de sécurité. Si l’attentat contre le Rajneesh Hotel de Portland, le 29 juillet 1983, en fut un déclencheur, la paranoïa qui s’ensuivit prit aussi une forme hygiéniste. La peur du SIDA, dans une communauté à la sexualité libre, entraîna des règles strictes : distribution de kits d’hygiène, interdiction des baisers et obligation de protections (gants en caoutchouc[46], etc.). Ce contrôle sanitaire s’accompagna d’une surveillance accrue, restreignant les libertés individuelles. Harvey rappelle que la manipulation des peurs fut également un outil politique chez Reagan[47] ; sans réduire le néolibéralisme à ce procédé, le parallèle s’impose.
La question de la responsabilité personnelle de Rajneesh dans cette dérive demeure débattue. Son état de santé aurait limité son implication, et lorsqu’en 1985 la communauté s’effondra, il accusa Sheela d’avoir transformé Rajneeshpuram en « camp de concentration à ciel ouvert[48] », alors qu’il affirmait l’année précédente qu’elle gérait « parfaitement » les affaires temporelles[49]. Faute de témoignages concordants, il reste difficile de trancher sur son rôle exact. Toutefois, son comportement monarchique plaide contre son innocence : il acceptait d’être traité en roi, si bien que les journalistes de The Oregonian décrivirent le ranch comme « court of the real, and Rajneesh its ruler[50] », selon le témoignage d’Hugh Milne. Terrin souligne d’ailleurs que le « culte au maître » fut un pilier originel du mouvement, et non une dérive tardive[51]. Rajneeshpuram, centre de « l’empire Rajneesh », édictait les normes suivies par les autres buddhafields dans le monde. Une seule contestation apparut en France : en 1982, Sheela fit fermer le Sangam Rajneesh Sannyas Ashram de Thorenc (Alpes-Maritimes), dont le succès menaçait l’autorité du centre[52]. Cette mainmise sur les périphéries illustre la logique de concurrence libérale où toute entité semblable devient rivale, à l’image d’entreprises en compétition[53].
Enfin, il faut noter que le seul moment où Rajneeshpuram tenta de jouer le jeu de la démocratie fut sa fin. En lutte contre les autorités fédérales, les autorités rajneeshites en vinrent à la conclusion que le seul moyen de gagner leurs procès et de débloquer les processus administratifs enclenchés était de prendre le pouvoir dans le comté de Wasco. Afin d’obtenir la majorité relative aux élections de 1984, Sheela lança le projet Share a Home ; pendant plusieurs semaines, des bus sillonnèrent la côte Ouest des États-Unis et amenèrent près de 4 000 sans-abris à Rajneeshpuram afin de les inscrire sur listes électorales et obtenir l’avantage démographique. Cette stratégie fut mise en échec par les autorités et enterra les espoirs rajneeshites. Toutefois, la veille des élections, des proches de Sheela empoisonnèrent à la salmonelle des bars à salade dans la ville de The Dalles, ce qui provoqua 45 hospitalisations, dans le but de réduire physiquement l’électorat de leurs adversaires[54]. Cette attaque bioterroriste sonna le glas de Rajneeshpuram, qui se délita et fut dissoute l’année suivante, suite à cette spectaculaire tentative de fraude électorale.
A la lumière de ces éléments, il nous faut constater que la communauté de Rajneeshpuram n’a jamais été une démocratie, ce qui fut peut-être caché dans un premier temps par ce que Mullan appelait une « benevolent dictactorship[55] », où les pratiques autoritaires, dont nous avons constaté la présence bien avant l’installation du cœur du système Rajneesh dans l’Oregon, étaient acceptées par les disciples au point qu’elles ne pouvaient être identifiées comme telles. Ainsi, nous trouvons là un important point commun entre le néolibéralisme et Rajneesh, à savoir une défiance assumée envers toute pratique démocratique, soutenue par un discours se voulant en revanche légaliste et démocratique. En ce qui concerne la dérive « finale » du mouvement, nous pouvons la mettre en parallèle avec la transition qu’Harvey identifie entre néolibéralisme et néoconservatisme : ce dernier, constatant les échecs du premier, proposa une alternative où les tendances antidémocratiques étaient plus assumées en même temps qu’un raidissement autoritaire[56]. D’une certaine manière, Rajneeshpuram connut aussi cette transition, à la différence qu’elle ne se fit pas en trente ans, mais en quatre seulement.
D. Au sein de Rajneeshpuram : hiérarchie et élitisme
Un dernier point doit être mis en lumière pour comprendre l’approche politique de Rajneesh. Nous avons que l’enchevêtrement de structures abstraites et spécialisées empêchait, par leurs structures technocratiques, tout mouvement démocratique. Toutefois, même lorsque des décisions devaient être prises en-dehors de leurs champs d’action, aucune forme « d’appel au peuple » n’était envisagée.
La cité de Rajneeshpuram disposait d’un conseil municipal, au sein duquel siégeaient uniquement des membres de « l’église rajneeshite ». En effet, une hiérarchie existait en son sein : si le sommait était tenu par Rajneesh et ses proches, dirigés par Sheela, l’échelon inférieur était constitué d’un groupe appelé les acharyas, ministres chargés de gérer « religieusement » et « civilement » les naissances, les morts, les mariages et les cérémonies d’initiation. A un échelon inférieur se trouvaient les arihantas, qui ne pouvaient que présider aux cérémonies de mariage et de naissance[57]. A leurs côtés pouvaient se trouver d’autres personnes qui se distinguaient par leur pouvoir économique, notamment s’ils étaient fiduciaires ou grands donateurs à la Rajneesh Modern Car Collection Trust, chargé de gérer la quasi-centaine de Rolls-Royce de collections dont disposait le gourou.
Cette vision profondément élitiste de l’organisation politique semble entrer en contradiction avec un libéralisme où rien n’existe entre l’État et le citoyen esseulé. En l’occurrence, les capacités spirituelles et financières étaient deux moyens de s’élever socialement et politiquement et d’intégrer les structures du pouvoir qui organisaient la communauté. Cependant, ce serait négliger toute une partie de la littérature néolibérale à ce sujet. Nous avons vu que la démocratie générait chez ces auteurs une certaine méfiance. Hayek résolvait ce problème par l’établissement d’une dictature de transition ou par un système parlementaire antipluraliste, Buchanan (1919-2013) insistait sur l’élaboration d’une constitution très solide, mais Wilhelm Röpke (1899-1966) tranchait par son originalité en supposant comme dirigeant d’une société libérale une « nobilitas naturalis » composée de « saints laïcs » irréprochables[58]. En un certain sens, l’organisation politique de Rajneeshpuram combine la dictature d’Hayek, avec Rajneesh comme dictateur, et l’élitocratie de Röpke, avec le pouvoir du « clergé » rajneeshite et des financiers des institutions[59]. Cette dernière question, profondément économique, nous amène à nous questionner sur le rôle de l’argent au sein du système rajneesh.
II. Rajneesh et le spiritual business
A. Tout est marchandise
Considérer toute chose comme un objet à vendre ou à acheter est une critique récurrente du néolibéralisme. Certains mouvements religieux collectivistes ont mis en commun les biens de leurs membres, mais ce système fut violemment rejeté par les auteurs néolibéraux et ne correspondait pas à Rajneeshpuram. De nombreuses études soulignent au contraire le rapport étroit de Rajneesh à l’argent et son adhésion au capitalisme le plus libéral, faisant de lui un véritable « entrepreneur » sur le très prisé spiritual market, illustrant l’extension du libre-échange à tous les domaines de la vie sociale[60].
En janvier 1981, Rajneesh annonçait : « We certainly do create wealth, and this is only the beginning; it is not yet a money-making racket. Just wait… It will be! We are going to make as much money as possible[61] ». La collection de 93 Rolls Royce, d’une valeur totale de près de sept millions de livres sterling[62], ne servait pas seulement ses caprices, mais constituait un investissement rentable et exonéré d’impôts. Les disciples pouvaient y contribuer par des dons, la location de voitures ou des tombolas, et elles garantirent plusieurs fois des prêts bancaires de plusieurs millions de dollars[63].
Dès la première période de Pune, l’ashram fonctionnait comme un système financier habile et intégré. En 1980, un observateur département d’État américain comparait ses méthodes à Disneyland[64], où tout était pensé pour satisfaire les visiteurs. La communauté organisait chaque année des festivals d’été attirant près de 15 000 personnes, dépensant pour logement, nourriture et services[65], incarnant la « société de consommation » souhaitée par les théoriciens néolibéraux. Le lexique incitait à la consommation : Sheela proclamait « Drop the ego, drop the money[66] » et des boutiques proposaient des souvenirs, comme des T-shirts « Happiness is a positive cash-flow[67] ».
L’une des plus célèbres phrases de Rajneesh, « I sell enlightment[68] », ne semble être que la pointe émergée de l’iceberg. À Pune, les adeptes payaient plusieurs centaines de roupies pour des séminaires et thérapies présentés comme sur un buffet à volonté[69], excluant de fait les plus modestes. À Rajneeshpuram, les tarifs allaient de quelques dizaines à plusieurs milliers de dollars, incluant des cursus universitaires privés jusqu’au doctorat. De réels débouchés semblaient même possibles : certains diplômés vendaient leurs services à des entreprises comme IBM ou Volvo dans le cadre de cours de relaxation ou d’aide au management[70]. Parallèlement, le mouvement s’internationalisa via livres et cassettes audio. En parallèle, la majorité des revenus provenait de la vente des enseignements de Rajneesh[71], dont 312 ouvrages totalisant près de 40 000 pages sont aujourd’hui disponibles sur archives.org.
B. L’intégration de Rajneeshpuram aux dynamiques économiques
Le système économique rajneeshite fonctionnait en vase clos, auprès de disciples déjà acquis auxquels on vendait « de la spiritualité ». L’aspect religieux constituait le principal moteur de vente, mais la communauté sut aussi exploiter certains contacts avec le monde extérieur, notamment par la prolifération de « produits dérivés », soulignée par Harvey dans le cadre de la néolibéralisation des États-Unis[72].
La publicité joua aussi un rôle clé : en 1982, la Rajneesh Services International lança la campagne Invest in Rajneeshpuram !, vantant une expérience écologique alliant capital et créativité[73], alors qu’en réalité seuls trois centimes de chaque dollar investi allaient à l’agriculture, et 50 rajneeshites s’occupaient des travaux agricoles tandis que 250 s’occupaient de la comptabilité et des tâches financières[74]. Rajneeshpuram se dota également de structures pour fonctionner comme micro-société indépendante : réseau de cartes bancaires, droit de vendre des assurances en 1984, encore Rajneesh Travel Corporation. Le nom de Rajneesh fut traité comme une marque répétée pour susciter l’envie de consommer.
La communication interne et externe fut structurée : la Rajneesh Community Holdings Inc. possédait le Rajneesh Times, tandis que la Rajneesh Chamber of Commerce, créée en novembre 1983, disposait d’un bureau de relations presse pour recevoir des journalistes triés sur le volet[75].
Les contacts économiques avec l’extérieur furent limités, mais significatifs. L’installation dans l’Oregon dynamisa la région, les entreprises locales fournissant mobile-homes, outils et pneus[76]. Face aux ennuis juridiques, certains entrepreneurs soutinrent discrètement la communauté, génératrice d’activité et donc de revenus. Le président de la Rajneesh International Corporation proposa au Guardian (17 novembre 1985[77]) d’investir l’argent de Rajneeshpuram dans des secteurs extérieurs, notamment miniers, mais sans suite concrète.
Ainsi, bien que dotée des dernières modernisations économiques et financières, la communauté resta peu ouverte à l’extérieur : l’argent circulait surtout en interne, nuançant l’image de Rajneesh comme « gourou international » puisque les fonds n’étaient massivement réinjectés qu’au sein du vaste réseau rajneeshite.
C. Le modèle économique du système rajneeshite
Les difficultés financières de l’ashram de Pune tenaient davantage à son statut légal qu’à ses pratiques économiques[78]. Harvey définit l’État néolibéral comme « un appareil d’État ayant pour mission fondamentale de faciliter les conditions d’accumulation des capitaux et des profits, tant pour les capitaux nationaux que pour les capitaux étrangers[79] ». Cet objectif fut pleinement atteint par Rajneeshpuram, dont la fortune, estimée en 1983 à 37,3 millions de dollars, provenait pour un tiers de la vente des discours de Rajneesh[80]. L’achat du ranch lui-même résulta d’une série de manœuvres financières pilotées par Sheela.
À la base du système figurait un réseau bancaire international. Dès 1980, Sheela ouvrit un compte au Crédit Suisse, bientôt suivi d’autres à la Schweizerische Volksbank et à la Midlank Bank de Londres[81]. En octobre 1981, la Rajneesh Bank Limited fut créée aux îles Marshals. Une enquête estima qu’en 1983 la Rajneesh Services International (RSI) disposait de vingt-trois comptes à l’étranger (Angleterre, Suisse, Allemagne de l’Ouest, Pays-Bas, Australie[82]), témoignant d’une optimisation fiscale poussée et d’un souci d’échapper aux taxations étatiques. Installée à Londres en 1982, la RSI échappait aux saisies américaines tout en gérant voyages, opérations comptables et prêts entre structures rajneeshites[83]. Le système fonctionnait en réseau : la RSI collaborait avec le Rajneesh Financial Services Trust pour ses opérations aux États-Unis, la Rajneesh Neo-Sannyas International Commune pour les festivals, et inversement. Ainsi, trois principes régissaient cette économie : l’accumulation et la conservation du capital via l’optimisation fiscale ; une complexité administrative destinée à dérouter les autorités et multiplier les obstacles juridiques ; et un fonctionnement en vase clos limitant les recours extérieurs.
Mais au fondement de ce capital se trouvait le travail. L’organisation communautaire reposait sur le labeur quasi bénévole des disciples, jusqu’à douze heures par jour. Lors des procès, l’accusation affirma régulièrement : « One of the main strategies for the prosecution is to argue that Bhagwan is simply a ‘get rich quick’ capitalist, using religion to motivate a poorly-paid workforce. […] Bhagwan is clearly a capitalist of the worst order, not concerned with helping those in need[84]. » À Pune, la cantine dépendait du travail gratuit, expliquant sans doute le succès ultérieur de Rajneeshpuram grâce à une main-d’œuvre peu coûteuse et docile[85], le travail étant présenté comme moyen d’éteindre l’ego. Cette utilisation spirituelle du travail pour réduire les coûts illustre ce qu’Urban qualifie de « commune capitaliste[86] ».
Ainsi, l’économie rajneeshite combinait la maîtrise des outils financiers néolibéraux de l’Amérique des années 1980 avec une gestion autoritaire d’une main-d’œuvre motivée par la foi. Ce capitalisme intégral supprimait tout contre-pouvoir syndical en canalisant les affects des travailleurs dans un discours religieux, et les autorités rajneeshites semblaient connaître et assumer pleinement l’avantage économique que leur offrait la structure « spirituelle » de leur communauté. Comme le soulignait l’article « A New Direction for Capital », paru dans le Rajneesh Timese le 1er octobre 1982, Rajneeshpuram unissait les « sound principles of capitalism » et une fondation spirituelle, expliquant sa supériorité par rapport aux Reaganomics, fustigées dans la mesure où elles n’étaient pas « spiritually based[87] ».
D. Pourquoi le capitalisme ?
Les raisons de l’amour que Rajneesh professait à l’égard du capitalisme ne peuvent pas être cherchées uniquement dans la désaffection qu’il éprouva pour les gouvernements socialisants indiens qui le persécutèrent. Dès ses premiers discours, il manifesta une affection pour les jouissances matérielles et l’esprit d’entreprise capitalistique, dont sa propre aventure est peut-être un exemple. En octobre 1982, il déclara devant des officiels de l’immigration à Portland : « I don’t condemn wealth, wealth is a perfect means which can enhance people in every way, and make their life rich in all. I am a materialist spiritualist[88] ». En d’autres termes, la richesse n'était pas qu’un moyen, mais aussi une fin en soi. Selon lui, il était impossible de s’accomplir spirituellement si l’on était dans la pauvreté, car celui qui n’a pas le sou a des problèmes matériels concrets à régler : comment s’habiller, se nourrir etc., tandis que celui qui est riche est libéré de tous ces soucis et peut donc se consacrer pleinement à ses besoins spirituels[89]. Ce raisonnement s’accorde parfaitement avec les théories d’Abraham Maslow (1908-1970), dont la pyramide éponyme hiérarchise les besoins humains comme le fit Rajneesh. C’est aussi pour cette raison qu’il rejeta toute forme d’ascétisme, considéré comme une entrave au développement économique, et donc in fine spirituel[90].
Par ailleurs, les traditions hindoues dont se revendiquait Rajneesh ne lui apparaissaient nullement contradictoires avec ces faits. Ainsi, le néo-tantra prônait une libération de l’esprit passant par une libération intense de l’énergie sexuelle, par le biais de pratiques revendiquées par Rajneesh et qui lui donnèrent son titre de « sex guru ». De plus, il fut inspiré par la pensée de l’Advaita, c’est-à-dire de la non-dualité. En d’autres termes, il adopta une vision profondément holiste du monde : la divinité est partout et se manifeste partout, jusque dans la réussite économique individuelle[91]. Cette idée eut des conséquences pratiques très rudes. Bien que cela n’ait pas été particulièrement mis en avant par les autorités de Rajneeshpuram, les journalistes de l’Oregonian constatèrent que plusieurs personnes à qui les instances rajneeshites confièrent la gestion de certaines structures et qui avaient fait faillite ou les avaient mal gérées avaient été désavouées et exclues de la communauté[92], de la même manière que la main invisible du marché (néo)libéral évince toute personne peu efficace gérant mal les richesses dont elle dispose.
Pour conclure ce deuxième chapitre, nous pouvons en revenir à notre étude comparatiste où, là encore, nous constatons des points communs et des différences entre les structures de Rajneeshpuram et le néolibéralisme. D’un côté, les autorités de la communauté utilisèrent à plein régime les outils financiers que la victoire du néolibéralisme rendit disponible aux États-Unis dans les années 1980, et ils profitèrent de l’expertise aiguë de fiscalistes pour garantir l’accumulation de revenus en échappant au maximum aux taxations d’un État dont ils se méfiaient. En parallèle, Rajneesh construisit un discours religieux et spirituel en phase avec le capitalisme néolibéral et qui permettait de s’y fondre sans aucune difficulté. De plus, ce discours donnait à la communauté des fondements spirituels qui justifiaient son fonctionnement, mais qui permit aussi l’apparition d’une main d’œuvre qualifiée, travailleuse et très peu chère, expliquant en partie sa réussite économique. Toutefois, il semblerait que Rajneeshpuram ait été encore plus libérale que les néolibéraux. En effet, il n’existe à proprement parler aucune trace d’un état-providence et encore moins de réel soutien envers les personnes les plus défavorisées, alors même que les néolibéraux les plus convaincus permettaient l’existence de transferts d’argent depuis les autorités publiques vers la société civile dans certains domaines afin de lutter contre les inégalités trop criantes[93]. De ce point de vue, les affinités de Rajneesh sont peut-être à chercher plutôt du côté des libertariens.
III. Le rajneeshite est-il l’homme néolibéral par excellence ?
Après avoir constaté les structures politiques et économiques construites autour de Rajneesh et leurs points de contact avec le néolibéralisme, il convient de se concentrer sur un aspect moins matériel et souvent omis, à savoir les conceptions éthiques et anthropologiques qui sous-tendent une théorie politico-économique. En effet, il n’est pas difficile d’imaginer qu’un gourou bâtissant une communauté dispose d’une certaine vision de l’être humain et qu’il cherche à façonner ses disciples selon quelques principes plus ou moins fixés. En revanche, nous pensons qu’un tel processus a également lieu, de manière consciente ou non, dans toute théorie proposant un arrangement précis de la société à laquelle elle prétend s’appliquer. Ainsi, il est certain que l’idée de l’homme défendue par les régimes communistes n’a pas grand-chose à voir avec celle défendue par Ronald Reagan ou Friedrich von Hayek[94]. Dans cette dernière partie de notre étude, nous entendons proposer un comparatif entre le « nouvel Adam libéral » dont parlait Michéa[95] et l’homme tel que le concevait Rajneesh.
A. La fluidité comme horizon
Dans son article sur le néolibéralisme, Vallier soulignait l’absence de toute considération éthique et, chez Milton Friedman, un relativisme moral absolu où même la recherche du profit ne saurait constituer le centre d’une « bonne vie[96] ». Puisque la connaissance du bien est inaccessible, il s’agit surtout d’instaurer un cadre social et politique permettant à chacun de croître selon ses préférences, principe fondateur de la neutralité axiologique commune aux pensées néolibérales[97]. Cependant, cette indifférence est un positionnement moral en soi et produit des effets éthiques. Harvey observe ainsi que le libre-échange devient « une morale en soi, capable de fonctionner comme guide de toute action humaine et de remplacer toutes les convictions morales défendues jusqu’alors[98] », d’où les critiques d’un capitalisme réduisant les relations sociales à une rationalité économique[99]. Dès lors qu’aucune morale héritée n’est défendue, ces relations doivent trouver un autre ciment. Michéa en identifie deux : le marché autorégulateur et le « droit procédural », dont le point commun est l’absence de sujet[100]. L’éthique néolibérale construit ainsi un environnement fluide et neutre où chacun évolue au gré de forces extérieures autorégulées.
Cette logique rappelle le discours de Rajneesh, marqué non par l’abandon aux forces du marché, mais à des forces spirituelles indéfinies et imprévisibles[101]. Comme le marché, le monde n’a pas de sens en soi : il s’agit d’une puissance à laquelle on se donne sans se demander si elle est bonne[102]. Ce lâcher-prise favorise la cohésion communautaire : renoncer à maîtriser des forces supérieures apaise l’anxiété[103], le renoncement à l’ego encourage le don — illustré par les pratiques de Sheela[104] — et la neutralité axiologique facilite l’intégration des individus[105]. La fluidité du travail, où les disciples exerçaient des tâches interchangeables[106], assurait une grande souplesse et contribua à la croissance de Rajneeshpuram.
Enfin, la sexualité participait de cette fluidité. Libérée de tout interdit moral, elle devenait exploration et moyen d’élévation spirituelle. Les « groupes de tantra » permettaient d’exprimer sa sexualité, en paroles ou en actes[107]. Dans l’environnement capitalistique de Rajneeshpuram, la jouissance physique apparaissait à la fois comme voie d’accès à la spiritualité et comme moteur de consommation. Dany-Robert Dufour illustre cette alliance du capitalisme et de la sexualité par la métaphore du libéralisme à deux faces, incarné par Adam Smith et le Marquis de Sade[108]. Cette sexualité débridée, provocatrice, valut à Rajneesh le surnom de « sex guru[109] ».
Ainsi, la fluidité et la neutralité axiologique, racines du néolibéralisme, se retrouvent au cœur du mouvement rajneeshite. Rajneesh prônait l’accueil de tous sans jugement, ce qui explique la diversité — mais aussi les tensions et le raidissement politique — de Rajneeshpuram. Ce parallélisme éclaire la proximité profonde entre l’organisation rajneeshite et l’esprit du néolibéralisme dans leur conception du monde.
B. La liberté contre toute rigidité
Définir la liberté dépasse le cadre de cet article ; il s’agit plutôt de comprendre comment nos deux comparés l’envisageaient. Selon Michéa, la liberté est la seule valeur commune à tout le courant libéral, comprise comme le droit pour chacun de choisir arbitrairement ses valeurs privées, dans le respect de celles d’autrui[110]. Rajneesh, lui, en faisait le cœur d’une vision holiste : « Life is freedom. God is absolutely a freedom. You cannot have any fixed attitudes, fixed ideas. If you have them you will be in trouble[111] ». La liberté signifie l’absence de toute contrainte, en particulier mentale, imposée depuis l’enfance[112]. Elle suppose de « briser les digues » pour laisser circuler l’esprit : la métaphore de la fluidité y prend tout son sens. Les néolibéraux, eux, la conçoivent avec plus de retenue : une humilité épistémique garantissant la coexistence pacifique sans empiéter sur autrui[113].
Une conséquence majeure de cette conception est l’absence de convictions établies. Celles-ci sont « autorisées » tant qu’elles restent critiquables, d’où la formule de Pierre Manent, faisant libéralisme le « scepticisme devenu institution[114] ». Rajneesh radicalise cette idée : « We are not going to fail... We don’t have any dogma that can be criticized[115] ». Il n’intègre pas les croyances de ses disciples, mais prône leur effacement : « I have no pattern to give you, no values, no morality, I have only freedom to give you so that you can flower[116] ». À Pune, le panneau de bienvenue « Leave your minds and shoes here[117] » résumait cette exigence. Si cette approche facilita le recrutement, elle fragilisa la cohésion du groupe. Carter observait qu’une communauté privée de croyances communes recrée d’autres formes de cohésion : autorité charismatique, désignation d’un ennemi, confrontation ou exclusion[118] — processus propices à la dérive autoritaire, également relevés par Hayek[119]. Ainsi, la conception négative de la liberté constitue à la fois la force et la faiblesse du rajneeshisme comme du néolibéralisme.
L’accomplissement de cette liberté passe logiquement par la destruction des structures jugées rigides, comme l’illustre l’interchangeabilité des travailleurs[120]. Michéa note que « dans une société libérale devenue intégralement conforme à son concept […], toute limitation signifiée aux désirs ou aux caprices privés des individus ne pourrait donc être vécue que comme une intervention inadmissible de la collectivité, une « discrimination » inacceptable, ou une « stigmatisation » scandaleuse[121] ». Ce constat rejoint le mépris de Rajneesh pour l’autorité politique : « Who makes your laws? Who makes your constitutions? Who is responsible for running the society and arranging and managing the society? Just people as blind as you, maybe more learned, maybe more informed. But it makes no difference whether a blind man is more informed about light or less informed about light – a blind man is a blind man[122] ». Ce rejet de toute autorité caractérise les mouvements du New Age selon Heelas, où il inclut (prudemment) Rajneesh[123]. Il s’étendait aussi à l’institution du mariage, bien qu’elle subsistât à Rajneeshpuram[124]. Si le néolibéralisme fragilise lui aussi les grandes institutions (État, syndicats), aucun de ses penseurs n’alla aussi loin que Rajneesh — du moins dans le discours.
En pratique, les structures de Rajneeshpuram étaient loin d’être souples. Un ancien disciple affirmait que Rajneesh « autorisait tout[125] », mais pas pour tous. La communauté comportait un clergé hiérarchisé : les arihantas à énergie extravertie, les siddhas à énergie introvertie et les acharyas combinant les deux[126]. Cette hiérarchie, doublée d’une préférence pour les riches[127] — certains disciples furent exclus pour manque de moyens[128] —, contredisait le discours de fluidité. En réalité, la gestion du mouvement exigeait une organisation solide, indispensable à la maîtrise des flux financiers et démographiques.
C. L’ego et l’égalité
Face aux dynamiques du marché, chacun se trouve théoriquement dans un même état de dénuement : nul ne pouvant en prévoir les mouvements, tous sont supposés égaux devant ses bienfaits. De manière analogue, Rajneesh affirmait : « I declare to you your Buddhahood. Each person is born to be a Buddha[129] ». Cependant, cette égalité demeure théorique : dans les faits, le néolibéralisme comme Rajneeshpuram produisent une concentration du pouvoir et un accroissement des inégalités, critique régulièrement faite à l’encontre du néolibéralisme[130] et assumée au sein de la communauté de Rajneesh.
La conception de l’ego éclaire cette tension. Dans sa thèse (Université de l’Ohio, 2024), Madeline James inscrit Rajneeshpuram dans la Décennie du Moi et l’Human Potential Movement. Selon elle, la communauté participe du courant né dans les années 1960 valorisant le retour à soi et la liberté individuelle, rejoignant les démarches de la Gestalt Therapy, des Erhard Seminars Training, des Mind Dynamics et de l’institut d’Esalen[131]. Ces similarités montrent que le mouvement de Rajneesh s’enracine dans le même contexte que ces initiatives. James évoque ainsi la Me Decade de Tom Wolfe[132], période marquée par les désillusions politiques et l’atomisation sociale des années 1970, au moment même où s’affirmait le néolibéralisme, triomphant face à la chute du « vieil ordre libéral » : « Despite originating in India and most of their relevant history taking place in the 1980s, the Rajneesh were still a product of the cultural and political pressures of 1970s America[133] ».
Si Rajneesh puisa dans la philosophie indienne, il sut adapter son message à une génération individualiste : liberté et acceptation répondaient aux aspirations d’autonomie, tandis que l’idée d’une communauté unie offrait une réponse à la désagrégation du lien social. Il incarna ainsi à la fois l’apogée et une proposition de correction d’un système néolibéral. .
Enfin, James Buchanan rappelait que la pérennité du néolibéralisme repose sur un éveil moral, loin de toute considération anthropologique trop pessimiste : un homo economicus capable de reconnaître que le collectif prime sur l’individuel. « The reform that I seek lies first of all in attitudes[134] ». On peut toutefois douter qu’il ait vu en Rajneesh l’origine de cette « réforme »…
D. Une anthropologie de l’homme nouveau
Il serait une erreur de considérer que les discours de Rajneesh avaient pour seul objectif de rectifier l’homme contemporain. Tous ces propos sont orientés vers la création d’un homme nouveau dont le premier objectif serait de se transformer lui-même : « I am teaching you a way of being, a different quality of existence[135] ». L’homme de demain est celui qui vit dans le présent, et non dans le passé, où il n’y a rien à tirer les traumatismes et les émotions négatives dus à l’ego[136]. Il est fluide, créatif, vivant sans attache ni identité fixe[137].
Au cours de cette étude, nous avons constaté de nombreuses méthodes permettant de parachever cet objectif : s’intégrer à une communauté où l’on est fondamentalement un rouage interchangeable afin de briser l’ego, changer de nom[138], participer à des thérapies de groupe de méditation dynamique, qui consiste à redevenir un enfant en laissant aller tous ses caprices et ses envies, même les plus folles[139] et n’avoir en vue que la volonté de s’unir à un tout mal défini, mais transcendant[140]. De plus, l’un des moyens d’intégrer ce tout consiste à en expérimenter toutes les possibilités, d’où la nécessité de la jouissance matérielle en plus de toutes les autres : « We are exprimenting in a multi-dimensional way […] We are exprimenting with all the possibilities that can make the human consciousness whole and a human being rich[141] ». Cette citation rappelle les lignes de Milton Friedman dans lesquelles il affirmait que personne ne pouvant connaître le bien et le mal, il fallait que chacun expérimente au maximum les opportunités du monde pour se constituer sa propre éthique. D’un point de vue anthropologique, néolibéralisme et Rajneesh rejettent toute idée de péché originel : l’homme se construit au fur et à mesure de ses expériences et possède tout en lui-même. Ainsi, dès lors que le cadre posé est bon et ouvre les bonnes voies, la croissance se fera dans le bon sens.
La description de l’anthropologie rajneeshite ressemble à s’y méprendre avec le nouvel Adam libéral de Michéa, individu consommateur compulsif, maintenu en enfance et addict à la jouissance immédiate[142]. Dans sa recension de l’ouvrage de Dufour, Florence Bécar rappelle la thèse de l’auteur selon qui la pensée libérale procède de la posture philosophique de la libération des passions[143].
Il n’a jamais été simple de cerner une idée fixe chez Rajneesh, qui avait une propension à la provocation et à la contradiction assez remarquable. Cependant, des tendances peuvent être relevées et lorsque nous les synthétisons, force est de constater qu’elles nous permettent de construire une certaine vision de l’homme et de l’éthique qui devrait le gouverner et que celle-ci s’oppose moins qu’elle n’épouse ou complète les écrits et les pratiques néolibérales. Il serait difficile de parler d’adéquation parfaite, ne serait-ce que par les discours que chacun des partis tint sur l’autre, mais à la lumière de notre étude, l’homme rajneeshite et l’homme néolibéral apparaissent aussi proches que deux dialectes d’une langue commune.
Conclusion
Comparer une communauté religieuse et une théorie politico-économique est un exercice délicat, mais fécond. L’analyse menée ici a permis de dégager plusieurs convergences notables entre rajneeshisme et néolibéralisme. Tous deux reposent sur une vision anthropologique existentialiste et constructiviste, et sur une conception du monde dominée par des forces arbitraires – marché ou divinité – dépassant l’humain. De là découlent une neutralité axiologique et une quête de fluidité dans tous les domaines sociaux et individuels. Leur projet politique commun consiste à créer un cadre où l’homme peut croître de manière optimale, tandis que leur système économique valorise l’accumulation du capital. Politiquement, un écart persiste entre les idéaux affichés et la pratique : comme certains néolibéraux soutenant des régimes autoritaires, Rajneesh – ou Sheela – imposa une domination interne confirmant la critique d’Elizabeth Anderson, selon laquelle la réduction de l’État déplace, sans les abolir, les logiques de pouvoir[144]. Enfin, ces deux phénomènes s’inscrivent dans le contexte américain des années 1970-1980, répondant chacun à une même crise sociale.
Les divergences demeurent toutefois marquées. Le néolibéralisme conserve l’État-nation comme cadre politique, tandis que Rajneesh se voulait « citoyen du monde », hostile à toute frontière, et prônait une pensée proche de l’anarchisme ou du libertarianisme. Contrairement à Hayek ou Reagan, il ne défendait aucun ordre moral conservateur. Pourtant, son individualisme reste ambigu : la vie privée et la propriété étaient restreintes à Rajneeshpuram, la communauté reposant sur de nouveaux réseaux sociaux comparables à ceux d’autres mouvements religieux contemporains (évangélisme, Scientologie, etc.). Là où le néolibéralisme favorisait l’atomisation, Rajneesh construisit une cohésion sociale intense, parfois autoritaire. Par certains aspects, son projet évoque davantage les régimes « développementistes » d’Asie orientale, mêlant investissements publics lourds et politique néolibérale ciblée.
La disparition rapide de Rajneeshpuram – quatre ans après sa fondation – invite à interroger ses failles. Comme chez les penseurs néolibéraux tels Friedman, une tension existait entre idéal et réalité. Rajneesh crut réaliser une société trop parfaite pour durer : la rigidification doctrinale (clergé, Rajneesh Bible, « rajneeshisme ») contredisait son appel à la fluidité, tandis que l’absence d’un socle commun fragilisa la cohésion. L’empire financier, complexe et hypertrophié, trahit la simplicité prônée. La paranoïa politique et la désignation d’ennemis extérieurs accentuèrent encore l’autoritarisme. Ces dérives confirment ce que supposait Michéa, à savoir qu’« une utopie libérale ne peut se développer au-delà d’un certain seuil sans détruire ses propres conditions de possibilité[145] ».
Si le néolibéralisme vise la réduction maximale de l’État, Rajneeshpuram en offrit la version la plus extrême : un système ramené à un seul centre, l’ego du maître — ego qu’il invitait paradoxalement à dissoudre. Cependant, Rajneesh ne fut nullement le seul à proposer une communauté idéale, d’autres naquirent à la même période, sur le sol américain ou ailleurs, et un moyen de compléter notre étude serait d’étudier les dynamiques internes de ces mouvements, afin de constater leur proximité ou leur distance avec les grandes dynamiques politiques et économiques de leur époque.
Notes de fin
[1] James 2024, 18.
[2] Thompson & Heelas 1986, 80.
[3] Urban 2015, 134.
[4] The Oregonian 30.06.1985
[5] Mullan 1983, 23.
[6] L’absence de données de recensement exactes ne permet que des suppositions, d’autant plus que les résidents non-permanents venant des quatre coins du pays et du monde étaient fréquents. On peut supposer un nombre minimum de 2 000 habitants permanents, qui pouvait s’élever à près de 15 000 lors des festivals d’été.
[7] Thompson & Heelas 1986, 89-90.
[8] Mullan 1983, 51.
[9] Latkin, Hagan, Littman et Sundberg 1987.
[10] Terrin 1985, 94.
[11] Voir Lasch 1979.
[12] The Oregonian 01.07.1985.
[13] Urban 2015, 193.
[14] Hayward 2001.
[15] Harvey 2024, 22.
[16]« The neoliberal problematic concerns the political and social conditions of possibility for functioning markets », Biebricher 2018, 24.
[17] Vallier 2022.
[18] Harvey 2024, 23.
[19] A l’inverse d’une large partie de la bibliographie anglo-saxonne, les chercheurs français ont tendance à ne pas distinguer fondamentalement le libéralisme du néo-libéralisme.
[20] Michéa 2011-2012, 438.
[21] Harvey 2024, 183.
[22] Thompson & Heelas 1986, 13.
[23] Thompson & Heelas 1986, 16.
[24] The Oregonian 02.07.1985. Lorsque Rajneesh évoquait ses adversaires, de Desai à Ma Anand Sheela en passant par Ronald Reagan, l’accusation de fascisme et/ou de nazisme était très fréquente et ne semble pas témoigner d’une connaissance réelle et profonde que le gourou aurait eu sur l’Allemagne ou l’Italie des années 1930-1940.
[25] Urban 2015, 48-49.
[26] Vallier 2022.
[27] Rajneesh 1985, vol.8, chapitre « Where Do We Go From Here? ». Sauf indication contraire, toutes les citations de Rajneesh ont été extraites du site Internet oshoarchive.org (https://oshoarchive.org/LoginUser.php). Nous mentionnerons ici le titre de l’ouvrage et le chapitre dont est extraite la citation.
[28] The Oregonian 02.07.1985.
[29] Elle s’appelait la Jeevan Jagruti Kendra et fut fondée en 1965 par des hommes d’affaire que Rajneesh rencontrait lors des soirées mondaines de Mumbai qu’il fréquentait assidûment (The Oregonian 01.07.1985).
[30] Urban 2015, 104.
[31] The Oregonian 18.07.1985 et 19.07.1985.
[32] Deneen 2019.
[33] James 2024, 21.
[34] The Oregonian 11.07.1985.
[35] Biebricher 2018, 80. « Simply put, the common denominator of all neoliberal views on democracy is the conviction that it poses a more or less serious problem ».
[36] Vallier 2022.
[37] Biebricher 2018, 103-106.
[38] Harvey 2005, 71.
[39] Thompson & Heelas 1986, 21-22.
[40] The Oregonian 02.07.1985.
[41] The Oregonian 03.07.1985. Le témoignage de Laxmi doit être pris avec précaution : il fut récolté après qu’elle fût violemment évincée de son poste par Rajneesh et sa remplaçante, Ma Anand Sheela.
[42] Harvey 2005, 149.
[43] The Oregonian, 09.07.1985.
[44] The Oregonian, 10.07.1985.
[45] Ibid. L’une des punitions consistait à se voir attribuer une tâche particulièrement ingrate.
[46] Thompson & Heelas 1986, 26-27.
[47] Harvey 2005, 112.
[48] Thompson & Heelas 1986, 114.
[49] The Oregonian, 07.07.1985.
[50] The Oregonian, 01.07.1985.
[51] Terrin 1985, 96.
[52] The Oregonian 15.07.1985.
[53] Harvey 2005, 107.
[54] Urban 2015, 129-130.
[55] Mullan 1983, 118.
[56] Harvey 2005, 372-4.
[57] The Oregonian, 08.07.1985.
[58] Biebricher 2018, 140-142.
[59] Selon Harvey, les conséquences pratiques de la néolibéralisation amènent à la concentration du pouvoir entre les mains d’une classe réduite (Harvey 2005, 89).
[60] Harvey 2005, 35.
[61] The Oregonian 14.07.1985.
[62] Les comptes de la société qui les possédait étaient basés à Londres.
[63] The Oregonian 12.07.1985. L’article nous apprend qu’en 1982, ces manipulations financières apportèrent la somme de £ 498 784 à Rajneeshpuram. On y apprend aussi que dans les années 1970, à Denver, le gourou Maharaj Ji, fondateur de la Divine Light Mission, disposait aussi d’une collection de voitures de luxe. La technique n’est peut-être donc pas une invention de Rajneesh.
[64] The Oregonian 14.07.1985.
[65] The Oregonian 30.06.1985.
[66] The Oregonian 16.07.1985.
[67] The Oregonian 14.07.1985.
[68] Rauschenbach 2021.
[69] Thompson & Heelas 1986, 52.
[70] Heelas 1996, 63, 72, n.21.
[71] James 2024, 17.
[72] Harvey 2005, 79.
[73] The Oregonian 13.07.1985.
[74] The Oregonian 30.06.1985.
[75] The Oregonian 08.07.1985.
[76] Rauschenbach 2021, 80.
[77] Thompson & Heelas 1986, 108.
[78] The Oregonian 03.07.1985.
[79] Harvey 2024, 35-36.
[80] The Oregonian 14.07.1985.
[81] The Oregonian 02.07.1985 et 13.07.1985.
[82] The Oregonian 14.07.1985.
[83] The Oregonian 13.07.1985.
[84] Thompson & Heelas 1986, 120.
[85] The Oregonian 30.06.1985.
[86] Urban 2015, 52, 75.
[87] James 2024, 23.
[88] Thompson & Heelas 1986, 47.
[89] Heelas 1996, 96.
[90] Urban 2015, 51-52.
[91] Heelas 1996, 95.
[92] The Oregonian, 15.07.1985.
[93] Vallier 2022.
[94] Michéa 2011-2012, 431 n.6.
[95] Michéa 2011-2012.
[96] Vallier 2022.
[97] Ce point peut être nuancé, puisque certains auteurs, comme Hayek, défendent un certain conservatisme social, c’est-à-dire un ensemble de règles morales héritées qui maintiennent la cohésion de la communauté.
[98] Harvey 2024, 25.
[99] Voir par exemple Brown 2015.
[100] Michéa 2011-2012, 431.
[101] Thompson & Heelas 1986, 42, 65.
[102] Terrin 1985, 79, « non-finalità del mondo della natura ».
[103] James 2024, 19.
[104] The Oregonian 16.07.1985.
[105] The Oregonian, 04.07.1985.
[106] The Oregonian, 08.07.1985.
[107] Thompson & Heelas 1986, 57.
[108] Voir Dufour 2009.
[109] Voir l’article Urban 2005, qui évoque dès le titre la complémentarité entre l’aspect « sex guru » et l’aspect « guru of the rich ».
[110] Michéa 2011-2012, 432.
[111] Rajneesh, cité par Thompson & Heelas, 1986, 111.
[112] Urban 2015, 36.
[113] Vallier 2022.
[114] Cité par Michéa 2011-2012, 438.
[115] The Oregonian, 01.07.1985.
[116] Rajneesh 1975, 35.
[117] Heelas 1996, 22.
[118] Voir Carter 1990.
[119] Les dérives autoritaires auxquelles mènent les politiques libérales ont notamment été le sujet de Karl Polanyi dans son ouvrage La Grande Transformation (1944).
[120] Voir Harvey 2024, 119.
[121] Michéa 2011-2012, 432.
[122] Cité dans The Oregonian 11.07.1985.
[123] Heelas 1996, 22.
[124] Thompson & Heelas 1986, 49.
[125] Cité par Thompson & Heelas 1986, 68.
[126] Thompson & Heelas 1986, 25.
[127] Cette attirance de Rajneesh pour les riches ne naquit pas avec son arrivée aux États-Unis, loin s’en faut. Il fréquentait le gratin de la société indienne à dessein, comme le raconte un journaliste qui le connut à Jabalpur : « He knew what the rich people want. They want to justify their guilty consciences, to justify their guilty acts » (cité dans The Oregonian 01.07.1985).
[128] The Oregonian 02.07.1985.
[129] Thompson & Heelas 1986, 10.
[130] Voir par exemple Gilens 2014 ou Piketty 2014. Sur la concentration du pouvoir, voir Harvey 2005, 89.
[131] James 2024, 13.
[132] Wolfe 1976.
[133] James 2024, 15.
[134] Cité par Biebricher 2018, 153.
[135] Rajneesh 1975, vii.
[136] Thompson & Heelas 1986, 39.
[137] Urban 2015, 48.
[138] Tous les disciples rejoignant la communauté prenaient un nom hindi en arrivant, The Oregonian 30.06.1985.
[139] Thompson & Heelas 1986, 44.
[140] Terrin fait de ce point l’un des éléments centraux de la pensée religieuse de Rajneesh (Terrin 1985, 74-79, L’esistenza è ‘divina’).
[141] Rajneesh cité par Thompson & Heelas, 19-20.
[142] Harvey parle d’une néolibéralisation chantant « les gloires de l’éphémère » (2024, 321).
[143] Bécar 2012-14, 148.
[144] Anderson 2019.
[145] Michéa 2011-2012, 437.
Bibliographie
Abbott Carl (1990), « Utopia and Bureaucracy: The Fall of Rajneeshpuram, Oregon », Pacific Historical Review 59, n°1 : 77-103.
Bécar Florence (2012-14), « Notes de lecture », Dialogue 198 : 148-150.
Biebricher Thomas (2018), The political theory of neo-liberalism, Stanford : Stanford University Press.
Brown Wendy (2015), Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York : Zone Books.
Carter Lewis (1990), Charisma and Control in Rajneeshpuram: The Role of Shared Values in the Creation of a Community, New York: Cambridge University Press.
Deneen Patrick (2019), Why Liberalism Failed, New Haven : Yale University Press.
Dufour Dany-Robert (2009), La cité perverse. Libéralisme et pornographie, Paris : Denoël.
Gilens Martin (2014), Affluence and Influence : Economic Inequality and Political Power in America, Princeton, NJ : Princeton University Press.
Harvey David (2024, 1ère édition 2005), Brève histoire du néolibéralisme, Éditions Amsterdam.
Hayward Steven F. (2001), The Age of Reagan: The Fall of the Old Liberal Order: 1964-1980, New York City : Three Rivers Press.
Heelas Paul (1996), The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Blackwell Publishers.
James Madeline (2024), ‘Colors of the Sunrise’: The Rajneesh and the Me Decade, Thesis Presented to the Faculty of the College of Arts and Sciences, Ohio University.
Latkin Carl, Hagan Richard, Littman Richard et Sundberg Norman (1987), « Who Lives in Utopia? A Brief Report on the Rajneeshpuram Research Project », Sociological Analysis, vol. 48, n°1 : 73-81, Oxford: Oxford University Press.
Lasch Christopher (1979), The Culture of Narcissism, W.W. Norton.
Michéa Jean-Claude (2011-12), « Le nouvel Adam libéral », Revue du MAUSS 38 : 429-441.
Piketty Thomas (2014), Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA : Harvard University Press.
Rajneesh Bhagwan Shree (1975), The True Sage, Rajneesh Foundation.
Terrin Aldo Natale (1985), Nuove Religion. Alla ricerca della terra promessa, Brescia : Morcelliana.
Thompson Judith & Heelas Paul (1986), The Way of the Heart. The Rajneesh Movement, New Religious Movements Series, Wellingborough, Northamptonshire : The Aquarian Press.
Urban Hugh (2015), Zorba the Buddha. Sex, Spirituality, and Capitalism in the Global Osho Movement, Oakland : University of California Press.
Vallier Kevin (2022), « Neoliberalism », The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/neoliberalism/>
Wolfe Tom (1976), The ‘Me’ Decade and the Third Great Awakening, New York : Farrar, Straus and Giroux.
Zaitz L. & Long J. (1985a). « Rajneeshees : From India to Oregon ». The Oregonian 30.06.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985b). « Bhagwan Shree Rajneesh : Small-town boy makes guru ». The Oregonian 01.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985c). « Poona era caps period of growth for Rajneeshism ». The Oregonian 02.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985d). « Rajneeshees leave legacy of unpaid taxes behind in India ». The Oregonian 03.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985e). « India seeks guru’s disciples in investigation of smuggling ». The Oregonian 04.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985f). « Sheela’s brother figures in purchase of Oregon land ». The Oregonian 06.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985g). « Sheela uses words as weapons in bid to serve Rajneesh ». The Oregonian 07.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985h). « Incorporation of Rajneeshpuram opens door to development ». The Oregonian 08.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985i). « Rajneesh establish security forces, large armory ». The Oregonian 09.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985j). « Paranoia, weapons emerge at Rajneeshee enclave ». The Oregonian 10.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985k). « Rajneeshee antics raise eyebrows in legal arena ». The Oregonian 11.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985l). « Rajneesh Followers Amass Fleet of 73 Rolls-Royces ». The Oregonian 12.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985m). « Rajneeshee financial arm stays in touch with ranch ». The Oregonian 13.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985n). « Rajneeshees nurture corporate community on ranch ». The Oregonian 14.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985o). « Officials on ranch control network ». The Oregonian 15.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985p). « Methods of extracting donations vary ». The Oregonian 16.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985q). « Experts draw distinctions between cults, religions ». The Oregonian 17.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985r). « Immigration problems plague Rajneesh, followers ». The Oregonian 18.07.1985.
Zaitz L. & Long J. (1985s). « Rajneeshees catch service napping ». The Oregonian 19.07.1985.
Pour citer cet article :
Keller, A. (2025). Rajneeshpuram : une communauté néolibérale dans l'Amérique de Reagan ?. RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/articles-n-18/rajneeshpuram.html
Pour accéder au fichier de l'article, cliquez sur l'image PDF ![]()



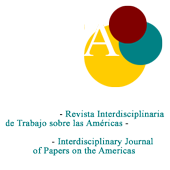





 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8