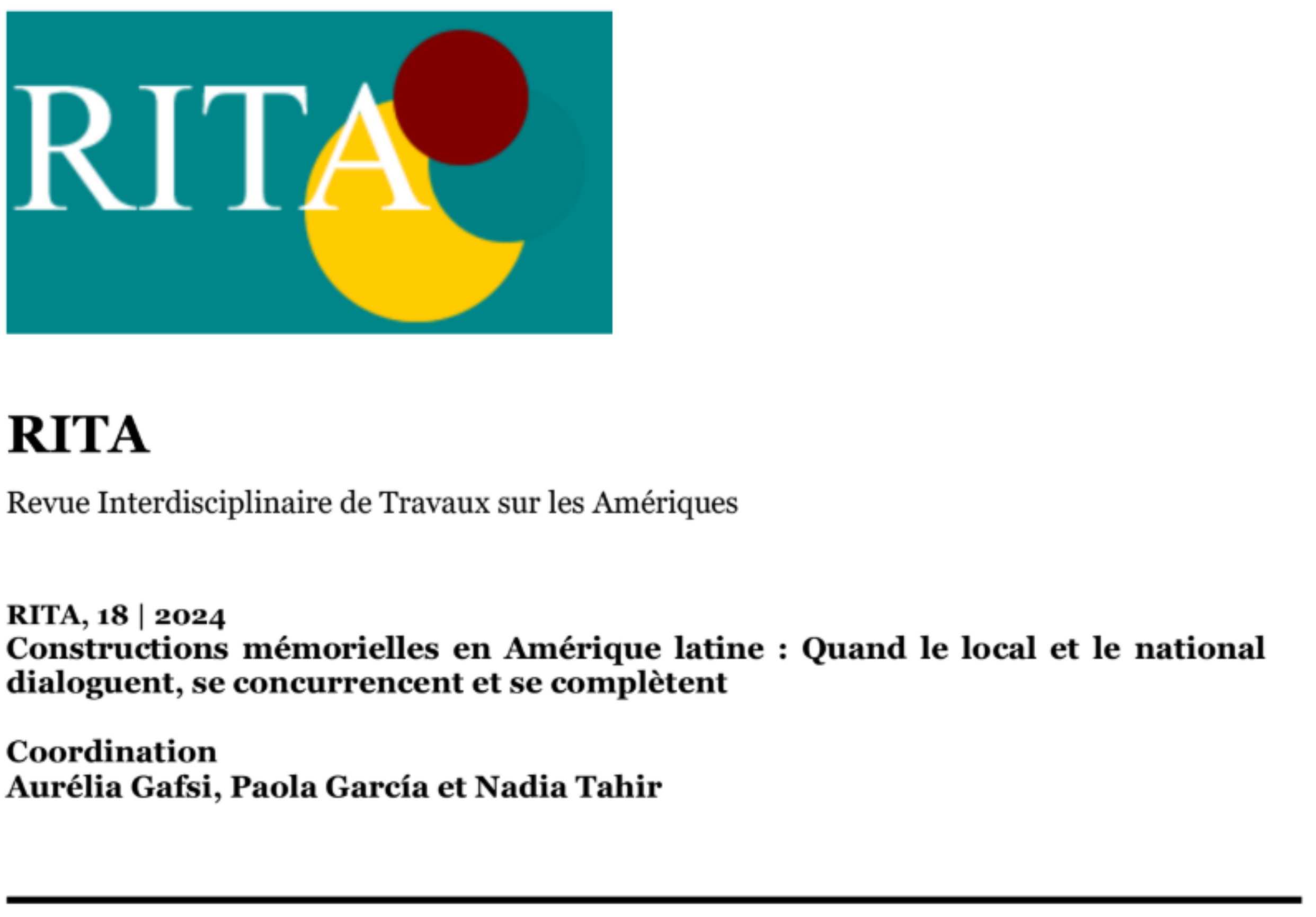
Constructions mémorielles en Amérique latine : Quand le local et le national dialoguent, se concurrencent et se complètent
Coordinatrices :
Aurélia Gafsi, doctorante en Études ibériques et latino-américaines, Sorbonne Université
Paola García, Maîtresse de Conférences en Études hispano-américaines, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Nadia Tahir, Maîtresse de Conférences en Études hispano-américaines, Université de Caen Normandie
En 2025, de nombreux pays sud-américains connaissent la plus longue période démocratique de leur histoire. Raúl Alfonsín, le premier président après la fin de la dernière dictature argentine, disait qu’« avec la démocratie : on mange, on éduque et on soigne », il a ensuite dû faire face à de nombreuses attaques des militaires qui menaçaient la pérennisation du régime démocratique. C’est aussi pendant son mandat qu’ont été mis en place deux outils fondamentaux dans les politiques publiques de mémoire liées au passé dictatorial : la CONADEP et le « Juicio a las juntas » entre 1983 et 1985. Aujourd’hui, l’Argentine vient de célébrer 40 ans de démocratie et entame une nouvelle décennie avec la victoire d’un président, Javier Milei, qui prétend rendre au pays sa gloire supposée de la fin du XIXème siècle. Chez son voisin, les Brésiliens ont porté à nouveau au pouvoir Luis Ignacio « Lula » Da Silva après le mandat de Jair Bolsonaro qui défendait clairement l’héritage dictatorial. Dans le cas des deux hommes, leurs rapports au passé dictatorial a souvent été une grille de lecture pour analyser leur positionnement idéologique. Le Chili a élu en décembre 2021 son plus jeune président, Gabriel Boric, figure de l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques qui s’inscrit, à gauche, dans la lignée des actions du président Salvador Allende, démis par le coup d’État d’Augusto Pinochet en 1973. Pour finir, on peut évoquer l’élection de Gustavo Petro en Colombie en juin 2022 : premier président « de gauche » du pays, ancien membre d’une organisation qui a déposé les armes au début des années 1990 et qui souhaite œuvrer pour le fonctionnement effectif des accords de 2016 issus du processus de paix.
Le passé récent en Amérique du sud est souvent utilisé comme référent pour soutenir ou discréditer des candidats aux élections nationales : quel rôle a joué telle personne pendant le régime dictatorial ou autoritaire ? qu’est-ce qu’une autre a fait ou non pendant la répression ? dans quelle mesure a-t-elle bénéficié ou non du régime ? quels sont les liens qu’elle entretient avec des cercles de pouvoir de l’époque, quels étaient ses liens avec les organisations armées ? etc. La tentative d’assassinat sur Cristina Fernández de Kirchner en septembre 2022, a été associée à la circulation de discours de haine héritiers du passé violent du pays, laissant entendre qu’ils n’ont jamais vraiment disparu. Ainsi, pour certains observateurs, le « Nunca más » (Plus jamais ça) n’a pas eu l’effet escompté. L’arrivée de Javier Milei à la présidence de l’Argentine et surtout de sa vice-présidente Victoria Villaruel, militante négationniste[1], en est une preuve encore plus récente.
Comme le montrent Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc dans leur ouvrage À quoi servent les politiques de mémoire ? il est difficile de mesurer leurs impacts et ces « politiques de mémoire sont trop souvent des politiques de l’impuissance »[2]. Si l’on s’en tient à l’injonction morale de la non répétition des faits, il est difficile de donner tort aux autrices, cependant, selon elles, l’impact de ces politiques peut se mesurer autrement. Les politiques de mémoire sont aujourd’hui des politiques « comme les autres » et c’est finalement lorsqu’elles en arrivent à ce stade qu’elles sont plus fortes. Cette affirmation, qui peut paraître à contre-courant, notamment pour les acteurs qui veulent mettre en avant l’exceptionnalité des faits liés à ces politiques, est d’autant plus intéressante si on l’applique au cas des pays latino-américains. Ainsi, qu’en est-il pour les pays qui ont géré Passé et Présent en même temps au sortir d’un régime autoritaire ou d’une guerre civile ? En effet, les politiques de mémoire sur le passé récent ont constitué des politiques à part entière, au même titre qu’une politique économique et sociale. On peut aller plus loin en citant Sandra Raggio et Roberto Cipriano García qui, dans le cas de la Commission provinciale pour la mémoire de la province de Buenos Aires, soulignent les difficultés liées à la mise en place d’une politique d’État qui finalement remet en question « l’État lui-même »[3]. Luciana Messina et Florencia Larralde Armas estiment que ces politiques sont avant tout le fruit de « l’engagement de la subjectivité des artisans »[4]. Il faut alors s’interroger sur les motivations qui conditionnent les subjectivités, notamment lorsque l’on parle des experts ou des hommes et femmes politiques qui ne sont pas ou n’ont pas été victimes et/ou militants.
Depuis maintenant plus de deux décennies les travaux sur les politiques publiques en lien avec les passés traumatiques en Amérique du sud se sont multipliés. Ils se sont développés dans des cadres scientifiques nationaux, mais aussi continentaux dans un dialogue régulier entre chercheurs et chercheuses de différents pays, notamment dans le Cône Sud et les Andes. Portant principalement sur des politiques nationales, les recherches sur les constructions mémorielles à l’échelle locale sont plus ponctuelles et les réflexions restent très souvent au niveau d’un pays. Il s’agit par ailleurs de faire dialoguer des travaux sur un même passé traumatique -dictature, esclavage, massacres de populations originaires, etc.-, alors même que les objets d’étude au cœur de ces analyses -associations de victimes, gouvernements nationaux ou locaux, instances internationales- échangent de plus en plus sur leurs pratiques. Ce dossier propose une réflexion commune à plusieurs niveaux pour mieux mettre en avant les singularités d’initiatives locales en Amérique du sud. Cela se fait principalement en étudiant ces politiques à l’aune de deux objectifs. Le premier objectif porte sur la volonté de certains acteurs.trices de laisser des traces. Ainsi, l’article de Carolina Espinosa Cartes s’intéresse aux différentes archives qui ont été développées autour de la dictature d’Augusto Pinochet au Chili (1973-1990). Elle interroge l’accessibilité de ces matériaux, à travers leur mise en ligne ou leur création directement en ligne. Ce support semble nouer de fait un dialogue entre des initiatives nationales et des initiatives locales qui se construisent dans le cadre d’une complémentarité. Dans son analyse d’un projet très local en Colombie, autour de la disparition de personnes, Tiphaine Duriez nous permet de voir que la reconnaissance nationale ouvre la porte au développement d’une initiative dans un espace peu habituel pour la reconnaissance des victimes du conflit qui gangrène le pays depuis des décennies : un planétarium. En Argentine, Aurélia Gafsi analyse la création de dalles de la mémoire en lien avec la disparition forcée de personnes pratiquée massivement pendant la dernière dictature qu’ait connu le pays (1976-1983). Ces initiatives pratiquées à l’échelle des quartiers vont coïncider avec des politiques nationales très favorables aux revendications des organisations des droits humains à partir du mandat de Néstor Kirchner. Aurélia Gafsi s’interroge donc sur les défis que cela représente pour des actions entamées avant l’arrivée de ce président et sur les enjeux pour les réclamations autour du passé dictatorial. Le second objectif porte sur la recherche d’institutionnalisation de pratiques impliquant parfois une reconnaissance au niveau national, mais se construisant d’abord au niveau local. Nadia Tahir étudie la mise en place d’une Commission Provinciale pour la Mémoire à l’échelle de la province du Chaco en Argentine pour tenter de voir comment les politiques publiques liées au passé dictatorial à échelle locale et nationale se superposent et s’alimentent. Si des éléments de concurrence peuvent être perçus, dans ce cas, on constate qu’elle bénéficie finalement aux revendications qui sont portées. Enfin, Carolina Rezende, en travaillant sur la Commission d’amnistie au Brésil, revient sur les politiques publiques mises en place au niveau national autour du passé dictatorial (1964-1985). Ce parcours lui permet surtout de voir la mise à l’épreuve que représente une instance comme la commission d’amnistie pour les individus et les actions à échelle locale.
Ce dossier permet de voir, notamment, que les victimes ne sont pas les seules porteuses d’initiatives et que les vecteurs mémoriaux au niveau local sont très souvent des membres de la communauté, hommes et femmes politiques ou membres d’organisations civiles ou artistiques, qui prennent part activement au débat sur les politiques publiques à mettre en place. En analysant les différentes motivations de ces « entrepreneurs de la mémoire »[5], on peut voir dans quelle mesure leurs modalités d’actions sont le fruit d’une évolution des constructions mémorielles dans les lieux et pays concernés. On peut ainsi esquisser des chronologies et tenter de voir dans quelle mesure les constructions mémorielles nationales ont précédé ou se sont inspirées de l’échelle locale. Cela permet de mieux comprendre en quoi les « politiques de mémoire » sont devenues des « politiques comme les autres » en Amérique du sud et si cela contribue à leur pérennité.
Notes de fin
[1] Ranalletti M. (2021). Apuntes sobre el negacionismo en Argentina. Uso político del pasado y reivindicación de la represión ilegal en la etapa post-1983. Negacionismo, Secretaría de Derechos Humanos Argentina, pp .29-43.
[2] Gensburger S. & Lefranc S. (2017). À quoi servent les politiques de mémoire ? Paris, Les Presses de Sciences Po.
[3] Cipriano García, R. & Sandra Raggio, S. (2019). La comisión provincial por la Memoria. Reflexiones en torno a la relación pasado presente en una experiencia temprana de institucionalización de las políticas de la memoria. Clepsidra, 6 (12), pp. 108-127.
[4] Larralde Armas, F. & Messina, L. (coord.) (2019). Políticas públicas de memoria: el Estado frente al pasado represivo. Clepsidra, 6 (12), pp. 8-15.
[5] Jelin E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XII Editores.
Pour citer cet article :
Gafsi, A., García, P. & Tahir, N. (2025). Introduction au dossier « Constructions mémorielles en Amérique latine : Quand le local et le national dialoguent, se concurrencent et se complètent ». RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/indroduction-dossier-thematique-constructions-memorielles-en-amerique-latine-quand-le-local-et-le-national-dialoguent-se-concurrencent-et-se-completent-aurelia-gafsi-paola-garcia-et-nadia-tahir.html
Pour accéder au fichier de l'introduction, cliquez sur l'image PDF ![]()



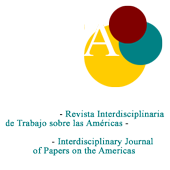





 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8