Entretien avec Paula Anacaona, traductrice, autrice et fondatrice de la maison d’éditions Anacaona
Traductions et édition de la littérature périphérique brésilienne en France : enjeux et perspectives
Comment est née l’idée de traduire et de publier la littérature marginale brésilienne ?
C’est par le biais de la littérature des États-Unis que j'ai eu un premier contact avec la littérature marginale qu’on a parfois tendance à appeler littérature carcérale car un grand nombre de ces auteurs est passé par la case prison alors qu'au Brésil un peu moins. Ce qui m'a séduite c'est le côté coup de poing, la façon dont ils traitaient les problématiques de société.
J'ai eu l'occasion de rencontrer Paulo Lins, auteur du roman Cidade de Deus (1997), qui ensuite m'a présenté Ferréz, donc tout s'est fait un peu de fil en aiguille, au fil des rencontres humaines… Et ensuite, il y a eu un autre élément qui a été très important, c'est le mouvement des saraus qui est né au Brésil au début des années 2000 à Sao Paulo. Ce sont des rassemblements qui sont assez spontanés, gratuits, qui ont lieu dans un café. Tout le monde s'inscrit au début, en disant moi je passe en premier, en 13e, en 15e… Chacun déclame ses propres textes, ou les textes d’autres auteurs. Mais les saraus sont devenus ensuite une scène pour des jeunes écrivains qui n'étaient pas publiés et donc ça a été un moyen pour tous ces gens qui n'avaient aucun contact avec des maisons d'édition de lire leurs textes, de voir qu'ils avaient du succès, de s'auto-publier voire ensuite d'être publiés par des grandes maisons. Et ce mouvement des saraus m'a touchée parce que j'y ai vraiment senti une littérature du réel.
On pourrait qualifier cette littérature de littérature engagée, sociale ou réaliste. Moi je dirais que c'est un petit peu tout ça. Et ce qui caractérise le plus cette littérature, c'est le côté viscéral. Vraiment pour moi, la littérature marginale est viscérale, et surtout elle est faite par les gens de ces communautés, par les habitants des favelas. Je ne dis pas que quelqu'un de classe supérieure n'est pas capable d'écrire un super roman sur la favela. Par exemple je pense à Patricia Melo qui a écrit Enfer qui est un très bon roman sur un dealer de drogue dans une favela. Mais malgré tout je ne le qualifierais pas de littérature marginale. Pour moi, la littérature marginale c'est une littérature qui parle du quotidien de son auteur qui vit en marge et qui le fictionnalise ou pas. Ça c'est vraiment très important, et quand vous me demandiez si c’était de la littérature tout court… Bon en littérature, il y a toujours la forme et le fond, et je dirais que dans la littérature marginale le plus important, c'est quand même le fond. Je reconnais qu’il y a des auteurs que j'ai publiés dans Je suis Favela et Je suis toujours Favela qui n'ont pas un style littéraire incroyable, mais peu importe. En fait ce qui m'importe, c'est la valeur de témoignage, et c'est surtout le processus de comment ils ont réussi à dépasser une situation qui aurait pu les tirer vers le bas, comme un boulet, et ce boulet ils en ont fait quelque chose qui les a fait sortir de leur milieu. Donc c'est vraiment de l'empowerment.
Ce qui me plait dans cette littérature
C’est avec le livre de Ferréz, Manuel pratique de la haine que j'ai commencé ma maison d'édition. J'adore tous les livres que j'ai publiés mais j'ai une affection particulière pour celui-là, c’est le premier... Mais je vais vous raconter une anecdote : quand Ferréz a sorti son livre en 2005 au Brésil, ça a vraiment été une petite bombe dans le milieu éditorial. C'est-à-dire que tout le monde, tous les médias en ont beaucoup parlé, il est passé à la télévision, et il a vendu quasiment 100 000 exemplaires de son livre, très rapidement. Donc forcément les grandes maisons d'édition en France, devant un tel phénomène, avaient eu le livre entre les mains (j’ai d’ailleurs rencontré plusieurs lecteurs de maisons d’édition, qui m’avaient confié avoir fait une fiche de lecture pour le Manuel). Et ce qui m'a choquée, c'est de savoir que toutes les maisons d'édition l'avaient eu et qu’aucune n'avait voulu le publier. Et je me suis demandé : pourquoi un tel désintérêt, qu’est-ce qui les gênait dans cette littérature ? J’avais eu l'occasion d'en parler avec une autre éditrice qui avait eu ce livre entre les mains et qui ne m'avait pas dit : « oh c'est nul ! », non, elle avait rejeté ce livre avec force. Ce n'était pas que le livre était nul, qu'il était mal écrit, c'était que ce livre la gênait. C’est précisément cela qui m'a plu, je me suis dit j'ai envie de les déranger, j'ai envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, dans ce milieu éditorial français que je trouvais trop timide, trop timoré, trop classique.
Cette littérature se concentre essentiellement à Sao Paulo, c'est d'ailleurs là qu'elle est née, puis elle s'est déplacée à Rio, et avec le mouvement des saraus elle s'est étendue à tout le Brésil. C'est essentiellement une littérature urbaine.
C'est un concentré extrême de misère et de d'exclusion, car quand on est à Rio et qu'on descend la Rocinha, une des plus grandes favelas de la ville, pour se rendre dans les quartiers en bord de mer, les quartiers très riches, l'inégalité est vraiment frappante alors qu'à la campagne c'est un peu plus diffus, car le grand propriétaire habite loin de chez vous et c'est sans doute moins criant. Mais je ne suis pas contre une littérature marginale des campagnes, ça m'intéresserait beaucoup d'en lire car dans la campagne aussi il y a des exclus, des miséreux, des gens qui ont la haine ! Il y en a même un paquet ! Pour l'instant, je ne crois pas que cela existe réellement, mais je suis sûr qu'avec la situation qu'est en train de vivre le Brésil où il y a une résurgence des luttes foncières, des luttes agraires, une littérature pourrait vraiment émerger. Il y a là aussi une inégalité, une discrimination et une violence qui pourraient être un terreau fertile pour une littérature marginale.
Cette littérature marginale n'a malheureusement pas encore une parité de genre. On retrouve l'intersectionnalité classique : les femmes sont discriminées, les femmes noires encore plus. Dans le premier recueil que j'ai publié, Je suis favela, je me suis aperçue qu'il n'y avait pratiquement que des hommes, 11 hommes et une femme. Je n'avais pas fait attention, j'avais choisi les nouvelles qui premièrement étaient arrivées jusqu’à moi, et deuxièmement qui me plaisaient... Et j’avais reçu très peu de nouvelles écrites par des femmes. Dans le deuxième volume, Je suis toujours favela, j’ai voulu rétablir l'équilibre mais c'est difficile car les femmes ont moins confiance en elles et s'autocensurent alors qu’elles sont pourtant présentes dans les saraus. Il a vraiment fallu que j’aille les chercher ! Pour le troisième volume, Je suis encore favela, nous avons fait attention à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes ainsi qu'une bonne représentativité des minorités ethniques et des minorités LGBT. L'homme blanc est sur-représenté dans la littérature brésilienne et il est vrai qu'il faut vraiment chercher pour trouver une auteure noire homosexuelle publiée, par exemple. (Je ne doute pas qu’il y en ait, mais elles ne sont pas publiées).
Je suis favela (2011) donne une vision assez sombre de la favela. C'était pendant la mandature de Lula mais des programmes d'aide comme la Bolsa Família n'étaient pas encore entrés dans toutes les familles et donc le contenu de ce volume est assez sombre. Je suis toujours favela est sorti en 2014 en plein boom économique des années Lula - on avait l'impression que le Brésil allait devenir la 4ème puissance économique mondiale. C’est un volume très optimiste avec des histoires de jeunes des favelas qui vont à l'université grâce aux quotas par exemple. Le troisième volume Je suis encore favela (2018) est de nouveau plus sombre, un petit peu le contrecoup, le coup du bâton, mais je crois qu'il est plus sombre aussi parce que justement ces années Lula ont apporté la consommation, mais aussi une certaine éducation, une certaine conscientisation et je crois que maintenant les gens ne tolèrent plus d'avoir 6 morts dans une fusillade (et ils ont l’info grâce aux réseaux sociaux, qui ont véritablement changé la donne au Brésil), ils ne tolèrent pas un hôpital public complètement dégradé… Aujourd’hui, les Brésiliens s'indignent davantage. C’est cela : c'est un volume qui est très indigné. On s'indigne même si on ne sait pas toujours comment faire pour que les choses aillent mieux, mais c'est déjà un premier pas, de ne plus accepter ce qui autrefois l'était. Les Brésiliens se rendent compte que le développement ne s’arrête pas à une hausse de leur consommation ou de leur pouvoir d’achat. Ça, c’est un leurre. Le développement d’un pays s’accompagne du développement de ses services pour les citoyens – éducation, santé, infrastructures, transports publics. Et cela n’a pas suivi au Brésil.
Pour revenir sur les femmes dans cette littérature, il faut rappeler le rôle qu'a joué Carolina Maria de Jesus avec la publication de son journal de femme de la favela, Quarto de despejo (1960) / Le Dépotoir (1962). Elle peut être considérée comme le point de départ de cette littérature marginale même si d'autres pensent que ce pourrait être Lima Barreto. Concernant la sous-représentation des femmes dans la littérature marginale, je l’explique peut-être parce que les femmes sont souvent seules à la tête de leur foyer, elles ont leurs enfants et parfois les enfants des autres à élever, il y a peut-être une problématique de temps ? Mais en tout cas maintenant elles prennent la plume. Elles s'expriment mais surtout elles ont l'ambition d'être publiées et ont gagné en confiance. Et puis elles ont des modèles comme Conceição Evaristo qui est une femme dont les œuvres n'ont pas été publiées pendant 25 ans et qui maintenant gagne en visibilité et donne très certainement des idées à beaucoup de femmes, qui se disent que si Conceição Evaristo est capable d’écrire, avec talent, elles aussi peuvent peut-être le faire.
Les titres des volumes publiés
Pourquoi avoir appelé ces volumes Je suis favela ? Il est vrai que pour les Français la favela c'est très identifiable. Tous les Français ont vu le film de Fernando Meireless et Kátia Lund La Cité de Dieu (2002), ils ont vu des reportages sur les favelas. Ils sont souvent très intrigués par cette favela où se concentre de la misère juste à côté des quartiers riches, c'est quelque chose qui les perturbe – qui les fascine aussi parfois. Parce qu’ici en France, les banlieues sont bien loin du 16e, donc les Français se demandent comment c’est possible de vivre en ayant les pauvres juste à côté alors que chez nous, les pauvres, ils sont bien loin, tout au bout de la ligne de RER... Avec ce titre, j’ai voulu profiter de cette curiosité du public français à l’égard de ces espaces. Mais au-delà, avec ce « Je suis… » (bien avant le « Je suis Charlie »), je voulais insister sur l’appropriation de ce territoire par ces habitants. « Je suis favela », et je n’en ai pas honte, je l’écrit même sur la couverture d’un livre. Et ensuite, les volumes 2 et 3, Je suis toujours favela, Je suis encore favela, c’était pour faire une suite logique. Toujours : oui, je le suis toujours, et je le clame haut et fort. Encore : on sent peut-être en effet une lassitude…
Les thèmes récurrents de cette littérature
Bien sûr, la violence, la drogue mais aussi l'amour, les rêves inaboutis, l'espoir d'une vie meilleure, l'exclusion qui sont finalement des thèmes universels. Les textes qui parlent de la favela sont une projection d'une société où les relations sont tendues et les habitants de ces quartiers ont de quoi écrire en puisant leur inspiration de leur réalité. Certains d'entre eux veulent essayer de sortir de cette image qui colle à la favela en n'étant pas catalogués comme "écrivains de la favela" mais je trouve qu'ils se perdent un peu. Il n'y a pas à avoir honte d'être un écrivain de la favela qui écrit sur la favela. En quoi ça serait réducteur ? Je suis pour qu'ils se concentrent sur ces thèmes-là car il y a beaucoup à dire. Et ils sont les mieux placés pour en parler.
Problèmes de traduction
Je pense travailler un petit peu comme les actrices, c'est-à-dire que je me « mets en condition » avant de commencer à traduire. Je vais lire des livres en français autour du thème de ce roman brésilien que je vais traduire. Par exemple pour traduire Ana Paula Maia j'ai relu Dostoïevski, pour Conceição Evaristo j'ai relu Patrick Chamoiseau et des auteurs caribéens et pour Ferréz, des auteurs de la banlieue pour m'imprégner de leur façon de dire les choses. Une fois que je me suis un peu imprégnée de la langue en français, je me lance dans la traduction. C'est un moment que j'adore : je suis dans le rôle de la personne de la banlieue, de la Noire dans les années 60 dans la favela de Belo Horizonte… Beaucoup de gens pensent que certaines choses sont intraduisibles. Certaines, oui, sûrement – mais au final, il y en a peu. Peut-être une langue va être plus concise qu’une autre pour décrire un sentiment… Ou effectivement, pour tout ce qui est alimentation, végétation, ce peut être un vocabulaire typiquement national… J’ai récemment traduit l’essai de Rodney William, L’appropriation culturelle, où il parle notamment du candomblé… Là c’est vrai que j’étais face à une spiritualité, à des rites, qui n’existent pas en France. L’option 1 : j’invente tout un champ lexical (mais que faire des mots en langue africaine, qui ont été gardées précisément en signe de résistance culturelle, les laisser ou les traduire ?). L’option 2, qui est celle que j’ai choisie : je laisse en langue originale avec pas mal de notes… (par exemple, ialorixa, terreiros, orixas, fios de contas, encruzilhada, … Tout un lexique cérémoniel inexistant en français. Malgré tout, je suis de celles qui pensent que, à quelques exceptions près comme celles que je viens de citer, la traduction peut faire son job à… 98 ou 99% ! Pour tout ce qui touche aux banlieues, avec Ferréz par exemple ou d’autres auteurs de la favela, je n'ai eu aucun problème de traduction parce que les points de vente de drogue, ça existe en France, que vous alliez dans le 93 ou dans les favelas de Sao Paulo, c'est la même chose ! Des narcotrafiquants, des policiers véreux, toute cette hiérarchie de petits boulots qu’on trouve dans cette économie (guetteurs, livreurs, empaqueteurs, nourrices, etc. etc.), on en trouve partout. Donc il s'agit juste d'aller chercher l'information car le traducteur n'est pas quelqu'un qui connaît tous les mots, ce n’est pas nécessairement le bilingue parfait (si tant est que cela existe), le traducteur est celui ou celle qui sait où trouver l’information. J’ai donc mes dictionnaires en ligne sur l’argot, quand il s’agit de traduire un lexique lié au monde LBGT je me renseigne auprès d’amis homosexuels. J’écoute également les jeunes parler dans les transports en commun, j’écoute les chansons de rap français… et j’arrive ainsi à trouver des correspondances lexicales.
Pour revenir à l’argot de Ferréz, il ne faut pas oublier que même pour un Brésilien de classe moyenne, il était difficile à comprendre. Donc c’est normal qu’en français aussi, il soit compliqué à comprendre pour quelqu’un qui vit hors de ce milieu. J’ai délibérément choisi d’utiliser l’argot du 93 et le verlan. Cela en a choqué certains : est-ce une langue qui s’écrit ? Est-ce que les Français sont réceptifs à cette écriture de l’oral ? Par souci de réalisme, c’était indispensable. Et je pense que si on pouvait être choqué en 2010, nous le sommes moins en 2020. Il y a eu une évolution de ce côté-là. En revanche, le lexique du 93 (ou plus généralement des banlieues) est souvent emprunté à l’arabe – le fameux wesh par exemple – mais j’ai jugé qu’il n’était pas pertinent de traduire une réalité brésilienne où l’influence arabe est beaucoup moindre qu’en France par ce type de mot. C’est pour cela que j’ai préféré le verlan.
Si j’étais Marseillaise, ma traduction aurait bien sûr été différente ! Car les périphéries marseillaises ont leur propre argot. Et si je devais retraduire le Manuel aujourd’hui, ma traduction aussi serait différente – en 10 ans, la langue évolue tellement vite… La traduction est donc un parti pris : elle est le reflet d’un traducteur, d’une époque, d’un lieu.
Mon travail de traducteur m’amène à lire en portugais du Brésil pour me tenir au courant de l’évolution de cette langue mais en même temps il m’oblige à lire des romans en français pour accompagner cette langue dans ses divers aspects.
Parmi les quelques termes brésiliens difficilement traduisibles, il y a le classique saudades. Pourtant, les Français aussi doivent sentir la saudade quand ils sont loin de l’être aimé, du pays aimé… (Et le mouvement romantique du XIXe siècle, alors ?) Mais ils le disent différemment, en plusieurs mots, ou alors ne l’expriment pas – le Brésilien étant, c’est vrai, émotionnellement bien plus expansif… Il y a aussi le banzo (qui est le terme utilisé pour décrire la tristesse et la dépression des « esclavagisés » au Brésil) que je suis obligée d’expliquer par une note de bas de page. (Cependant, j’adore cet exemple du banzo, ou de la senzala pour lequel il n’y a pas de mot non plus en français. Je ne suis pas du tout certaine qu’ils renvoient à une réalité qui n’existerait qu’au Brésil : je suis sûre que les esclaves déportés dans les îles Caraïbes françaises devaient, eux aussi, avoir le banzo, mais en tout cas le français n’a pas retenu de mot pour cela. Idem pour la senzala. Cette invisibilisation épistémologique pour tout ce qui a trait au passé colonial de la France n’est-elle pas idéologique ? C’est un autre débat…).
Réception de cette littérature en France
A part sur les salons où l’on reçoit les lecteurs, il est difficile de savoir qui lit les romans que vous traduisez ou éditez. J’ai la chance d’avoir pas mal de retours – plus que la moyenne des autres maisons d’édition je pense, car les gens m’identifient beaucoup à la maison. Il m’arrive d’avoir des retours comme cette fois où un jeune qui n’avait pas l’habitude de lire m’a écrit, dans un message sans ponctuation et avec de nombreuses fautes d’orthographe, avoir adoré Je suis favela. Ce jour-là, je me suis dit : je peux mettre la clé sous la porte, j’ai rempli ma mission d’éditrice ! Jusqu’à présent, je pense que globalement mon lectorat était plutôt de classe moyenne alors que j’aurais aimé, notamment avec ces trois volumes sur la favela, toucher un public de banlieue. C’est un petit échec personnel mais je n’abandonne pas l’idée de les toucher un jour. Cependant, avec ma nouvelle collection d’essais féministes, je touche clairement un public plus jeune, féminin et nous avons une très belle réception. Ces questions intéressent fortement le public et avoir la vision de femmes du Sud est une bouffée d’air frais dans un féminisme encore trop souvent eurocentré.
Aura internationale de ces auteurs brésiliens
Lorsqu’un auteur brésilien est traduit en France, cela donne indéniablement une impulsion à sa carrière. D’un côté, je m’en réjouis, tant mieux pour lui ; de l’autre, je trouve cela un peu symptomatique du complexe du vira-lata, du Brésilien qui se persuade d’être du Tiers-monde mais si quelqu’un du premier monde s’intéresse à lui, ça devient chic et intéressant. J’ai publié Conceição Evaristo en 2015 et elle est devenue au même moment au Brésil une écrivaine reconnue. Les deux événements ont-ils une relation ? Je ne sais pas, (et je crois aussi que c’était pile le moment où le Brésil était prêt pour parler ouvertement de ces questions, remettre en cause le mythe de la démocratie raciale, etc. etc.) mais il est sûr que la traduction française et la publication de certains auteurs de la favela ont joué sur la notoriété de ces auteurs.
De la littérature des périphéries brésiliennes à l'afro-féminisme, quel bilan feriez-vous des dix ans de la maison d'éditions Anacaona? "Ecrire est-il toujours une arme » ?
Si on m’avait prédit en 2010 que je serais là où je suis aujourd’hui en 2020, j’aurais été dubitative ! Ces dix ans ont été très riches : dix ans de rencontres, de cheminement intellectuel. Certes, je me suis un peu éloignée ces dernières années de la littérature marginale stricto senso, mais au final, je suis restée cohérente par rapport à mon axe éditorial. Inconsciemment au début, aujourd’hui de façon plus consciente, je me rends compte que tout mon travail porte autour de la déconstruction du groupe majoritaire masculin, hétérosexuel, blanc, chrétien, riche, etc. comme seul détenteur du savoir. Cette affection intuitive que j’avais au début pour ces écrivains des favelas, puis pour ces personnages du Nordeste, marginalisés et opprimés eux aussi, était en fait une volonté de lire autre chose que les écrits du groupe majoritaire. Et aujourd’hui, avec la découverte du féminisme noir et du mouvement décolonial, je suis capable de mettre davantage de mots sur tous ces sentiments qui m’habitaient et qui dictaient mes choix – que je croyais être des choix dictés par la passion, mais qui en fait étaient orientés vers un but décolonial. Avoir pris conscience de cela est très apaisant, très fortifiant. Cela m’a également permis de comprendre certaines des résistances que j’ai pu affronter, certains échecs. J’adore ce concept de Cida Bento, le pacte narcissique de la blanchité, qu’elle utilise pour définir comment les personnes blanches se cooptent pour maintenir leurs privilèges et qui in fine agit pour exclure les groupes autres que le sien. Aujourd’hui, ce concept m’aide à expliquer la réception des Français face à la littérature brésilienne : de l’exotisme (encore et toujours, sacré Jorge Amado, a-t-il vraiment rendu service à la littérature brésilienne….), de la folklorisation, une lecture de vacances. Comme si les gens du Sud ne pouvaient pas intellectualiser, penser « sérieusement ». Et j’ai parfois l’impression que les écrivains ou les éditeurs du Nord se serrent les coudes pour ne pas laisser la place au Sud… Ou alors ils lui laissent une petite place, pour se donner bonne conscience… Je crois que l’Europe et l’Occident se croient encore comme seuls centres du savoir et de la production de savoir.
« Écrire est-il toujours une arme », comme je le disais en 2010 ?
Plus que jamais ! Et surtout, là encore, j’ai réussi à conceptualiser cela, en lisant Sueli Carneiro et Boaventura de Souza Santos, lorsqu’ils parlent d’épistémicide. Je me permets de citer cette grande intellectuelle noire qu’est Sueli Carneiro : « C’est un phénomène qui se produit par l’abaissement de l’estime de soi que le racisme et la discrimination provoquent dans le quotidien scolaire ; par la négation faite aux Noirs de la condition de sujets de connaissances, par le biais de la dévalorisation, la négation ou l’occultation des contributions du continent africain au patrimoine culturel de l’humanité ; par l’imposition du blanchiment culturel et par la production de l’échec et du décrochage scolaire. C’est ce processus que nous dénommons épistémicide. »[1] J’ai découvert avec Abdias Nascimento la notion de génocide culturel. Tout cela m’a permis de voir et de comprendre toutes les résistances envers la production culturelle et intellectuelle des groupes opprimés/minoritaires : les Noirs, les Autochtones, les habitants des favelas, les femmes, les minorités sexuelles. Exactement ceux que je publie ! Je n’avais donc pas choisi la littérature la plus facile… Mais je pense que ces outils théoriques peuvent être très utiles aux Français. J’espère que ces livres les feront réfléchir au machisme et au patriarcat (même si on en parle déjà beaucoup en France), mais aussi à la marginalisation des banlieues ou des territoires dits d’outre-mer, à l’oppression contre les musulmans, à l’invisibilisation des différences au nom de l’universalisme, etc… Donc oui, écrire est une arme, au Brésil et en France (et partout, d’ailleurs !)
Notes de fin
[1] Sueli Carneiro. (2005). A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Thèse de doctorat en éducation, São Paulo : Université de São Paulo.
Pour citer cet article
« Entretien avec Paula Anacoana : Traductions et édition de la littérature périphérique brésilienne en France : enjeux et perspectives», RITA [en ligne], n°14 : septembre 2021, mis en ligne le 23 septembre 2021. Disponible en ligne: http://www.revue-rita.com/rencontres14/entretien-avec-paula-anacaona.html



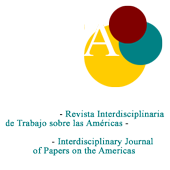




 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8